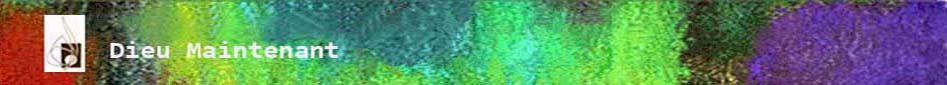

À voix nue
Jean-Paul Vesco
Jean-Paul Vesco, archevêque d’Alger, vit et travaille depuis plus de vingt ans en Algérie. Il parle ici, dans un style direct et sans artifice, de l’Église dans ce pays, de mémoire coloniale, de fraternité et de son propre parcours.
Extraits de l’entretien avec Jean-Paul Vesco sur « Les Podcasts Union algérienne » : https://www.youtube.com/watch?v=FVz2TFtu8Po
À la demande de la personne qui mène cet entretien, Jean-Paul Vesco se présente :
Je suis dominicain. Je suis arrivé en Algérie le 6 octobre 2002 ; cela fera bientôt vingt-trois ans. C’était quelques années après l'assassinat de Monseigneur Pierre Claverie qui était évêque d’Oran et qui a été assassiné avec l’un de ses amis musulmans le 1er août 1996 ; après l’assassinat des moines de Tibhirine et de 18 autres membres de l’Église. J’ai été, pendant plus d’une dizaine d’années évêque d’Oran. J’ai vécu surtout dans l’ouest et j’ai passé aussi une année heureuse au sud. Depuis 2021, je suis archevêque d’Alger. Le 7 décembre 2024, le pape François m’a créé cardinal : un honneur pour notre Église et pour le pays.
L’Église et la colonisation en Algérie
Question : Quel regard portez-vous sur l’implication de l’Église durant la période coloniale ?
Il faut d’abord se souvenir que le christianisme a des racines anciennes en Afrique du Nord — Augustin en est le nom le plus connu — puis il a disparu, puis il est revenu avec la colonisation. C’est incontestable : l’Église moderne en Algérie s’est reconstituée dans ce cadre. Certains estiment qu’elle aurait dû partir avec l’indépendance. Ce n’est pas ce qui s’est passé : à la rentrée 1962 beaucoup d’écoles et de dispensaires ont continué à fonctionner, des sœurs sont restées, et cela a scellé une forme d’alliance entre l’Église et le pays naissant. Aujourd’hui, notre Église se veut au service de la société, citoyenne : depuis soixante ans elle apporte sa part à la vie quotidienne.
Il y a eu des moments dramatiques, notamment les années de violence, dans les années 1990. L’Église a voulu rester, au prix du sang dans certains cas. C’est, à mon avis, un trait caractéristique : rester au milieu des hommes et des femmes, partager leur sort plutôt que de se replier.
Y a-t-il eu des chrétiens impliqués dans la révolution algérienne ?
Oui, clairement. Il y a eu des chrétiens et même des prêtres qui ont participé à la lutte. Mais il faut éviter les amalgames : quand il y a des conflits, la violence entraîne des crimes commis par des individus de toutes origines — il y a eu des résistants, des gens qui ont souffert, des humiliations, et aussi des actes inacceptables. Il y a eu aussi effectivement oui - des chrétiens - qui ont torturé. Il y a des chrétiens qui ont violé. Et puis il y a eu beaucoup de femmes et d’hommes qui ont résisté comme ils ont pu. D’une manière générale, il faut éviter les amalgames.
On le voit en ce moment, par exemple, pour ce qui concerne Israël et Gaza. Dans cette action que l'on peut qualifier de génocidaire, dans cette destruction et cette volonté, semble-t-il, d'éradication d'un peuple, il y a des rabbins qui s'opposent, qui résistent. Pendant l'Allemagne nazie, quelques-uns - par exemple le pasteur Bonhoeffer et ses amis - ont résisté à Hitler. Ils ont sauvé l'âme de l'Allemagne… parce qu’il suffit de quelques-uns. Dans la guerre d'indépendance, il y a eu aussi de ces personnes. C'est important de le noter parce que, dans toutes ces périodes de crise, il y a l'horreur mais aussi l'héroïsme et peut-être même la sainteté. Toutes ces périodes favorisent à la fois la bestialité de l'homme, la peur, la trahison et l'héroïsme. Dire la complexité, c’est refuser la simplification des jugements.
Mémoire, reconnaissance et fraternité
La question de la mémoire revient souvent. Est-ce l’heure que L’État français – ou même des citoyens d’une manière générale - reconnaissent les massacres ou la responsabilité coloniale ?
Non, ce n’est pas l’heure. Il y a des décennies que cela aurait dû être fait. La reconnaissance a manqué. Depuis des décennies, une parole simple de reconnaissance aurait dû être prononcée. Il ne s’agit pas de jouer les accusateurs perpétuels : les générations d’aujourd’hui ne portent pas la responsabilité directe. Mais elles portent un fardeau hérité d’un passé non-dit. Il y a 130 ans de colonisation — et pas seulement la guerre d’indépendance — qui ont laissé des blessures profondes dans l’âme du peuple algérien. Il suffit d’être longtemps au contact du pays pour le sentir.
Quand on voit que certains contestent encore qu’il y a eu des actes de tortures pendant la bataille d’Alger en 1957, c’est simplement insupportable. Un énorme travail d’enquête a été fait par une journaliste du Monde, il y a 10 ans. Elle a même retrouvé le poignard oublié par Jean-Marie Le Pen lorsqu’il était venu torturer Amy Moule. J’ai moi-même reçu une femme qui avait 10 ans à l’époque ; c’était la voisine et elle avait entendu toute la nuit de torture de cet homme. Elle avait été dans une terrible angoisse que la même chose arrive à son père. Or cette journaliste a été attaquée en diffamation par Jean-Marie Le Pen parce qu’il y a une loi d’amnistie qui interdit de faire allusion à ces faits.
Il y a bien sûr eu des gestes. Il y a bien sûr eu des paroles. Il manque une vraie parole. Il manque une vraie parole qui permettent de faire comprendre qu’en soi-même, on a compris la souffrance, on a senti les blessures. Et cette parole est sans doute difficile aujourd’hui parce que, pour la prononcer, il faut une connivence, une amitié profonde. C’est vrai pour les individus mais aussi pour la mémoire collective des peuples. Il n'y aura pas de parole juste tant que d'une manière ou d'une autre celui qui la prononcera, un chef d'état par exemple, n’aura pas compris dans sa chair ce que c'est que d'avoir été compté pour rien, avoir subi l’injustice - pendant 130 ans - sur la terre de ses aïeux.
Le problème est que nous - en tout cas en France - nous n'avons pas cette mémoire collective faite de compréhension profonde. Par exemple, il y a aujourd’hui en France beaucoup de rues qui portent le nom du tortionnaire qu’a été le général Bugeaud… Reconnaître, c’est d’abord dire la vérité des faits : des tortures, des massacres, des enfumades, des exactions. C’est douloureux, mais nécessaire. La vérité libère ; l’Évangile le dit. Sans cette parole, la mémoire reste encombrée, instrumentalisable. On peut croire que la blessure s’estompera d’elle-même degénération en génération ; au contraire, elle s’aggrave si elle n’est pas confrontée. Une reconnaissance franche ne va pas aggraver les relations ; elle peut les apaiser. Il nous faut admettre, simplement admettre comme un fait, que nous n'avons pas été à la hauteur de notre idéal de fraternité, nous français en Algérie, comme dans nos autres colonies et sans doute, malheureusement, aussi après les indépendances.
Quels obstacles à des relations apaisées entre la France et l’Algérie ?
Il y en a plusieurs. D’abord l’absence d’enseignement et de transmission de cette histoire : nous n’avons pas appris, en France, ce qui s’est réellement passé. Ensuite la nécessité d’une vraie volonté politique et culturelle pour regarder en face la portée inhumaine du fait colonial. Enfin, il faut dépasser la simple posture juridique ou mémorielle : c’est la fraternité qui manque. La fraternité est le cœur du problème — pas une fraternité communautariste, mais une fraternité qui dépasse les différences religieuses et culturelles.
La vraie fraternité est aussi ce qui permettrait d’accueillir pleinement les Franco-Algériens : on ne peut pas être 50 % d’un pays et 50 % d’un autre. On peut être pleinement algérien et pleinement français. Mon expérience personnelle le montre : on peut avoir plusieurs appartenances sans renoncer à aucune. C’est une richesse, pas une faiblesse.Laïcité, Fraternité et Identité Franco-Algérienne
Pensez-vous qu'il y a un recul du religieux en France en lien avec la laïcité ?
La laïcité est une belle idée : elle assure la liberté de conscience et protège le citoyen. Mais trop souvent, elle est caricaturée, utilisée comme un instrument de rejet plutôt que comme un cadre de coexistence. J’ai vu des situations où l’on réduit la religion à une affaire privée, et où l’on oublie que la foi est aussi un moteur de justice et de fraternité dans la société. La vraie laïcité devrait permettre à chacun de vivre sa foi librement, tout en respectant la liberté de l’autre. La relégation de la religion à la sphère privée peut occulter non seulement l’idéal de fraternité mais également le sens de la transcendance, du caractère sacré de la vie. On a pu penser que la société pouvait s'en dispenser, ce qui est une folie.
La montée de l'islam de France a aussi remis le fait religieux au milieu de la place publique, et il est bon qu'on puisse justement reconnaître nos valeurs, avancer, travailler. Pour moi, c'est ça le vrai dialogue interreligieux : le partage de nos valeurs pour les apporter sur la place publique afin de construire une société vraiment fraternelle.
Le président de la République vous a donné la nationalité algérienne. Vous êtes le symbole du pont entre l'Algérie et la France. Quelle a été votre réaction ?
C'est une immense fierté, un immense bonheur. Il est important que l'archevêque soit de ce pays. Sinon, l'Église est étrangère. Derrière cette reconnaissance, il y a cette volonté du Président de dire : oui, cette Église catholique a sa place ici, dans ce pays, dans ce paysage. Et il est vrai que je pense qu'elle manquerait si elle n’existait plus en Algérie. Le pluralisme fait partie de l'Algérianité.Je suis devenu franco-algérien. Car évidemment je n'ai pas renoncé à ce que j'ai reçu de mes parents, de ma culture. Je l'ai réalisé dans ces moments de tension entre la France et l'Algérie. J'ai pris conscience que c'était extrêmement difficile. Pour moi, l'histoire entre la France et l'Algérie n'est plus d’abord celle de mon Église (qui compte 40 nationalités), c’est ma propre histoire et celle des deux pays auxquels je suis attaché. J'ai réalisé que l'on peut être évidemment 100 % Algérien et aussi 100 % Français. On ne peut pas renoncer, et je m'adresse là aux millions de franco-algériens en Algérie et en France. On ne peut pas vivre dans un de ces deux pays en étranger sauf à sombrer dans une crise profonde d'identité. Notre défi, à nous franco-algériens, c'est d'être précisément absolument Algérien et absolument Français.
Quand les deux pays se déchirent, c'est une crise très profonde. C'est là où il faut résister à la tentation de la séparation et faire preuve de fraternité. On doit être d'autant plus fraternel qu'on est dans cette crise. Je combats tous ceux qui pensent que l'on ne peut vivre dans un pays d’une autre nationalité que par l'assimilation. Je refuse l'assimilation. En revanche, je crois à l'intégration qui construit, qui transforme les sociétés en y apportant le meilleur de ce que l'on peut.
Vous sentez-vous pleinement intégré dans le tissu algérien ?
Oui, mais ce n’est pas instantané : il faut du temps, de la patience et surtout de l’humilité. Je suis ici comme un témoin : témoin d’une Église, témoin d’une histoire, témoin de la société. Je ne suis pas Algérien de naissance, mais je partage leur quotidien, je célèbre avec eux, je pleure avec eux, je ris avec eux. Cette proximité transforme : elle m’apprend l’écoute, le respect et le don de soi.
Quel est votre message à adresser à la diaspora franco-algérienne ?
Je leur dirais de ne pas fuir l’histoire ni la mémoire, mais de les regarder avec franchise. Reconnaître le passé, c’est pouvoir construire ensemble un avenir meilleur. Et surtout, de ne pas se laisser enfermer dans une appartenance unique : il est possible d’être profondément attaché à l’Algérie et à la France, sans contradiction. C’est là que réside la véritable richesse de nos vies partagées.
Ce que nous avons en commun n’est pas tant un passé qu'un avenir. Nous avons un avenir en commun. Soit on essaie de se rassurer en mettant des frontières, des barrières, et on n'y arrivera pas. Soit on fait le pari justement de cette fraternité, et ça, j'y crois beaucoup. Comme disait Pierre Claverie, l'évêque d'Oran assassiné : « Nous devrions tous avoir un ami musulman. » Moi, je voudrais dire : on devrait tous avoir un ami qui est différent de nous. C'est ça qui change le monde. C'est une richesse ! Il faut prendre cette identité franco-algérienne comme une richesse.
Jean-Paul Vesco, octobre 2025
Peintures de...

