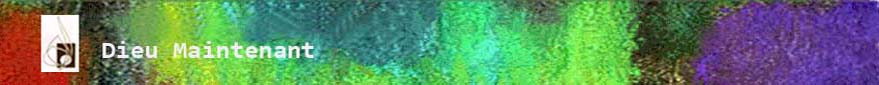

Choisir sa vie, choisir sa mort.
Droits de l’homme et droits des dieux.
Gildas Labey
Le pape François – relayé par la hiérarchie catholique – condamne le fait que chacun puisse revendiquer le droit de choisir sa mort (ainsi que celui de choisir de donner la vie). Gildas Labey analyse et conteste - au nom même de la foi au Dieu de Jésus-Christ - les arguments employés par l’Église pour justifier cette position.
Rappel : Gildas Labey a enseigné la philosophie tant en lycée qu’en université (publics et privés) ainsi qu’au centre de détention pénitentiaire de Fresnes. Une fois à la retraite, il a animé dans son village un atelier de réflexion philosophique.
« En juillet 2019 le pape François (paix à son âme), tint ce langage : « Dieu est l’unique maître de la vie du début jusqu’à sa fin naturelle et nous avons le devoir de toujours la protéger et de ne pas céder à la culture du déchet ». Par ailleurs François de Rome écrivit sur Twiter : « Une société est humaine si elle protège la vie, chaque vie, de son début jusqu'à sa fin naturelle, sans choisir qui est digne ou non de vivre. Que les médecins servent la vie, qu'ils ne la suppriment pas. » Et : « Ne construisons pas une civilisation qui élimine les personnes dont nous considérons que la vie n'est plus digne d'être vécue : chaque vie a de la valeur, toujours. » En octobre 2018, François avait qualifié de « tueurs à gages » les médecins qui pratiquent l’avortement.
À l’évidence le propos est plus qu’outrancier et, on va tenter de le montrer, philosophiquement et théologiquement inconséquent.
« Une culture du déchet » ?
Voir dans l’interruption des soins prodigués à une personne en état végétatif irréversible l’expression d’une « culture du déchet » a quelque chose d’infamant pour ceux qui en prennent la décision. Le paradigme incontestable de la « culture du déchet » doit être cherché dans le nazisme : alors oui, là on élimine les humains regardés comme des « déchets », des sous-hommes, des inutiles, des formes de vie nuisibles et dans cet univers a cours l’arbitraire monstrueux de l’« eutha-nazie ». Il faut vraiment prendre garde à ce que connotent des propos mal pensés, induisant de redoutables confusions. Car les décisions prises aujourd’hui dans le cadre de nos démocraties, de nos républiques relèvent par principe, sur les questions de fin de vie, d’une vigilance scientifique, juridique, éthique exemplaire, à l’opposé maximal de l’innommable pratique nazie. Il n’est ni insensé ni criminel d’interrompre une vie humaine devenue irréversiblement végétative, ou rigoureusement invivable par les souffrances qui la marquent, ou les handicaps qui l’étouffent littéralement.
Certes on ne choisit pas « qui » est digne de vivre ou non, mais après en avoir scrupuleusement délibéré à partir de la volonté des malades, de l’état où se trouvent ceux qui ne sont plus conscients, constatant que des « conditions de vie » artificiellement prolongées relèvent d’une obstination déraisonnable et que, pour les sujets atteints, « ce n’est plus une vie », on en tire des conséquences raisonnables. La raison, encore une fois, ne saurait être insensée, ni criminelle. Le regard porté sur l’être dont on fait volontairement cesser la vie, n’est en rien méprisant, ne le fait en rien passer de la condition d’homme à celle de « déchet ». Cet homme désormais sans vie, hors du temps, voici que nous le contemplons, à travers les larmes ou le recueillement silencieux, dans l’immobilité de son corps pétrifié et la nudité de son être, cependant que notre pensée, dans un acte de mémoire essentiel, ressaisit et honore l’être qu’il fut, et que nous viennent peut-être les paroles d’un chant : « Tout homme est une histoire sacrée… »« Quel dieu invoque-t-on et convoque-t-on ? »
Quant à invoquer le Dieu maître de la vie pour délégitimer les décisions mises en cause, il y a là une inconséquence théologique que n’importe qui, croyant ou non, peut mettre en évidence, au nom de l’exigence de rigueur et de vérité dont vit notre pensée d’humain. Bien moins que de l’amour, je verrais dans l’obstination à maintenir quelqu’un en vie à tout prix l’expression d’une toute puissance exercée sur cette vie même, devenue la proie d’une manière de fanatisme, qui conjugue l’acharnement thérapeutique, l’acharnement affectif, l’acharnement idéologique.
Car enfin quel dieu invoque-t-on et convoque-t-on ?
Parlons ici avec l’unique désir de comprendre les conditions de cohérence d’une croyance, d’une pensée, d’une conception.
On ne connaît les dieux que de nom. Leur existence n’est pas assurée. Sont-ils seulement « quelqu’un » ? On est troublé par l’aphorisme de Baudelaire : « Dieu est le seul être qui, pour régner, n’ait même pas besoin d’exister » (Fusées I). La rigueur commande l’usage du conditionnel.
Une ancienne et persistante tradition reste attachée à l’idée d’un dieu source de la vie qui, en donnant d’être et de vivre à l’homme, lui confierait la responsabilité de sa vie personnelle et collective, l’assurant de demeurer avec lui sur les chemins de sa destinée. Ce dieu là fait sens s’il est « avec » l’homme, si entre eux la relation est d’« alliance », non de soumission (ce qui peut se lire dans les deux sens), si cette alliance est elle-même, pour l’un et l’autre, toujours inquiète de sa véracité et de son bien-fondé. Lévinas va jusqu’à penser que ce dieu, s’il accorde tout gratuitement, fait droit à l’ingratitude de la créature, à son athéisme. Et si ce dieu donne vraiment, ce qui s’appelle donner – abandonner tous les droits que l’on avait sur quelque chose, en un geste gracieux, gratuit, définitif -, si ce dieu remet vraiment l’homme à son propre conseil, à son propre jugement, alors celui-ci ne peut que répondre par lui-même de sa vie, de ce qu’il en fait – et personne, pas même le dieu, ne saurait se substituer à sa responsabilité propre, pour lui-même mais aussi bien pour autrui ; là, on se rappelle la question talmudique : « Si je ne réponds pas de moi, qui répondra de moi ? Si je ne réponds que de moi, suis-je encore moi ? ».
Pour être véritable, effective, légitime, la responsabilité doit pouvoir s’exercer jusqu’au bout. Ainsi est-il nécessaire d’admettre par principe que l’homme a le droit entier de décider du jour et de l’heure de sa mort. S’il le décide, et s’il a foi en ce dieu d’alliance, alors, en cette occasion comme en toutes les autres, celui-ci, selon cette conviction, sera avec lui, jusqu’à son dernier souffle, ce dont témoignent certaines et certains qui, par exemple, en situation de suicide assisté ou d’euthanasie acceptent d’accompagner spirituellement les demandeurs. Certes, une chose est de reconnaître un droit fondamental, une autre de juger si, quand et comment il est opportun d’en user. On ne saurait assez rappeler que nul n’est obligé d’user d’un droit, et que s’il en use de façon inopportune, il suffit que cela ne soit pas de façon indigne ou abusive. Quoi qu’il en soit, toute société possède les ressources de sagesse et d’intelligence nécessaires pour fixer de justes limites, et en imposer le respect.
« En quoi ce dieu serait-il spolié de droits dont il se serait lui-même dépossédé ? »
On sait que cette pensée est frappée d’interdit par ceux qui crient au sacrilège, parce qu’une telle décision – la décision ultime, celle de maîtriser les conditions de sa mort – violerait les « droits du dieu », lui, le dieu source et don de vie. Mais ce dieu, dont on penserait que les droits seraient alors profanés, ne serait plus celui de la tradition évoquée. En quoi serait-il spolié de droits dont il se serait lui-même dépossédé ? Parmi ceux qui ne reconnaissent pas le droit de l’homme à maîtriser sa mort comme sa vie (encore que « maîtriser » soit beaucoup dire : jusqu’où maîtrise-t-on sa vie ?), qui refusent de penser que l’on puisse décider le jour et l’heure du terme et parcourir le dernier chemin de façon digne, juste et bonne, s’il en était qui, parlant ès qualités, se recommandaient néanmoins du « dieu d’alliance », ce serait véritablement incohérent. On parlerait alors d’un autre dieu. On n’ose penser à la confusion qu’ils sèmeraient, car on frémit d’imaginer qu’un dieu pût faire faussement croire à l’homme qu’il est libre et responsable de sa vie et que, au nom d’une telle confusion, des humains se donnent le pouvoir de refuser cette liberté, ce droit, cette responsabilité à d’autres. Oui, on frémit à la pensée que l’on justifierait un dieu durablement trompeur. Mais on frémit d’indignation, et là ce n’est plus une hypothèse, en rappelant, face à la sacralisation de la vie invoquée par certains au nom de la foi ecclésiale, les mensonges, les abus de confiance, les actes qui cassent, qui détruisent des vies, jeunes ou moins jeunes, qui les engloutissent sous d’odieuses emprises, toutes choses concrétisées au nom d’un dieu pervers, parce que perverti.
Au fond, la question n’est pas celle, brute, de la vie ou de la mort. Vivre, tel quel, est un fait, sans valeur, comme la mort, qui la termine. Pour un humain, doué de pensée, de sentiment, la question devient : vivre, soit, mais quelle vie ? La valeur de la vie ressortit du regard, de l’attention, du soin, du respect, de la reconnaissance que l’esprit lui porte, et de l’intensité, de la puissance que l’humain en éprouve. À quelles conditions vaut-il la peine de vivre ? Qu’est-ce que vivre et mourir dignement ? Chacune, chacun ne porte-t-il pas en soi, Dieu merci !, la capacité d’en juger de façon libre et éclairée ? (1) Gildas Labey, septembre 2025
Peintures de Soutine
1- Je dis ici ma dette envers le travail décisif de Jacques Pohier, La Mort opportune. Le droit des vivants sur leur fin de vie. Seuil. 1998l / Retour au texte

