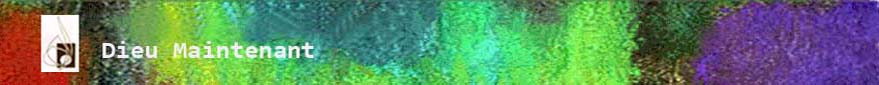

Fin de vie, suicide assisté : pourquoi j’ai changé d’avis
François Larue
François Larue est chef d'un service de soin palliatifs. Il écrit : "La question de la fin de la vie, du droit à l’euthanasie est récemment revenue en discussion au parlement. Il est normal qu’on aborde ces sujets. La fin de vie, les souffrances qui peuvent l’accompagner font peur. Mais je trouve regrettable que le débat (au cours duquel beaucoup de contre-vérités ont été dites) n’ait duré que quelques heures, saisissant stratégiquement l’opportunité d’une « niche parlementaire » ; de telles questions méritent mieux. Je m’étonne aussi des positions radicales, des affirmations selon lesquelles les français dans leur immense majorité seraient demandeurs d’une loi autorisant l’euthanasie. Ces débats sont complexes, subtiles. Comment avoir des certitudes sur de tels sujets ? Je ressens moi-même régulièrement des doutes comme le démontrent les lignes qui vont suivre."
François Larue est membre de l'équipe animatrice de "Dieu maintenant"

Il y a quelques années, à la demande de Michel Jondot et de Christine Fontaine, j’avais fait part de mon expérience à l’occasion du réexamen de la loi Leonetti. Sans revenir sur le contenu de l’article, j’avais insisté sur la complexité des décisions, la fréquence de l’ambivalence chez les patients et leurs proches, cette ambivalence pouvant revêtir plusieurs formes. Par ailleurs, m’appuyant sur une situation particulière, unique dans mon expérience, j’avais proposé une ouverture vers la possibilité de suicide assisté dans des circonstances exceptionnelles. Je me distinguais alors du mouvement des soins palliatifs et en avais bien conscience. Cette position avait conduit certains lecteurs à s’étonner de ma conclusion qui était selon les termes que j’avais employés à l’époque « personnelle et susceptible d’évoluer ».
Depuis, mon expérience s’est enrichie. Responsable d’un service de soins palliatifs, j’ai été confronté à de nombreuses situations de fin de vie. J’ai assisté à la mise en place de « sédations profondes et continues maintenues jusqu’au décès », j’en ai mesuré certains impacts, j’ai constaté des ambiguïtés. Je pense désormais que la loi est bonne et qu’il n’est pas souhaitable d’aller plus loin. Je vais essayer de m’en expliquer en abordant ce qu’elle permet, en l’illustrant de quelques situations vécues, mais en évoquant aussi la « zone grise » qui entoure cette pratique, l’exemple de confusion le plus frappant étant selon moi la sédation décidée dans « l’affaire Vincent Lambert ».
Je me prononce ici comme soignant. Volontairement, je n’évoque pas les aspects philosophiques, sociétaux et (bien entendu) politiques.Ce que permet la loi
La loi Claeys-Leonetti (2016) a apporté quelques améliorations à celle de 2005. Elle permet notamment dans certaines situations la mise en place de « sédations profondes et continues maintenues jusqu’au décès ». Clairement, de nombreuses équipes de soins palliatifs n’avaient pas attendu 2016 pour réaliser ces sédations. Mais il y a désormais un cadre légal. Pour accéder à la demande du patient, il faut réunir certaines conditions : il doit être en fin de vie, présenter une souffrance réfractaire aux traitements. La demande de sédation doit aussi être répétée et constante. La décision est prise lors d’une réunion collégiale associant notamment plusieurs médecins dont un n’est pas membre de l’équipe et n’a pas de lien hiérarchique avec celui qui prendra finalement la décision. Les choses paraissent plutôt claires. Mais vivons-les au travers de trois histoires récentes et bien réelles.
Monsieur P est insuffisant respiratoire. Depuis des années, chaque jour, il cherche son souffle. Puis on lui découvre un cancer rapidement menaçant. Des essais de traitement sont tentés mais ils ne sont pas actifs sur la maladie. Après quelques mois on renonce donc aux traitements du cancer et le patient est informé que seuls des soins palliatifs (soins de confort) lui seront désormais proposés. Bien que cette décision soit difficile, il l’accepte. Avec son accord, sa famille en est informée.Il sait que sa vie sera courte. Son essoufflement, aggravé par son cancer, est de plus en plus mal toléré malgré les traitements que nous lui proposons. Il nous demande s’il est possible de le soulager mieux, voire de raccourcir sa vie. Nous lui expliquons ce que la loi permet, qu’il est possible de l’endormir, définitivement s’il le souhaite sans intervenir sur la durée de vie restante. Nous expliquons les modalités de sédation, les soins attentifs qu’il continuera de recevoir une fois endormi. Cette proposition lui convient et nous convenons de nous donner du temps pour savoir si sa demande se confirme. Au bout de quelques jours, il apparaît que c’est bien le cas. Sa famille, informée, respecte le désir du patient. Nous organisons donc une réunion collégiale à l’issue de laquelle nous estimons que cette demande est recevable. Nous en informons le patient et sa famille.
Se met alors en place ce que l’on pourrait qualifier de rituel d’adieu. Le patient exprime le souhait que la mise en route de cette sédation soit rapide, en présence de sa famille. Nous décidons ensemble que ce sera le lendemain. Le jour venu, l’équipe se réunit une dernière fois pour s’assurer qu’il n’y a pas de réticence ou d’élément nouveau. Nous nous mettons d’accord pour savoir qui sera présent, quel sera le rôle de chacun puis nous entrons dans la chambre où se trouvent le patient, son épouse et ses deux filles. Nous leur proposons d’être au contact du patient et, après son accord, débutons la sédation. L’instauration de celle-ci prend un certain temps, 15 ou 20 minutes peut-être, période au cours de laquelle la famille et le patient expriment leur amour réciproque. Puis le sommeil s’installe et nous les laissons ensemble, leur proposant notre aide si nécessaire. Nous sortons donc de la chambre après un moment vécu comme bouleversant. Pour chacun, les larmes sont proches. Pour certains, elles coulent franchement.
Monsieur P vivra encore quelques jours sous sédation. Nous nous assurons à chaque passage qu’il n’y a aucun signe d’inconfort, nous accompagnons la famille. Puis il décède un matin au décours d’une phase agonique calme. Est-il mort plus tôt que s’il n’avait pas reçu de sédation ? C’est possible. C’est même probable. Mais l’intention n’était pas d’écourter la vie. Elle était de soulager le patient et de répondre à ses besoins.
Monsieur M a une soixantaine d’années. Il a été pilote de ligne. Il est donc plutôt habitué à maîtriser les évènements. Mais la maladie va le confronter à l’impossibilité de le faire. On lui découvre un cancer qui présente d’emblée des signes de gravité. Dans un premier temps, les traitements vont être actifs. Pendant près d’un an la maladie sera contrôlée et sa qualité de vie sera préservée. Mais elle évolue à nouveau et le patient présente une occlusion intestinale. C’est une complication difficilement supportable. Quand une opération chirurgicale est possible, elle est réalisée. Dans son cas, elle est impossible et seuls des moyens médicamenteux peuvent être proposés. L’occlusion sera contrôlée pendant de brèves périodes puis on devra finalement admettre qu’elle est définitive. Le patient est alors dans un état général encore satisfaisant mais avec un inconfort abdominal majeur. Par ailleurs il a faim mais toute alimentation normale est impossible et sentir les odeurs de repas lui est insupportable. Ce ne sont pas les crèmes et autres laitages que nous autorisons qui peuvent satisfaire son désir de manger.
Il nous fait la même demande que Monsieur P et le processus de décision décrit plus haut est respecté. Nous arrivons à la conclusion que sa demande est recevable. Mais lorsque le sujet est évoqué avec son épouse, elle exprime que cette hypothèse lui est insupportable pour de multiples raisons. Se pose alors une question éthique : le patient est libre de ses décisions mais celles-ci impactent directement son entourage. Le patient va mourir dans de brefs délais. Son épouse vivra. Il nous paraît difficile de lui imposer un traumatisme supplémentaire aux conséquences imprévisibles. Nous reprenons donc la discussion avec le patient et finissons par convenir ensemble qu’il est préférable de prendre du temps, de discuter, d’obtenir au moins que son épouse ne s’oppose pas à cette décision. C’est ce qui sera fait.
Mme D est, elle aussi, atteinte d’une maladie incurable. Prise en charge dans le service d’oncologie, un transfert en unité de soins palliatifs est demandé car elle a exprimé depuis longtemps son désir de bénéficier d’une sédation terminale. Elle est donc admise dans notre service et les discussions s’engagent. Après quelques jours, sa demande semble claire et constante et nous organisons une réunion collégiale qui en acte la recevabilité. Puis nous nous rendons dans la chambre de la patiente où se trouvent sa mère, sa fille et sa petite fille. Nous rappelons la demande qu’elle nous a faite. Nous disons notre accord pour mettre en place cette sédation si elle continue à la souhaiter, quand elle le voudra, en conservant la possibilité de tout annuler si elle le veut. Nous assistons alors à une reformulation subtile de la demande. A chaque fois qu’elle nous interroge sur tel ou tel aspect, s’assurant qu’il est possible de le réaliser, elle nous donne les arguments pour en différer la mise en place. L’entretien dure longtemps. A la fin, nous convenons que rien ne presse, que nous pouvons reprendre la discussion à son initiative. La patiente ne demandera plus jamais de sédation. Elle sera transférée quelques semaines plus tard dans un service de soins de suite oncologiques ou elle décèdera spontanément, sans avoir jamais reparlé de sédation.
Que retenir de ces trois situations vécues ?
Dans le cas de Monsieur P, la situation était véritablement bouleversante. En mettant en route la sédation je m’interrogeais. Une aide active à mourir est sans doute un acte transgressif. Ce n’est pas ce que nous avons fait mais bien que convaincu de répondre au besoin du patient et d’avoir respecté les étapes du processus de décision, j’avais également l’impression de réaliser un acte transgressif en éteignant la conscience de ce patient dans cette ambiance, face à cet amour exprimé, déchirant. Cette impression s’est renforcée lors du décès du patient survenu vraisemblablement un peu plus tôt qu’en l’absence de sédation. Pour Monsieur M, l’impact de la décision sur son épouse était majeur. La fin de vie d’un proche est une expérience traumatisante. Il est essentiel de mesurer les conséquences des décisions sur l’entourage même si elles concernent avant tout le patient. Madame D nous a donné une belle démonstration d’ambivalence dont on ne mesure pas assez la fréquence et la puissance.
La « zone grise »
C’est, je crois, le Professeur Robert Zittoun, hématologue et pionnier des soins palliatifs, qui a évoqué le premier cette « zone grise » qui recouvre la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès (SPCMJD).
Schématiquement, on oppose l’aide active à mourir qui abrège la vie et la SPCMJD dont le but est de retirer la conscience d’un patient percevant sa situation comme insupportable. La SPCMJD est autorisée par la loi dans les conditions que nous avons décrites. Les soins palliatifs sont compatibles avec cette pratique. De nombreuses équipes en ont l’expérience et celle-ci est parfois bien antérieure à la loi de 2016. Dans le cas de la SPCMJD l’intention n’est pas d’abréger la vie tout en ayant conscience que la durée de vie sous sédation peut être plus courte qu’en son absence. On voit bien là la subtilité et la complexité de ces pratiques. Qui peut affirmer que sous couvert de SPCMJD, des pratiques visant à abréger la vie ne sont pas mises en place ?
Un exemple de confusion nous a été récemment donné par la dramatique « affaire Vincent Lambert ». Je ne reviens pas sur l’histoire connue de tous. Au-delà de la souffrance de cette famille, je n’ai cessé de me poser deux questions qui selon moi n’ont pas reçu de réponse satisfaisante :
On a évoqué pour le cas de ce jeune homme une prise en charge palliative en unité spécialisée. Je travaille dans cet univers depuis longtemps et y ai rencontré essentiellement des patients atteints de maladies évolutives, en fin de vie ou souffrant de symptômes mal contrôlés. D’autres séjournaient dans le service pour permettre un répit aux aidants. Certes je ne connais pas tous les services de soins palliatifs mais j’imagine que c’est la grande majorité des patients qu’on y accueille. Je n’ai donc aucune expérience d’une telle situation qui me paraît plutôt relever de services prenant en charge des patients souffrant de traumatismes neurologiques majeurs. Dès lors les soins adaptés sont-ils des soins palliatifs ou des soins spécifiques de ces patients dont certains sont pauci-relationnels comme Vincent Lambert ? Il est arrivé que des médecins rééducateurs s’expriment. Certains estimaient que ce type de prise en charge relevait plutôt de leur compétence.
On connait la longue cascade judiciaire de cette cruelle histoire. Quand tous les recours ont été épuisés, il a été décidé de cesser toute alimentation et… de mettre en place une sédation… chez un patient dont les experts avaient assuré qu’il n’était pas conscient ! Je ne sais pas quelle réflexion cette décision vous inspire. Personnellement je l’ai vécue ainsi : si on avait voulu introduire une confusion entre sédation et aide active à mourir, on ne s’y serait pas pris autrement.
Pourquoi j’ai changé d’avis
Dans mon précédent article, j’avais évoqué le cas d’une patiente qui souhaitait bénéficier d’une aide active à mourir. La loi l’interdisant, elle avait estimé qu’il lui était impossible d’en parler à ses proches. A l’entendre, et s’appuyant sur des exemples, elle pensait les mettre en danger si elle partageait avec eux toute discussion sur ce projet : ne pourraient-ils être accusés de complicité et être donc sous le coup de la loi ? En conséquence, elle s’était enfermée dans une solitude dont elle a souffert jusqu’à sa mort.
J’évoquais une ouverture de la loi, dans des limites strictes, permettant (c’était une hypothèse) que la parole circule. Je reprends les mots de Michel Jondot dans la discussion qui suivait l’article : « … La question - à laquelle je n'ai pas de réponse - est d'un autre ordre. Comment la loi peut-elle permettre que la parole soit maintenue jusqu'au bout et qu'ainsi la vie reste humaine ? Une loi qui permet la vie ne vaut-elle pas mieux qu'une loi qui interdit la mort ?... Pas plus que le Docteur Larue, je n'ai de réponse. Mais je trouve qu'une belle question est posée. »
La loi fixe des limites dans une société. Je pense désormais que la relation humaine, thérapeutique, doit être suscitée, recherchée, entretenue, mais qu’elle est indépendante de la loi. J’ai pu observer à quel point il pouvait parfois être difficile d’établir un lien de confiance. Certains obstacles tiennent à nous, d’autres à celui ou celle qui nous fait face. Je n’étais pas en charge de cette patiente et n’aurais peut-être pas fait mieux que ceux qui l’ont traitée. Mais je suis désormais convaincu que cette question n’a pas de rapport avec la loi.
La limite fixée par la loi Claeys-Leonetti est claire. Elle est, on l’a vu, « floutée » d’une zone grise. A mes yeux, la repousser n’est pas opportun et peut être dangereux. Les débats philosophiques et sociétaux se poursuivront. Mais il faut être conscient qu’ouvrir à la possibilité d’une aide active à mourir expose au risque de dérives comme semblent le montrer les exemples de pays ayant franchi ce pas, notamment la Belgique (voir la web-conférence référencée ci-dessous). Les mécanismes de contrôles supposés les éviter sont systématiquement présents dans les textes mais ne sont pas toujours appliqués…
Pour conclure, je dirais que mon expérience m’a conduit à préciser ma pensée. Concernant la fin de vie, la loi actuelle me paraît adaptée. Ce qu’elle permet me semble avoir répondu aux besoins des patients et des familles que j’ai accompagnés. Certains diront qu’elle est insuffisante, qu’elle ne prend en compte que les situations terminales et n’aborde pas assez les souffrances des autres patients. J’entends ces critiques et les respecte.
Si le débat doit revenir devant le parlement, ce qui est probable, il est souhaitable qu’il bénéficie d’un temps et d’une réflexion suffisants. Il faudrait, mais est-ce possible, qu’il soit raisonné, apaisé plus que militant. Il est aussi nécessaire qu’il s’appuie sur des études aux méthodologies rigoureuses et non sur les résultats spectaculaires de sondages difficiles à croire quand on s’intéresse depuis longtemps à ces questions.
François Larue, le 5/5/2021
Peintures de Giacometti
La SFAP (Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs), est beaucoup intervenue en amont des débats parlementaires. Les réflexions qu’elle a conduites sont accessibles sur youtube : web-conférence « proposition de loi : et maintenant on va où ? »
