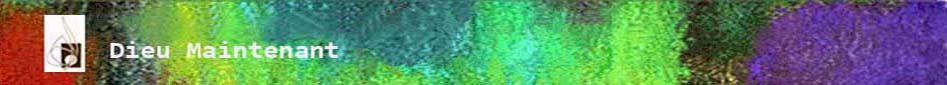

La Bretagne, laboratoire de l’agro-industrie - 2
« Champs de bataille, l’histoire enfouie du remembrement »
Julien Lecomte
Après le remarqué « Algues vertes, l’histoire interdite », paru en 2019, les deux auteurs Inès Léraud (journaliste) et Pierre Van Hove (dessinateur), assistés du concours du doctorant en histoire Léandre Mandard, se sont penchés sur l’histoire du remembrement (1). Si cette opération a concerné de nombreuses régions françaises, la Bretagne reste celle qui l’a subie le plus violemment, avec des conséquences majeures sur les plans économiques, sociaux et écologiques, plus que jamais d’actualité.

Le remembrement : une histoire à exhumer
Le regard rétrospectif est souvent considéré comme porteur d’un jugement facile, car décontextualisé des enjeux d’une époque : « C’est trop facile de juger après-coup », peut-on entendre. Tout l’intérêt de ce documentaire graphique est d’exhumer la violente conflictualité qui s’est manifestée lors des remembrements, ses drames humains, et déjà la présence de personnes qu’on nommerait aujourd’hui des « lanceurs d’alerte », à l’origine de la création des premières associations de défense de l’environnement. En effet, le titre l’exprime bien : « Champs de bataille ». Car c’est bien d’une bataille, perdue pour la petite paysannerie, dont il s’agit. Mais elle a aussi conduit aux regrets certains de ses plus importants acteurs, comme l’ancien ministre de l’agriculture Edgard Pisani, ou même à des conversions spectaculaires, comme celle de l’agronome René Dumont, premier candidat écologiste à l’élection présidentielles de 1974, après avoir été un fervent défenseur de l’hyper-rationalisation agricole. Le grand mérite de cet opus est donc de révéler une histoire qui n’a jamais été faite jusqu’à présent, contredisant sérieusement l’idée fausse que l’ensemble du monde paysan accepta sans broncher le remembrement.
Aux origines du remembrement
Le remembrement n’est pas en soi un principe néfaste, au contraire. La propriété foncière agricole des très nombreuses petites fermes qui composaient la France rurale jusqu’à l’Après-Guerre était morcelée et dispersée. Le principe est alors simple : en regroupant les terres autour de chaque ferme par un système d’échange de parcelles, et en améliorant la qualité des accès à ces dernières, on pouvait diminuer la pénibilité du travail agricole, pour avantager tant la productivité que les conditions de vie de la paysannerie. De plus, au début du XXe siècle, le développement des transports modernes favorise l’importation de denrées en provenance d’Amérique du Nord, au coût moindre, bouleversant l’économie agricole française. Ainsi, à partir des premières années 1900, des ingénieurs agronomes souhaitent expérimenter des méthodes d’agrandissement parcellaire, avec le recours aux fertilisants de synthèse, suite à leurs observations de ce qui est déjà mis en place en Allemagne et en Autriche. Mais ils se heurtent à l’hostilité des propriétaires : c’est un échec. Le remembrement n’était pas à l’origine destiné aux régions bocagères comme la Bretagne ou le Limousin, mais à celles disposant déjà d’un système de cultures en champs ouverts (openfield). La reconstruction qui suivit la Grande Guerre ouvrit la relance de ce type d’aménagement dans les vastes plaines fertiles du Nord-Est, ravagées par le conflit. Les ingénieurs obtiennent une première loi en leur faveur dès 1918. Mais sa mise en application piétine. Or, singulièrement, c’est le gouvernement de Vichy qui va permettre son décollage, de manière autoritaire, et sous la pression de l’occupant allemand qui souhaite faire de la France son grenier à blé. Ainsi, à rebours de son idéologie néo-agrariste, c’est bien le régime du maréchal Pétain qui va donner l’impulsion décisive orientant ensuite toute la politique agricole de l’Après-Guerre. Les acteurs majeurs de cette politique lancée sous le régime de Vichy, comme les présidents de coopératives et les hauts fonctionnaires, seront reconduits dans leurs fonctions dès les années 1950. De nouveaux acteurs apparaissent, à l’image de Jean Monnet, partisan d’une industrialisation de l’agriculture sur le modèle nord-américain.

Une histoire violente
Retardée, la France de l’Après-Guerre a un âpre besoin de se moderniser. Peu de temps après son arrivée au pouvoir comme premier président d’une nouvelle république, Charles de Gaulle convoque un conseil de hauts-fonctionnaires et de grands patrons pour proposer des orientations fortes afin de faire rentrer la France dans le concert des nations industrielles. La modernisation agricole, portée par une véritable « mystique du progrès », est désignée comme l’un des axes majeurs à suivre. L’agriculture bretonne, considérée archaïque dans une région encore très rurale, en sera l’une des principales cibles.
Engagé de manière dirigiste au début des années 60, le remembrement est mené avec violence : sur les milieux naturels, les paysages, les paysans et leurs animaux conduits à l’abattoir. Dès les premières opérations, de vives contestations émergent. Beaucoup de petits propriétaires s’opposent à la confiscation de leurs parcelles, et accusent leurs pairs participant aux commissions de remembrement de s’accaparer les meilleures terres. Des familles se déchirent, des voisins qui s’entraidaient jusqu’alors ne se parleront plus jamais. Face aux mouvements de révolte, des compagnies de CRS sont envoyées pour protéger les bulldozers qui arasent les haies et talus, comblent les mares et recalibrent les cours d’eau en tracés rectilignes. Mais la liquidation de la petite paysannerie est déjà programmée. Les recours, souvent rédigés dans un français approximatif, sont tous rejetés. Lorsque le bâton ne suffit pas, c’est alors la carotte de l’incitation financière à l’abandon de la ferme. Les paysans encore en âge de travailler sont embauchés dans les usines de transformation agroalimentaire, les services administratifs agricoles, ou l’industrie. Citroën s’implante près de Rennes en 1960. Un an plus tard, 70 % de son effectif est issu d’un transfert de main d’œuvre agricole. Le directeur en chef des usines Citroën met directement au point avec les préfets des départements bretons un mécanisme contraignant à l’abandon de toutes les petites fermes afin de recruter pour ses chaînes de montage.
Un seul chiffre résume à lui seul la destruction de la petite paysannerie : de 1946 à 1962, le nombre de paysans et de salariés agricoles passe de 7 à 3,8 millions. C’est le plus grand « plan de licenciement » que la France n’ait jamais connu jusqu’à présent.Les promoteurs et les opposants
Le remembrement a été porté par les syndicats productivistes réunis sous la bannière de la FNSEA, eux-mêmes dirigés par des grands propriétaires, présents dans tous les rouages de l’agriculture (chambres consulaires, coopératives, banques, etc.), et tenants inconditionnels de l’industrialisation agricole. Mais les autres acteurs du remembrement ont été calibrés et surtout incités financièrement à le faire : les cabinets de géomètres-experts et les ingénieurs de l’État, qui recevaient des primes aux surfaces de terres remembrées, pouvant doubler leur traitement annuel. Il faut noter également la promotion par les milieux catholiques, tout particulièrement la JAC (Jeunesse Agricole Chrétienne), très implantée en Bretagne, et dont les cadres avaient été formés à la même école que les technocrates de l’agro-industrie.
Un des autres effets du remembrement a été la réattribution des terrains à des usages non agricoles. Les propriétaires ont alors fait de confortables plus-values en les revendant en parcelles à bâtir, lors de l’explosion de la construction pavillonnaire des années 60-70.
Les oppositions, d’abord spontanées, ont commencé à se structurer à partir de la fin des années 60 et surtout durant les années 70. Au-delà des clivages politiques, on a vu s’unir des paysans catholiques de droite, hostiles au remembrement, et des militants aux cheveux longs, tandis que des maires laïques de gauche voyaient dans ces opérations un véritable progrès à soutenir.Les affrontements avec les compagnies de CRS ont été fréquents. Plusieurs militants ont subi des internements psychiatriques abusifs, et certains en sont ressortis définitivement brisés. Mais les opposants reçurent aussi le soutien croissant d’universitaires, de scientifiques et de juristes qui prenaient de plus en plus conscience des dégâts écologiques et humains du remembrement.
C’est aussi dans ce contexte que les premières associations de défense de l’environnement se créent, comme « Eaux et Rivières de Bretagne », devenue majeure dans la région, fondée en 1969 par Jean-Claude Pierre, pêcheur passionné, s’inquiétant de la disparition rapide des saumons dans les rivières bretonnes, une des conséquences de l’industrialisation de l’agriculture.Quel bilan ?
Le remembrement n’aura finalement pas tenu ses promesses. Dès les années 60, l’anthropologue Michèle Salmona décrit les effets sanitaires et psychologiques néfastes de l’industrialisation agricole sur les paysans : stress permanent engendré par leur endettement, dépression, perte de confiance en soi, accidents du travail, maladies et suicides.
La prospérité des agriculteurs, tant promise, est bien mise à mal comme le montre leur situation actuelle. Surendettés, soumis à la concurrence du libre-échange, pressurisés par les normes, coincés dans un système agro-industriel très contraignant, bien des agriculteurs, réduits désormais à moins de 2% de la population active, ne s’en sortent plus. Bien que possédants des machines énormes, et des superficies très étendues, ils vivent moins bien que leurs parents et leurs grands-parents paysans. La profession est dramatiquement touchée par les suicides.
Du côté de l’environnement, les dégâts causés il y a plus de cinquante ans nous présentent la facture : érosion des sols, inondations, disparition de la biodiversité, banalisation des paysages, pollutions rémanentes, marées vertes… Et c’est la collectivité qui, une nouvelle fois, en paye le prix. Des opérations de restauration des milieux sont menées, mais il en faudrait beaucoup plus pour réparer ce massacre. Ajoutons que non seulement les conséquences du remembrement sont supportées par l’ensemble de la société, mais que c’est elle aussi qui l’a financé. En effet, les travaux d’arrachage et d’arasement étaient subventionnés à hauteur de 80% par les pouvoirs publics. C’est un gâchis considérable d’argent.
Une conclusion radicale sur cette opération a été formulée par l’un de ses plus ardents promoteurs, l’ancien ministre de l’Agriculture Edgard Pisani, lors d’une interview radiophonique en 2009 : « J’ai favorisé le développement d’une agriculture productiviste, ce fut la plus grosse bêtise de ma vie ».
C’est bien le productivisme (agricole) qui est ici en cause. Car si cet ouvrage s’inscrit dans une critique du capitalisme, il est important de rappeler que la logique productiviste s’est produite avec les mêmes effets mortifères dans les économies collectivistes (2). Les dégâts écologiques et humains de l’agriculture soviétique sont au moins aussi importants, et même sans doute pire, que ceux de l’agro-industrie capitaliste. Semblable aux deux revers d’une seule médaille, le productivisme agricole capitaliste ou collectiviste aura produit les mêmes effets.
Julien Lecomte, Octobre 2025
Peintures de Pierre Meneval

1- « Algues vertes » a fait l’objet d’une recension dans un article précédent sur ce site. Ce second documentaire graphique consacré à l’agriculture et l’environnement est le suivant : LÉRAUD, Inès, VAN HOVE, Pierre, Champs de bataille, l’histoire enfouie du remembrement, Paris, Delcourt / La Revue Dessinée, 2024 (avec le concours scientifique de Léandre Mandard, conseiller historique) / Retour au texte
2- Voir à ce sujet notre article : questionsdecologie2.html / Retour au texte

