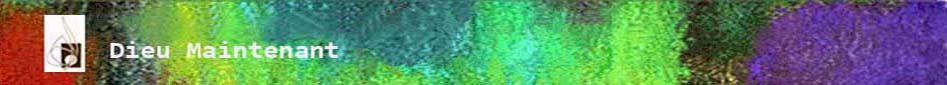

« En vérité, je vous le dis… Écoutez ! » (1)
Christine Fontaine
En relisant la parabole du semeur, Christine Fontaine constate que Jésus déplace ses disciples du sens premier de ce qu’il dit – une histoire bien connue de paysans et de graines - vers cet indicible mystère de sa Parole qui n’a rien d’autre à dire ni à faire que de permettre l’Ouverture à l’Autre au sein de l’humanité et de produire l’écoute mutuelle. C’est ce déplacement sans doute qu’il nous faut opérer si nous voulons demeurer les bons entendeurs à qui la prédication de Jésus promet le salut. Mais, plutôt que de se laisser déplacer, nombre de croyants ne préfèrent-ils pas écouter des Maîtres, des Pères – ou un Saint-Père - qui sauront leur dire enfin ce qu’il faut écouter et ce qu’il faut faire ?
Pourquoi leur parles-tu en parabole ?
De multiples passages d’évangile décrivent les foules nombreuses qui ont suivi Jésus durant sa vie terrestre, dont celui que l’on trouve en Matthieu 13 (2): « En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s’assit au bord de la mer. Et des foules nombreuses s’assemblèrent auprès de lui, si bien qu’il monta dans une barque et s’assit ; et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla de beaucoup de choses en paraboles » (Mt 13, 1-2).
La foule est si dense que Jésus est obligé de prendre de la distance pour que sa parole puisse porter auprès de tous. Qu’a-t-il à leur dire de tellement important ? Il leur raconte une histoire de semeur qui laisse tomber ses graines un peu n’importe où. Dans ce monde paysan, tous les auditeurs de Jésus savent que les graines qui tombent au bord d’un chemin vont être mangées par des oiseaux, celles qui tombent sur des endroits rocheux lèvent très vite mais n’ayant pas de racines profondes vont se dessécher au soleil, celles qui tombent sur les épines vont être étouffées. Cette histoire n’a aucun intérêt pour personne. Jésus ne leur dit rien d’autre que ce qu’ils savent déjà et il conclut : « Entende qui a des oreilles ! » Il n’y a rien d’autre à entendre que ce que tout le monde dans cette foule sait déjà. Jésus prend de la distance pour que sa parole puisse porter alors que ce qu’il dit n’apporte rien que l’on ne sache déjà.
Si le lieu d’où parle Jésus – une barque - se distingue nettement de celui des foules qui se tiennent sur le rivage, on ne sait rien de la place des disciples jusqu’à ce qu’ils s’approchent de Jésus pour lui poser une question : Les disciples s’approchant lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » (Mt 13,10). Qu’est-ce qui permet à ceux-là de penser qu’il s’agit d’une parabole et non de propos insignifiants ? Uniquement le fait que c’est Jésus qui les prononce. L’insignifiance des propos les tourne vers celui qui les énonce et les pousse à l’interroger. En fait cette distance, figurée par la barque, était un appel que Jésus adressait à tous de s’approcher de lui, un appel à l’interroger, à devenir ses interlocuteurs. Leur question est la réponse à un appel qui les précède. C’est en cela que les disciples se distinguent des foules.
L’étymologie de parabole vient du grec para qui signifie à côté et de balein qui signifie envoyer. Parler en parabole, c’est parler à la limite, à côté, refuser d’en rester fixé à l’image. Parler en paraboles fait éclater la signification qui fixe le sens et les choses, le sens comme une chose. « C’est que, répondit Jésus, à vous il a été donné de connaître les mystères du Royaume des Cieux, tandis qu’à ces gens-là cela n’a pas été donné » (Mt 13,11). Connaître des mystères, est un oxymore. C’est connaître l’inconnaissable, faute de quoi ce ne serait plus des mystères. C’est accéder à l’inconnaissable sans jamais le réduire à du déjà connu. Le fait que les disciples considèrent que les paroles de Jésus ont nécessairement un sens mystérieux manifeste qu’il leur a été donné déjà d’entrer dans le mystère d’autres paroles prononcées par Jésus. Quant à leur sens caché, à cette heure, ils en ignorent tout. Ce n’est que par la suite que Jésus les introduira dans l’écoute de cette parabole.« C’est pour cela que je leur parle en paraboles : parce qu’ils voient sans voir et entendent sans entendre ni comprendre. » Les foules – ces gens-là – voient Jésus et l’entendent. Mais qu’entendent-ils ? En fait, peu leur importe ce que dit Jésus. Ce qu’ils voient est que cet homme a du succès : il attire beaucoup de monde et, par conséquent, il est sûrement bon d’être avec ceux qui le suivent. Dietrich Bonhoeffer, un théologien protestant qui vivait dans l’Allemagne nazie, décrit un immense malheur qui est en train de s’abattre sur le monde. Ce malheur, il l’appelle l’idolâtrie du succès :
« Il suffit que la figure du vainqueur s’impose visiblement avec un éclat particulier pour que les masses succombent à l’idolâtrie du succès. Elles deviennent aveugles au juste et à l’injuste, à la vérité et au mensonge, à la bienséance et à la vilenie… Le succès devient le bien tout court. Attitude qui n’est authentique et pardonnable que dans un état d’ivresse. Une fois qu’on est dégrisé, on ne s’y maintient qu’au prix d’une profonde fausseté intérieure, en se mentant délibérément à soi-même. (3) »
« Pour ces gens-là » dit Jésus à ses disciples en leur parlant des foules qui le suivent. Pour les masses, écrit Bonhoeffer. Au temps de l’Allemagne nazie, c’est à un peuple écrasé par le remboursement des dommages de la Grande Guerre qu’Hitler parlait. Au temps de Jésus, le peuple juif est écrasé par l’occupant romain et par ceux qui, du sein de leur peuple, pactisent avec lui. Les foules voient en Jésus le leader charismatique envoyé par Dieu, capable de les libérer des forces d’occupation. La réussite se mesure pour eux au nombre de ses partisans. Peu importe le juste ou l’injuste, la vérité ou le mensonge, l’intérêt ou l’insignifiance de ce qu’il dit. Pour ces gens-là, déclare Jésus, « s’accomplit la prophétie d’Isaïe qui disait : ‘Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas ; vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. C’est que l’esprit de ce peuple s’est épaissi…’ » (Mt 13, 14-15a).« En vérité, je vous le dis… Écoutez ! » (Mt 13, 17a et 18b)
« Quant à vous, heureux vos yeux parce qu’ils voient ; heureuses vos oreilles parce qu’elles entendent. En vérité je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l’ont pas entendu ! Écoutez donc, vous la parabole du semeur » (Mt 13, 16-18). Jésus n’est pas le leader charismatique qu’espèrent les foules. Sa parole ne s’adresse qu’à quelques-uns. Avant d’introduire ses disciples dans l’écoute de cette parabole, Jésus agrandit leur désir d’accueillir ce qu’il va leur dire. Cela répond à ce que bien des justes et des prophètes auraient désiré voir et entendre. Ce qui va être dit est d’un autre ordre qu’une parole de gourou et beaucoup plus important que ce que bien des prophètes ou des justes ont déjà vu ou entendu. Autrement dit, ce qu’ils voient et entendent est inédit et inouï.
Et que leur dit-il ? Il leur parle… de la Parole, de son parcours et des obstacles qu’elle rencontre dans l’humanité. Autrement dit, il leur dit ce qu’il est en train de faire. Il leur parle de ce qui se passe sous leurs yeux à cette heure où il s’est assis dans une barque afin que, de cette foule indistincte, émergent quelques disciples. Ce qui est semé sur tous les terrains – bord du chemin, ronces, épines ou terre fertile – est la même parole partout : la Parole du Royaume (Mt, 13,19). Des foules, aussi nombreuses soient-elles, représentent une masse anonyme et indifférenciée. Elles ne forment pas un Royaume. Pour passer d’une humanité en masse à un Royaume, il faut une loi qui organise les relations entre les uns et les autres. La Loi du Royaume c’est la Parole que Jésus est en train de proférer : « En vérité, je vous le dis… » (Mt 13, 16). Il parle en vérité puisqu’il dit ce qu’il fait. Mais l’efficacité de sa parole dépend de l’écoute qu’on lui accorde. La Loi de ce Royaume n’est donc pas seulement celle de la Parole mais celle de la Parole et de l’Écoute. La Parole ne fera ce qu’elle dit que si elle est écoutée : « En vérité, je vous le dis… Écoutez… » (Mt 13, 16…18).« Quelqu’un entend-il la Parole du Royaume sans la comprendre, arrive le Mauvais qui s’empare de ce qui a été semé dans le cœur de cet homme : tel est celui qui est semé sur le bord du chemin » (Mt 13, 19). Comprendre une parole qui ne parle de rien d’autre que du trajet de la Parole dans une existence humaine ne peut signifier qu’on ait à chercher des explications ou des raisons extérieures à cette parole. En fait, il n’y a rien à comprendre, seulement à retenir toutes ces choses en son cœur. « Celui qui a été planté dans la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et la comprend : celui-là porte du fruit et produit tantôt cent, tantôt soixante, tantôt trente » (Mt 13,23). Le fruit que porte celui qui laisse cette Parole ouvrir des chemins en son cœur provient de ce qui a été semé en lui : il produit à son tour des paroles nées de cette écoute ou un silence qui parle au cœur. Il rejoint le désir le plus profond de chacun d’être considéré pour ce qu’il est en vérité : un sujet digne de parole et d’écoute par-delà tout ce qu’il dit.
« En vérité, je vous le dis… Écoutez ! » (Mt 13, 17a et 18b)
Telle est la Loi du Royaume.
L’écoute dépasse le référent (les choses qu’on dit), fait entrer en un autre lieu. Le récit amène les disciples à se déplacer, à s’approcher du lieu d’une parole inédite et inouïe : d’une parole qui ouvre chaque disciple à l’écoute de ce je ne sais quoi dont on ne peut rien dire et qui excède tout ce qui est dit. Jésus déplace ses disciples du sens premier de ce qu’il dit – une histoire bien connue de paysans et de graines - vers cet indicible mystère de sa Parole qui n’a rien d’autre à dire ni à faire que de permettre l’Ouverture à l’Autre au sein de l’humanité et de produire l’écoute mutuelle. C’est ce déplacement sans doute qu’il nous faut opérer si nous voulons demeurer les bons entendeurs à qui la prédication de Jésus promet le salut. La vérité à laquelle nous mène la lecture de cette parabole dépasse la réalité de ce que les mots communiquent. Nous voici invités à reconnaître la vérité non plus dans l’adhésion à un contenu. Nous voici invités à reconnaître ce qui à la fois précède les mots ou les choses de la foi, mais aussi les excède et les traverse. Nous voici invités non pas à tenir la vérité mais à vivre en vérité, là où se jouent la parole et l’écoute.
« Le langage (qui reçoit Dieu) ... à mesure qu’il est dit, ne fait que périr pour que naisse le sens. Si le sens s’immobilise, dogmatique, le langage est mort. Les formules sont des idoles, les conclusions sont des idoles... » Jean GrosjeanAu commencement était le Verbe (Jn 1,1)
« Au commencement était le ‘logos’ » (Jean 1,1). On traduit le mot « logos » par « Verbe » ou « parole ». Jean Grosjean, helléniste et poète, préfère entendre : « Au commencement était le langage et le langage était chez Dieu. » Le langage est ce qui permet de sortir de soi pour s’adresser à autrui. En Dieu, chez Dieu, le Fils sort de Lui-même pour s’adresser au Père et le Père se tourne vers le Fils ; entre l’un et l’autre, l’Esprit est le souffle qui permet le fonctionnement du langage et le lien de l’un à l’autre. Le langage est la demeure de Dieu en humanité. Dieu n’existe pas en lui-même. Ou plutôt exister en soi-même n’existe pas chez Dieu. Il est, au cœur de l’humanité, cet immense appel à être écouté – c’est-à-dire reçu - par-delà tout ce qui est dit.
Si le langage est la demeure de Dieu, tout langage n’est pas de Dieu. La parabole du semeur est suivie d’une autre : celle du bon grain et de l’ivraie. « Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme ; le champ c’est le monde ; le bon grain ce sont les sujets du Royaume ; l’ivraie, ce sont les sujets du Mauvais » (Mt 13, 17-18). Une vie humaine se distingue radicalement des autres formes de vie en ce qu’un un enfant (du latin in-fans, "non-parlant") est un petit d’homme qui ne parle pas encore. Il lui faudra apprendre à parler pour accéder pleinement à l’humanité. Le langage fait les sujets humains. Tout ce qui touche au langage concerne toujours le sujet, l’identité de chacun au plus profond de lui-même. Le langage ne peut faire de nous des sujets de parole et d’écoute que si rien ne peut nous contraindre à en faire cet usage. Ce ne peut être qu’un choix qui suppose de pouvoir faire le choix contraire : utiliser le langage comme instrument de domination. En effet, toute contrainte à vivre dans l’entretien ferait à l’instant même sombrer le langage en moyen de pression. Le langage comme lieu d’émergence des sujets comporte intrinsèquement la possibilité de l’utiliser pour aliéner voire tuer les sujets.
« Le champ c’est le monde… l’ivraie ce sont les sujets du Mauvais » Dans ce monde-là, les sujets sont maintenus ensemble par quelqu’un ou quelque chose, en tout cas par une instance qualifiée de Mauvais. Mais où est l’instance qui maintient les sujets du Royaume ? On pourrait s’attendre à ce qu’au Mauvais de ce monde-là s’oppose le Bon du Royaume : quelqu’un, quelque chose, une instance qui tiendrait ensemble les sujets. Dans le Royaume dont parle Jésus, les sujets ne sont maintenus ensemble par aucune instance. C’est un Royaume sans roi. Sur cette terre sa place doit demeurer vide. La Bible, au livre de Samuel, raconte l’épisode où le peuple d’Israël supplie Samuel de leur donner un roi afin d’être comme tous les autres peuples (4) :
Cela déplut à Samuel qu'ils disent : « Donne-nous un roi pour nous juger », et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel : « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. (…) Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. » Il annonce au peuple l’esclavage que le Seigneur lui a décrit s’ils persistent dans leur volonté qu’un roi règne sur eux. Mais le peuple s’obstine : « Cela ne fait rien, dirent-ils, il y aura quand même un roi sur nous, et nous aussi nous serons pareils à toutes les nations... » Alors l’Éternel céda.
Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, n’a pas cédé. Il a mené ceux qui l’ont suivi à un Royaume dont la seule loi est celle de l’écoute mutuelle. Autrement dit, un royaume dans lequel on ne se réunit pas autour de quelqu’un dont la fonction sacrée permettrait aux sujets de constituer le peuple de Dieu. Dans le Royaume dont parle le Christ, la place du roi doit demeurer vide. De même qu’un petit d’homme doit apprendre à parler, de même le Christ apprend à ceux qui le suivent à parler la langue de Dieu. Il s’efface pour qu’ils en viennent à parler à leur tour en son nom. Le langage de Dieu est une parole dans laquelle le sujet s’engage : une parole qui fait ce qu’elle dit. Un sujet du Royaume se reconnaît au fait qu’il ne change pas de cap en fonction du succès ou de l’échec qu’il rencontre. Il ne parle pas pour défendre ses propres intérêts. Il est sans feintise : il ne fait pas comme s’il était à l’écoute des autres alors qu’il cherche à les mener à lui. La langue de Dieu est parlée par bien d’autres que des croyants. Le propre des croyants est de reconnaître le langage de Dieu partout où des femmes et des hommes vivent dans cet esprit.
On prétend souvent que ceux qui veulent régner s’imposent à des sujets qui, pour leur part, n’ont d’autre choix que d’obéir au chef. Mais n’est-ce pas le peuple qui a demandé à Samuel que Dieu lui donne un roi ? Est-il permis de penser qu’il n’est pas si facile qu’on le prétend pour un peuple de se passer d’un roi ?
« Par bonheur, je suis apaisé quand quelqu’un décide pour moi. Je perds ma liberté intérieure, mais je ne souffre plus d’indécision. C’est ainsi qu’on peut aimer la servitude qui nous libère de l’angoisse du choix. Le danger de la soumission heureuse, de la perte tranquillisante de la liberté, c’est qu’on voit un monde de plus en plus clair, puisqu’on n’a plus à hésiter. « Je sais maintenant où me diriger », dit celui qui était torturé par le doute. » Boris Cyrulnik (5)
Christine Fontaine, mars 2025
Peinture de Nicolas de Staël
1- Matthieu 13, 17a et 18b / Retour au texte
2- On trouve cette scène en Matthieu 13, 1-23. / Retour au texte
3- Cité dans Ferdinand Schlingensiepen Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945 Biographie, Éditions Salvator 2015 / Retour au texte
4- On trouve cet épisode au premier livre de Samuel 8, 1-22 / Retour au texte
5- Boris Cyrulnik Le laboureur et les mangeurs de vent, Odile Jacob 2022 / Retour au texte

