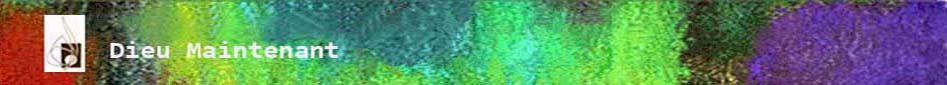

Le féminin et le sacré
Julia Kristeva
« Le féminin et le sacré » est le titre d’un grand entretien avec Julia Kristeva, donné à l’occasion de la parution de son dernier livre sur Colette. Elle dit : « J’avais titré le livre que j’ai écrit sur Thérèse d’Avila, une grande figure du sacré chrétien, "Thérèse mon amour". Je ne répéterai pas ce titre pour mon livre sur Colette – même si c’est le fond des choses. Le titre en est "Colette, une nouvelle mystique". Entre Colette qui se revendique athée et Thérèse d’Avila, Julia Kristeva reconnaît le même mouvement de dépassement du religieux et la même dénonciation de ses abus.
Nous ne pouvons retenir ici les longs développements que Julia Kristeva fait de l’écriture de Colette. Vous les trouvez dans la vidéo dont sont extraits les passages que constituent cet article : https://www.youtube.com/watch?v=TrPMlp1Qam0

« Le sacré… une marge qui révèle le cœur, basculant et bousculant les dogmes religieux ? »
Pour mieux situer la force et l’originalité de l’écriture colettienne, je rappellerai trois modalités que nous autres êtres parlants avons élaborées pour nous protéger de la violence et pour trouver du sens à la vie. Ces trois étapes sont le sacré, le religieux et l’expérience intérieure. Le meurtre rituel est un sacrifice fondateur de toute société qui s’épure ensuite dans la notion d’un sacré – purifié de la violence initiale, un sacré intouchable, interdit, inviolable, protégé, objet de vénération et de respect absolu. Quant au religieux, c’est un mélange de relier, de la racine latine religare, et de relire, de répéter, d’apprendre, d’interpréter, relegere. Ce religieux - qui relie et qui répète, qui relie et interprète - se déploie comme une dynamique entre l’interdit et la transgression dans la révolte formatrice du croyant face au Père. L’expérience mystique, présente dans toutes les grandes religions, est une expérience intérieure, discrète, érotique, telle que décrite par Georges Bataille : « une approbation de la vie jusque dans la mort. »
La mystique catholique, notamment avec Maître Eckart et Thérèse d’Avila, se situe en « exclusion interne au catholicisme ». L’expression est de mon ami Michel de Certeau. Une marge qui révèle le cœur, basculant et bousculant les dogmes religieux pour anticiper certaines interprétations analytiques. Aujourd’hui, lorsque le continent religieux se délite ou bien se durcit en intégrisme, la littérature tend à sublimer le besoin de croire. La modernité y ajoute une épreuve nouvelle. Bien qu’aliénés, voire asservis, par l’emprise de l’image, le langage et l’écriture demeurent des expériences intérieures pour la refondation psychosomatique nécessaire à nous autres. Et si c’était cela le sacré ? Cette expérience intérieure, approbation de la vie jusque dans la mort, qui s’écrit, se parle, se danse, se joue en instrument ou se passe au cinéma. Variante post moderne et moderne du sacré.
La psychanalyse devait interpréter l’économie sexuelle de ses expériences amoureuses. Pulsions sexuelles et valeurs symboliques réunies, tout autant que l’audace de les dire et de les écrire, qui bousculent les dogmes religieux. Thérèse, par exemple, a échappé de peu à l’inquisition. Avant d’être proclamées saintes, beaucoup de ces femmes surtout – hommes également mais peut-être moins – devaient répondre devant l’inquisition pourquoi elles ne suivent pas le droit chemin des normes théologiques. La mystique, porteuse d’une connaissance anthropologique approfondie jusqu’aux extrêmes limites du supportable, est explorée passionnément, éperdument, pour s’en arracher aussi dans une osmose cosmique qui frôle l’athéisme. J’ai pu le dire à propos de Thérèse. Chez Colette, c’est évident : elle revendique l’athéisme. (…)« Peut-on dire que cette question du féminin et du sacré a travaillé en profondeur toute votre œuvre ? »
Votre question me conduit à deux pistes : l’une sur ma famille et ensuite une réflexion plus politique.
Mon père était très croyant. Il a fait le séminaire, des études de théologie avant de devenir médecin. Un métier qu’il n’a pas exercé longuement parce qu’en Bulgarie, après la deuxième guerre mondiale et le communisme, il fallait aller travailler au village, dans la campagne… ce qui se doit d’ailleurs très sérieusement dans de tels pays. Il voulait rester à Sophia pour que ses enfants apprennent les langues étrangères et se développent. Il a donc abandonné la médecine mais il est resté extrêmement soucieux des autres et de soigner soi-même et la famille à travers la religion ; il chantait à l’église, etc. Ma mère était darwiniste. Elle a fait de la biologie et n’a pas exercé après mais elle racontait à table comment l’être humain est descendant des animaux et autres bestioles. Cela fâchait beaucoup papa et c’est moi qui faisais la guerre contre les religions. Donc j’étais formée, par ma famille et par l’éducation communiste, à devenir athée. Mais je suis devenue athée, très franchement et très clairement, à partir du moment où j’ai compris ce que cela voulait dire. À savoir, non pas un refus des religions mais une réinterprétation et une réappropriation de l’histoire religieuse.
Je touche ainsi la deuxième piste que m’ouvre votre question. Je suis une européenne convaincue. Avec Tocqueville et Hannah Arendt, je pense que l’Europe qui nous déçoit, qui se délite – et je suis la première à le critiquer – a produit un fait culturel encore inestimé dans sa profondeur, mais il est temps de le faire. À savoir qu’un événement s’est produit en Europe et nulle part ailleurs : c’est que nous avons perdu le fil avec la tradition, avec la religion. Cela s’est produit à la Renaissance, au XVIIIe siècle et a donné la sécularisation, l’athéisme, différentes formes de laïcité, etc. Ces éléments – qu’on ne peut développer ici – montrent qu’il y a une révolution qui a du mal à s’assumer et à montrer les bienfaits de son existence.
Ces bienfaits consistent en ce que nous n’avons pas perdu le contact avec la religion, mais le développement depuis la Renaissance, nous a donné une manière de questionner le fait religieux, d’en voir les racines et les nécessités et en même temps de pouvoir affronter les abus. Cette réévaluation de l’histoire religieuse ne s’est produite nulle part ailleurs qu’en Europe. C’est là-dessus que tous ceux qui s’intéressent à la culture – les enseignants, les bibliothécaires, les éducateurs, les psychanalystes et évidemment le corps politique – devraient se réinspirer jour et nuit, me semble-t-il, de cette ampleur de l’événement pour ne pas céder quand nous avons en face de nous des religions qui s’effondrent ou qui régressent et deviennent intégristes.
Ceci est possible si par exemple la rééducation de l’histoire des religions est développée dans les écoles, l’interprétation des phénomènes religieux aussi, avec suffisamment de respect et de profondeur critique pour qu’une coexistence des différentes religions soit possible et non pas la guerre des religions. À partir de là, plusieurs pistes de réflexion s’ouvrent. D’abord, comment vivre avec les différentes formes de religiosité et aussi comment s’emparer d’une exclusion interne du religieux qu’est la mystique, comme le disait mon ami Michel de Certeau. Là où le message religieux est vécu dans sa complexité et jusqu’en ces extrêmes, comme chez Thérèse d’Avila. Il s’agit alors de s’emparer du mouvement mystique qui touche le cœur des religions mais les poussent à une extrémité qui peut parler à d’autres au-delà de chaque religion. Les mystiques portent une connaissance de l’expérience psychosexuelle des humains – quand elle atteint des états limites – qui peut être contagieuse pour d’autres religions. Il y a une sorte de communion des mystiques qui résonne aujourd’hui où chacun de nous peut faire un choix à partir d’internet sur telle ou telle mysticisme et adapter ses croyances en conséquence.
Cette démarche est peut-être déjà possible mais elle se fait en catimini. Il nous manque un lien unifiant culturel, mystique ou religieux pour faire face à l’explosion des colères et des guerres qui nous envahissent aujourd’hui. Ceci dit, j’en reviens à l’expérience de Colette. Elle fait partie de ce monde des mystiques qui ne se disent pas parfois comme tels mais qui déploient, dans leur for intérieur, une capacité de penser le phénomène religieux comme un phénomène amoureux.
Mes dernières études ont été consacrées au besoin de croire. C’est un phénomène que l’on rencontre chez des adolescents qui sont surtout dans les quartiers, mais pas seulement. Des adolescents qui ont un sentiment d’exclusion du corps social et embrassent telle ou telle religion, en particulier l’islam qui les travaille sur les réseaux sociaux. Certains sont prêts pour devenir des tueurs dans le djihad. Nous avons créé, à la Maison des Étudiants, un séminaire sur le besoin de croire et on travaille avec ces jeunes pour toucher ce point où ils ont besoin d’être en réponse avec l’autre, dans une relation d’investissement de l’altérité qu’on appelle amour. Quand ils sont sensibles à cette dimension, le désir de se voiler ou de rejoindre le djihad disparaît ou s’atténue.
Je donne souvent l’exemple d’une jeune-fille que nous avions à cette Maison d’adolescents qui fait partie de l’hôpital Cochin. Plus jeune, elle avait été acceptée pour anorexie et, vers l’âge de 16-17 ans, elle voulait partir au djihad. Dans le groupe thérapeutique, qui est composé de personnes de différentes nationalités, origines mais aussi religions, elle a pu trouver une famille recomposée qui l’accepte avec générosité et respect. Elle a pu investir cette communauté. Elle a pu trouver, dans les activités qu’on lui proposait, des lectures des mystiques arabes traduits en français. Le lien à Dieu – qu’on appelle un besoin de croire quand on est psy – s’y exprimait en poésie amoureuse. Elle a trouvé le livre de Hallaj sur l’amour de Dieu. Cette révélation que sa religion peut être un acte amoureux l’a fait réfléchir autrement. Elle n’a pas continué jusqu’au bac mais elle a fait une école d’infirmière. Nous la voyons de temps en temps comme infirmière. C’est une manière de vous répondre d’une manière diffuse sur la question de la croyance dans ma vie. (…)
« Vous avez beaucoup travaillé la vie de Thérèse d’Avila. En quoi son expérience intérieure peut-elle être riche d’enseignements pour nous ? »
J’ai été récemment amenée à présenter ce travail à l’occasion de la visite du pape en Belgique. On m’a rappelé qu’athée comme je suis, c’est quand même un peu étonnant. Mon amis Sylvie, du Point, a dit que j’étais l’athée préférée du pape Benoît XVI. Je ne sais pas si c’est le cas de celui-ci mais j’ai essayé de montrer aux croyants et aux non-croyants l’expérience absolument extraordinaire de Thérèse d’Avila pour laquelle j’ai écrit un livre de 700 pages (!) : Thérèse, mon amour. Dans ce livre, une psychanalyste qui me représente essaye de lire Thérèse d’Avila et de comprendre son importance. Ce qui m’a surtout impressionnée c’est cette femme dont le père était Juif et la mère Espagnole, qui a vécu la persécution des Juifs et des Marranes de son temps, a embrassé quand même la foi de son père et de sa mère à tel point que lorsqu’elle vivait ses excitations, ses angoisses, ses désirs de jeune-femme, elle se sentait coupable de ne pas aimer Dieu. Jusqu’à ce que cette culpabilité la conduise à des états épileptiques, qui sont décrits aujourd’hui comme tels mais qui à l’époque passaient comme une condamnation par Dieu. Eh bien, elle a voulu montrer, avec sa force psychique d’écriture et d’organisation sociale, qu’elle est capable de faire quelque chose de cet amour déçu et coléreux en se livrant à une écriture et une prière dans lesquelles Jésus est en elle.
Dans son livre Le Château intérieur, elle se décrit comme ayant, dans sa vie psychique, non pas trois étages, comme nous, les psychanalystes, le voyons c’est-à-dire l’inconscient, le préconscient et le conscient, mais sept étages. C’est vous dire la complexité de l’expérience intérieure. Comme Colette, elle est dans la même recherche de décrire les subtilités du vécu sexuel et langagier. Dans la dernière demeure, que trouve-t-elle ? Elle trouve Dieu. Comme homme : le Christ comme homme. Cette espèce d’avalement, d’unification avec le divin était vu par certains de ses confesseurs comme un péché donc on a voulu la soumettre à l’inquisition comme une hérétique. On est à l’époque où le siècle d’Or de l’Espagne décline, où les protestants arrivent, où il y a aussi beaucoup d’hérétiques. Il y a également des gens d’Église qui l’acceptent et qui lui demandent d’écrire, de raconter ce qui lui arrive. Quand elle commence à parler de cette unification avec le divin qui est en elle, elle trouve des gens autour d’elle. Le peuple espagnol embrasé par cette foi si interne qu’une femme peut être à la place de Dieu.
Cela devient non seulement une sorte de fascination pour les croyants mais elle se met à réformer l’Église. C’est une femme qui répond à ceux qui lui demandent comment exprimer la foi qu’il faut faire des œuvres. Elle va changer le carmel. Elle va donner de nouvelles règles, de plus de retrait du monde mais aussi de plus de contemplation. Elle a aussi une grande correspondance avec saint Jean de la Croix qu’elle accuse d’être trop triste alors que de son côté elle fait toutes ses prières et tout son amour de Dieu avec une grande joie. Cette nouvelle image qu’elle donne d’un féminin digne de Dieu, divin et actif était très bien vu par les jésuites qui l’ont très vite sanctifiée. Cela m’a beaucoup intéressée, à l’occasion de cette visite du pape, de parler de ces grandes femmes de la chrétienté qui nous donnent non pas des exemples à imiter mais à développer selon les nouvelles circonstances. Et surtout d’être fiers d’une tradition occidentale qui est riche de ces évolutions. Il nous reste à les rééditer et rénover pour ne pas avoir peur de je ne sais quel grand remplacement.
Julia Kristeva, mise en ligne mars 2025
Peintures de Dominique Penloup

