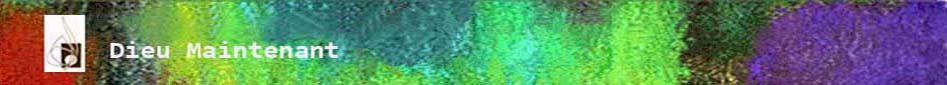

On ne peut pas faire l’impasse sur la politique
Charles Taylor
Dans ces temps très troublés où l’idéal démocratique est remis en cause dans de nombreux pays et parmi les plus puissants (USA, Chine, Inde, Russie…) il nous est apparu pertinent de nous tourner vers un des penseurs importants de notre époque, Charles TAYLOR. Le texte que nous vous proposons est extrait d’un recueil de conférences rassemblé sous le titre : « Le malaise de la modernité » (1) L’un des malaises de la modernité concerne la chose politique.
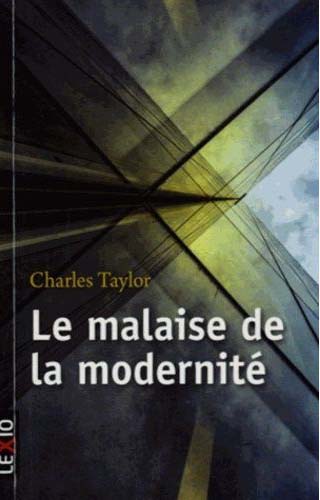
Le despotisme dure d’une société fondée sur la seule raison instrumentale, menace les libertés tant individuelles que collectives.
« Les institutions et les structures de la société techno-industrielle restreignent considérablement nos choix : elles forcent les sociétés autant que les individus à donner à la raison instrumentale un poids que nous ne lui accorderions jamais dans un débat moral sérieux, et qui pourrait se révéler extrêmement destructeur. On en trouve un exemple topique dans l’extrême difficulté que nous éprouvons à faire face aux menaces écologiques qui pèsent sur nos vies. On peut penser qu’une société fondée sur la seule raison instrumentale menace les libertés, tant individuelles que collectives – parce que ce ne sont pas seulement nos décisions sociales qu’elle modèle. On a bien du mal à maintenir un style de vie individuel contre le courant. Par exemple, la conception même de certaines villes modernes impose l’usage de la voiture privée, surtout quand on a laissé se dégrader les transports en commun.
Mais plusieurs ont parlé d’une autre perte de liberté, en particulier Alexis de Tocqueville. Dans une société formée d’individus « renfermés dans la solitude de leur propre cœur », peu de personnes accepteront de participer activement à la vie politique. Elles préféreront rester chez elles pour jouir des satisfactions de la vie privé, aussi longtemps que le gouvernement du moment assurera les moyens de les satisfaire et les distribuera assez généreusement.Au sein de la modernité, un « despotisme doux » entraine la perte du contrôle politique de notre destin.
C’est la porte ouverte à une forme nouvelle et typiquement moderne de despotisme, que Tocqueville appelait « despotisme doux ». Il ne s’agira pas d’une tyrannie fondée comme autrefois sur la terreur et l’oppression. Le gouvernement restera doux et paternaliste. Il maintiendra même des formes de la démocratie en organisant régulièrement des élections. Mais en réalité, tout sera régi par un « immense pouvoir tutélaire » sur lequel les gens auront peu de contrôle. La seule défense contre ce pouvoir, pensait Tocqueville, consiste en une culture politique forte qui valorise la participation, tant aux différents paliers de gouvernement que dans les associations libres. Mais l’atomisation des individus repliés sur eux-mêmes milite contre cette attitude. Dès que la participation faiblit et que les associations bénévoles qui en étaient le véhicule dépérissent, l’individu-citoyen se retrouve seul fasse au grand État bureaucratique devant lequel il se sent, à juste titre, impuissant. Le citoyen se trouve encore plus démuni et le cercle vicieux du despotisme doux se referme.
Cette aliénation de la sphère politique est peut-être un fait de notre monde hautement centralisé et bureaucratique. Plusieurs penseurs contemporains accordent à l’œuvre de Tocqueville une valeur prophétique. Si tel est le cas nous risquons de perdre le contrôle politique de notre destin que nous pourrions exercer en commun en qualité de citoyens et que Tocqueville appelait « liberté politique ». C’est notre dignité de citoyen qui est menacée ici. Les mécanismes impersonnels cités plus haut peuvent restreindre notre marge de liberté comme société, mais la perte de la liberté publique signifierait que nous ne pourrions même plus faire les choix qui nous restent en tant que citoyens et qu’un pouvoir tutélaire irresponsable les ferait à notre place.
Tels sont les trois malaises de la modernité. Le premier concerne ce qu’on pourrait appeler une perte de sens : la disparition des horizons moraux. Le deuxième concerne l’éclipse des fins, face à une raison instrumentale effrénée. Et la troisième porte sur la perte de la liberté.La modernité a ses défenseurs autant que ses détracteurs
Bien sûr, tout cela ne va pas sans soulever de controverses. J’ai évoqué des malaises fort répandus et j’ai cité des auteurs reconnus, mais aucun accord n’est acquis. Même ceux qui partagent en partie ces inquiétudes disputent de la façon de les formuler. Et nombreux sont ceux qui voudraient les balayer du revers de la main. Ceux qui sont profondément enfoncés dans ce que certains appellent la « culture du narcissisme » croient que ces critiques cèdent à la nostalgie d’une époque révolue et plus opprimante. Les adeptes de la raison technologique moderne pensent que les adversaires de la primauté de l’instrumental sont des réactionnaires et des obscurantistes qui conspirent à priver le monde des bienfaits de la science. Et ceux qui défendent une conception purement négative de la liberté soutiennent qu’on attache trop d’importance au concept de liberté politique et que nous devrions tendre à une société dans laquelle une gestion scientifique se combinerait à une autonomie maximale pour chaque individu. La modernité a ses défenseurs autant que ses détracteurs.
L’accord n’est fait sur rien et le débat continue. Mais la nature même des phénomènes, qui sont décriés ici et loués là, reste souvent mal comprise. Je soutiens en particulier que nous ne devrions prendre aucune des voies que recommandent les défenseurs et les détracteurs purs et durs de la modernité. La lumière ne viendra pas non plus de quelque compromis entre les couts et les bénéfices, disons, de l’individualisme, de la technologie et de la bureaucratie. La culture moderne est plus subtile et complexe que cela. Je crois que les défenseurs et les détracteurs ont raison les uns et les autres, mais d’une façon à laquelle un simple compromis entre les couts et les bénéfices ne peut pas rendre justice. En réalité il y a tout à la fois quelque chose d’admirable, de dégradant et d’effrayant dans les phénomènes que j’ai décrits ; pour les comprendre, il faut voir que le problème ne consiste pas à évaluer les conséquences néfastes qu’il faudrait accepter pour en cueillir les fruits, mais à les orienter vers de plus grands objectifs plutôt que vers leurs formes dégradées ».
Charles Taylor, mars 2025
1- Charles TAYLOR, Le malaise de la modernité, Cerf avril 2015 – Extrait pages 16 à 19. / Retour au texte

