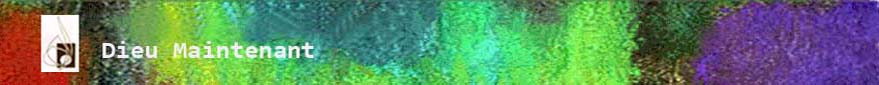

Pour l’avènement d’une justice restaurative
Jean-Luc Rivoire
Antoine GARAPON, magistrat a été juge des enfants. Il est membre de la CIASE et dirige la commission reconnaissance et réparation (CRR) pour les victimes d’agressions sexuelles commises par des religieux. Il vient de faire paraître au PUF : « Pour une autre justice, la voie restaurative ». Cet ouvrage aborde des questions essentielles pour l’avenir de la justice et donc pour la démocratie.
Afin de permettre à chacun de se familiariser avec l’idée de « justice restaurative », nous vous proposons :
- Le texte, publié sur ce site en mai 2023, à propos de la sortie de l’excellent film : « Je n’oublierai jamais vos visages » de Jeanne HERRY : Un espace de parole improbable
- Un roman, « Impardonnable » que Mathieu HÉNÉGAUX publie chez Grasset.
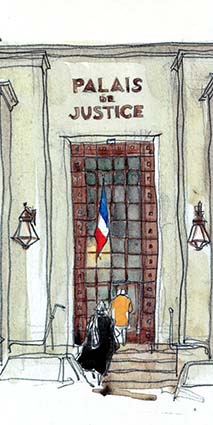
La justice ordinaire
Antoine GARAPON part du constat que nous vivons, ce qu’il appelle, une double révolution : la remise en cause des institutions dont on ne reconnait plus le caractère sacré et par ailleurs la revendication des victimes innocentes qui entendent rompre avec les mécanismes sacrificiels qui leur ont été imposés. On constate la montée d’un mécontentement profond qui s’organise autour des victimes qui réclament une justice plus attentive, plus réactive et plus proche de la vie.
Pourtant la justice ordinaire a fait de grand progrès et réserve le plus souvent aux victimes une place à part entière, contrairement aux pays de « common law ». On pense au procès des attentats du 13 novembre 2015 au cours duquel les magistrats ont décidé de procéder à l’audience à l’audition de toutes les victimes qui le demandaient, en dehors du temps de parole de leurs avocats. Dans l’actualité récente, l’affaire des viols de Mazan est exemplaire en ce que la victime, Gisèle PENICAUD a refusé le huis-clos et décidé la publicité intégrale de tous les débats, modifiant profondément le procès dans tout son déroulement. On pourrait réfléchir aussi à partir de l’extraordinaire procès de Klaus BARBIE à Lyon en 1987.Les limites de la justice ordinaire
Au fond ce dont on prend maintenant conscience, c’est que la justice ordinaire dans sa version la plus respectueuse des droits de la victime ne peut pas - pour certaines infractions parmi les plus graves - terminer une affaire, apporter un épilogue, réparer le désordre causé permettant à la paix des uns et des autres et de tous de se remettre en place. Une fois le procès terminé l’exil du monde de la victime peut subsister.
Dans les crimes inhumains, la victime fait l’expérience d’un monde non seulement dangereux mais brisé, d’un déchirement ontologique. L’objectif de la justice n’est plus simplement de qualifier le crime par un acte de langage et de le compenser par une peine et un montant de dommages et intérêts, mais de faire cesser autant que faire ce peut cette lente destruction intérieure qui est la conséquence de l’agression.
Par exemple, « la victime de viol a l’impression que l’agresseur l’a forcée à consentir et ce faux accord la tourmente et la salit à ses propres yeux, parce que l’acte sexuel est nécessairement collaborant, ne serait-ce que dans l’esprit de la victime qui pense alors absurdement et presque scandaleusement qu’une partie d’elle a consenti par les gestes. Le plaisir réflexe, possiblement ressenti pour la première fois de sa vie par l’enfant abusé, pervertit définitivement le sens des choses. Le plaisir devient enfer, le beau devient définitivement laid et, à la victime, définitivement inaccessible. »
Viols, tortures, actes terroristes, incestes, agressions d’ecclésiastiques ou de professeurs, la liste est loin d’être exhaustive. Il faut maintenant que nous ayons les capacités d’identifier les limites de la rationalité pénale pour ouvrir, quand cela est nécessaire, d’autres espaces de paroles car « la justice est toujours possible, il n’est jamais trop tard ».
La justice ordinaire est soumise à des contraintes qui rendent souvent le procès impossible par exemple pour des faits prescrits, pour des affaires dans lesquelles l’auteur est mort, pour les affaires dont les faits appartiennent à l’histoire. Par contre, quand le procès a été à son terme, permettant de savoir si un crime a été commis – par qui ? et qui en est la victime ? - l’ordre public a peut-être été apaisé mais parfois sans que le drame intérieur de la victime ne le soit.
La justice restaurative par sa souplesse peut être mobilisée, alors que le procès n’est plus possible ou alors que la justice ordinaire est saisie ou qu’un jugement définitif a été rendu, afin d’ouvrir un nouvel espace de parole pouvant permettre d’abord à la victime de sortir de soi et de retrouver le monde, de reprendre le fil de son innocence en même temps que l’auteur reprend le fil de sa culpabilité.
L’institution judiciaire offre le spectacle d’une relation de pouvoir asymétrique et verticale où les robes (vêtements professionnels) sont supposés faire taire les armes. La justice ordinaire s’est fixée la tâche de convertir les conflits entre les personnes en des questions de droit, en trouvant la résolution dans des réparations financières ou des quantums de peines.L’enjeu de la justice restaurative
La justice restaurative propose très concrètement l’organisation d’un face à face dans un échange non-hiérarchique pour lequel les personnes sont disposées en cercle. Le dialogue est le seul moyen et le seul but de la justice restaurative. Les conférence restauratives peuvent avoir de très nombreuses configurations, par exemple : rencontre entre des détenus et des victimes ayant connu des faits de même ordre – rencontre entre l’auteur et sa victime – rencontre entre l’institution (Église Catholique) et une ou plusieurs victimes d’ecclésiastiques. Les participants sont préparés par des animateurs qui assisteront aux rencontres dans une participation discrète mais garante du respect des règles posées. Les détenus doivent reconnaitre les faits qui leur ont été reprochés. Ils ne peuvent pas utiliser leur participation au processus restauratif pour obtenir des réductions ou autre aménagement de leur peine.
L’enjeu de la justice restaurative vise, contrairement à la justice ordinaire, a une déclaration d’innocence pour les victimes d’abord. Cette ambition est fondée sur le constat que pour ceux qui ont subi un crime contre l’intime, ce rapport au monde qu’est l’innocence est devenu inaccessible. Mais la justice restaurative s’attarde aussi sur la part d’innocence qui demeure chez l’accusé car elle postule une part irréductible d’innocence chez l’auteur parce que quelque chose en lui participe de la douleur propre à la condition humaine.
L’enseignement de la justice restaurative c’est que non seulement l’innocence n’est pas première mais qu’elle doit se déclarer et qu’elle est le fruit d’un travail collectif et individuel sur soi. Seul un acte de justice peut nous libérer du jugement sauvage que la victime porte en elle.
Le travail d’Antoine GARAPON est devenu, dès sa parution, un ouvrage de référence sur la justice restaurative qui en manquait cruellement en France. Ce livre permet de penser cette innovation dans toute son ampleur et sa densité. Nous devrons désormais vivre avec cette conviction que le monde dans lequel nous vivons est un monde à réparer tâche inépuisable, fondatrice, modeste et immense,
Jean-Luc Rivoire, juin 2025
Dessins de Noëlle Herrenschmidt

