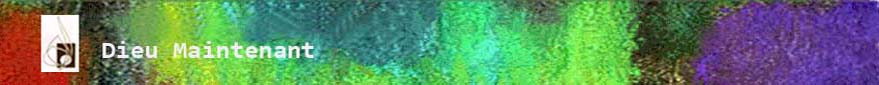

La Bretagne, laboratoire de l’agro-industrie - 1
« Algues vertes, l’histoire interdite »
Julien Lecomte
Le roman graphique « Algues vertes, l’histoire interdite », par Inès Léraud et Pierre Van Hove, paru en 2019, est une enquête très poussée sur le désastre environnemental de l’agriculture intensive imposée à partir des années 60 dans l’une des régions les plus agricoles de France, la Bretagne.

L’attractivité de la Bretagne
Dans les représentations nationales, la Bretagne est une terre authentique, qui a su garder vivantes ses traditions celtiques, tout en recélant les beautés naturelles de ses côtes, de ses forêts, avec des bourgs typiques. Cette vision est largement promue par les offices de tourisme, qui en usent et en abusent. Figurant parmi les destinations de vacances préférées des Français mais aussi de nombreux étrangers, son activité touristique représente 8% du PIB régional (1). Toute autre vision discordante avec cette image promotionnelle représente une menace directe pour les intérêts régionaux. Ainsi, les marées noires qui ont souillé à plusieurs reprises son littoral ont immédiatement porté un coup dur à l’économie touristique.
Lorsqu’un pétrolier vient s’éventrer sur ses côtes, il n’y a aucun doute possible sur l’origine de la catastrophe, la région se retrouvant alors victime d’une agression extérieure. En revanche, il existe une autre forme de marée polluante, et d’une autre couleur : la verte. Et les marées vertes ont tué. Or celles-ci sont considérées avec beaucoup plus de circonspection, jusqu’à se transformer en une véritable omerta institutionnalisée.Les marées vertes, un danger mortel
Le roman graphique « Algues vertes, l’histoire interdite », écrit par Inès Léraud et dessiné par Pierre Van Hove (2), raconte comment ce phénomène fait l’objet d’un déni organisé depuis une cinquantaine d’années, car il contrevient à de puissants intérêts régionaux : agro-industrie en tête, tourisme, milieux politiques, judiciaires et administratifs. Les premières études scientifiques sur ces algues vertes remontent à la fin des années 70. Elles mettaient déjà en avant l’intensification agricole comme cause principale.
Qu’est-ce qu’une marée verte ? C’est la conséquence d’un phénomène dit d’eutrophisation. Les eaux des rivières se chargent en nitrates, sous-produits issus de l’agriculture intensive. En débouchant dans les estuaires maritimes, ces composants azotés fonctionnent comme un engrais dans l’eau saumâtre, favorisant le développement explosif d’ulves marines, dites algues vertes ou laitue de mer. Leur production en masses considérables vient s’agglomérer sur le rivage, en couches pouvant dépasser deux mètres. Leur décomposition rapide dégage un gaz toxique, le sulfure d’hydrogène, de formule chimique H2S. C’est le bien connu composant des boules puantes lancées par les potaches farceurs. Mais le danger mortel de ce gaz est d’être perçu par notre système olfactif seulement en faible concentration dans l’air. Passé un seuil supérieur, nous ne le sentons plus et c’est là qu’il devient toxique pour l’organisme, jusqu’à la mort. De plus, en séchant, la croûte des couches d’algues devient claire, se confondant avec le sable. C’est alors un piège mortel pour les humains et les animaux qui chutent dans les poches en décomposition.
Une enquête très fouillée
Ce roman graphique est le fruit d’une enquête minutieuse, menée durant trois ans par la journaliste Inès Léraud, qui s’est installée en Bretagne pour la réaliser. Très sourcée, elle démontre comment le responsable principal de cette catastrophe écologique est l’agriculture intensive, tout particulièrement l’élevage porcin produisant des lisiers que les sols ne parviennent plus à absorber lors des épandages. Lessivés par les pluies, les nitrates contenus dans les déjections porcines partent aux rivières en eutrophisant les milieux aquatiques, se concentrant dans les estuaires où ils deviennent des super-fertilisants pour les ulves.
L’enquête explique avec précision tous les rouages de cette situation, dont l’origine remonte à la transformation de l’économie agraire familiale de la Bretagne dans les années 60 en une agro-industrie tournée vers les marchés internationaux. On y découvre l’histoire de la destruction de la petite paysannerie, qu’on envoya dans les usines, mais aussi la constitution d’immenses fortunes, fondatrices du très puissant « lobby breton », bien réel et l’un des mieux organisés d’Europe, où l’on retrouve parmi les hommes les plus riches de France : François Pinault, Vincent Bolloré, Emmanuel Besnier (le très discret patron de Lactalis, cinquième fortune française) et d’autres seigneurs de l’agro-business, peu connus du grand public mais puissants. Ils sont associés aux hommes politiques bretons, dont le socialiste Jean-Yves Le Drian et le conservateur dur Marc Le Fur. Le club « Les Amis du cochon », lobby parlementaire pour l’élevage porcin breton financé par la FNSEA, compte ou a compté parmi ses membres François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, et beaucoup d’autres. L’administration publique, les banques régionales, la magistrature, les médias et les élus locaux, ces derniers très soucieux de l’image touristique de leurs communes littorales, complètent le bal pour créer un système très solidement verrouillé, une forme de corruption institutionnalisée, quasi légalisée. Les marées vertes ont tué à plusieurs reprises des humains, ainsi que des animaux domestiques et sauvages. Le premier mort identifié date de 1989, un joggeur de vingt-six ans décédé dans un trou d’algues vertes en décomposition. Tout a été fait pour que l’enquête sur les causes de son décès n’aboutisse jamais.
Mais il devenait quand même de plus en plus difficile de nier la dangerosité du phénomène, à la suite d’autres accidents mortels. Sous la mandature de Nicolas Sarkozy ont alors été lancés les « Plans Algues Vertes », pour que l’État et les collectivités territoriales aident financièrement les communes à ramasser les accumulations d’ulves sur leurs plages. Le coût du premier plan, étalé entre 2010 et 2015, a été de 134 millions d’euros. Mais ces plans successifs restèrent dénués de vraie volonté politique de traiter la cause initiale, celle du modèle agricole intensif breton. Ce déni officiel s’accompagna du muselage des scientifiques indépendants, tandis que des organes de recherche privée, subventionnés par l’agro-industrie, furent charger de mener une « stratégie de l’incertitude », vieille technique de désinformation inventée par l’industrie américaine du tabac dès les années 60 (3).
Une fois de plus, c’est la collectivité publique, donc les contribuables, qui payent les conséquences désastreuses sur l’environnement et la santé de l’agro-industrie. Aussi, lorsque l’on reproche à l’agriculture bio de proposer des produits au coût plus élevé que ceux de la production conventionnelle, l’on voit bien que le mode de calcul est complètement faussé, d’une part en raison du montant très nettement supérieur de subventions que reçoit l’agriculture conventionnelle, d’autre part en n’intégrant pas non plus la prise en charge publique de ses dégâts sur les milieux.
Les agriculteurs, coupables ou victimes ?
Et les agriculteurs dans tout ça ? Ils apparaissent sous un double aspect, souvent ambigüe. A la fois comme des pollueurs cyniques pour certains, donc coupables, mais pour d’autres comme les premières victimes de ce système qui les étrangle en captant tous leurs gains de productivité. L’auteure a recueilli, dans la confidence, les témoignages anonymes d’agriculteurs bretons qui voudraient sortir du productivisme. Mais ils sont pieds et poings liés par les grands groupes agro-industriels et leur système financier qui les tiennent aux deux bouts de la chaîne de valeur. D’un côté, ils sont accablés de prêts bancaires qu’ils contractent pour s’adapter sans cesse aux nouvelles normes, et de l’autre, toute leur production est acquise par ces groupes qui leur imposent les prix d’achat, leur vendent les fournitures, le matériel, décident des cadences et des volumes de production. S’élever contre ce système, c’est être menacé de représailles dignes d’une organisation mafieuse.
Les deux auteurs de ce roman graphique ont récemment sorti un nouvel ouvrage consacré à la thématique agricole en Bretagne, sur le sujet du remembrement. Nous en ferons état dans une prochaine recension.
Par ailleurs, en complément de cette enquête, nous vous conseillons de lire « A la ligne », description saisissante des conditions de travail dans les usines agroalimentaires bretonnes par un intellectuel qui, faute d’emploi à sa hauteur dans la région, y fut intérimaire (4).
Si vous partez en Bretagne lors de vos prochaines vacances, en empruntant la route nationale 12 entre Rennes et Brest, vous pourrez observer l’effet-vitrine de cette voie rapide tout au long duquel s’érigent les imposantes superstructures de l’agro-industrie bretonne. Et vous saurez alors que sous leurs surfaces lisses se cache un puissant système aux conséquences sociales et environnementales désastreuses.
Julien Lecomte, Septembre 2025
Peintures de Pierre Meneval

1- Source : https://pro.tourismebretagne.bzh/etudes-chiffres-cles/ / Retour au texte
2- LÉRAUD, Inès, VAN HOVE, Pierre, Algues vertes, l’histoire interdite, Paris, Delcourt / La Revue Dessinée, 2019 / Retour au texte
3- Voir notre tout premier article de la rubrique « Ecologie » sur le brouillage entre doute-question et doute-soupçon dont procède ce genre de stratégie : questionsdecologie.html / Retour au texte
4- PONTHUS, Joseph, A la ligne, feuillets d’usine, Paris, La Table Ronde, 2019 / Retour au texte
