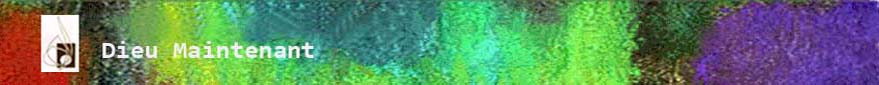

À vous qui vous taisez
Abbas Fahdel
Abbas Fahdel est un réalisateur, scénariste et critique de cinéma franco-irakien, né à Hilla, en Irak. Il vit actuellement au Sud Liban. Il interpelle vigoureusement les intellectuels et les artistes de France : « vous, qui êtes pourtant censés être la voix de la conscience, du questionnement, du doute, de la complexité — vous vous taisez. »

À vous qui vous taisez.
À vous, artistes, intellectuels, journalistes, écrivains, universitaires, cinéastes, chercheurs...
À vous, qui savez manier les mots, les idées, les concepts, qui jouissez encore d’un semblant de liberté et qui avez le luxe du silence.
À vous, qui ne manquez jamais d’évoquer la censure en Russie, l’oppression en Chine ou les atteintes à la liberté ailleurs dans le monde.
À vous qui prenez la parole, à juste titre, pour défendre la liberté des femmes en Iran, mais qui vous taisez face à la complicité de vos dirigeants avec le génocide à Gaza, et face aux dérives autoritaires chez vous.
Chez vous, où chaque jour les gouvernements piétinent les droits humains, attisent la haine, criminalisent les étrangers, les musulmans, les Arabes, les Noirs, les pauvres.
Chez vous, où les discours de l’extrême droite sont devenus la norme — une réalité installée, intégrée, assumée.
Ce que vous observez chaque jour ne relève pas d’une simple dérive. Il s’agit d’une trajectoire assumée, accélérée.
Une violence normalisée.
Une haine légalisée.
Des lois d’exception devenues lois tout court.
Des discours racistes repris au sommet de l’État.
Des violences policières d’abord tolérées, puis justifiées, puis encouragées.
Une immigration constamment présentée comme un péril.
Une religion — l’islam — systématiquement suspectée.
Des personnes — noires, arabes, musulmanes, roms, exilées, pauvres — désignées à la vindicte publique.
Vos dirigeants mènent une politique de plus en plus autoritaire, brutale, indifférente à la souffrance des plus vulnérables.
Les idées de l’extrême droite ne sont plus une menace — elles sont déjà le moteur.
Elles s’infiltrent dans la loi, dans les discours officiels, dans les pratiques policières, dans les médias.
La stigmatisation de l’« étranger » est devenue un sport national.
Et vous, qui êtes pourtant censés être la voix de la conscience, du questionnement, du doute, de la complexité — vous vous taisez.
Vous continuez à parler d’art, de cinéma, de littérature comme si de rien n’était.
Vous signez parfois des pétitions contre les dictatures lointaines, mais pas un mot sur la dérive autoritaire chez vous.
Pas un mot sur les expulsions, sur la répression, sur le racisme d’État, sur les morts en Méditerranée que la politique de vos dirigeants alimente.
Mais il n’y a pas de neutralité possible.
Pas face à la haine décomplexée, aux lois liberticides, à la brutalité contre les manifestants, aux humiliations des sans-papiers, aux milliers de morts refoulés en mer, aux quartiers placés sous surveillance.
Pas quand on désigne une religion, une couleur de peau, une origine comme un danger.
Pas quand l’État détourne la laïcité pour frapper toujours les mêmes.
Pas quand des enfants sont arrachés à leur scolarité pour être expulsés, quand des familles sont déportées à l’aube, quand on criminalise la solidarité.
Et pourtant, vous ne dites rien.
Vous vous taisez.
Pas par ignorance — vous voyez, vous lisez, vous savez.
Pas par peur — vous n’êtes ni menacés, ni réduits au silence.
Mais par confort, peut-être. Par habitude. Par paresse. Par cette illusion qu’on peut encore se permettre de détourner le regard.
Il est vrai que ce ne sont pas vos enfants qu’on fouille à l’entrée du collège.
Ce ne sont pas vos amis qu’on laisse mourir en Méditerranée.
Ce n’est pas votre mosquée qu’on ferme, votre prénom qu’on soupçonne, votre couleur de peau qu’on contrôle, votre famille qu’on expulse, vos souvenirs qu’on piétine.
Alors vous continuez à vivre, à créer, à penser, comme si de rien n’était.
Comme si on pouvait séparer l’art de la société.
Comme si on pouvait écrire sans regarder ce qui brûle juste derrière la vitre.
Peut-être pensez-vous que ce n’est pas votre combat.
Vous n’avez jamais eu à justifier votre prénom, votre couleur, votre accent, votre nom de famille.
Vous êtes « du bon côté ». Le système vous tolère. Il vous laisse un espace. Il vous flatte parfois.
Vous vous y êtes installés.
Vous croyez encore que l’art et la pensée peuvent se tenir à l’écart du monde réel, qu’on peut continuer à créer « au-dessus de la mêlée ».
Vous pensez être à l’abri.
Vous croyez pouvoir composer avec la bête, qu’elle fera une exception pour vous, qu’elle ne se tournera pas vers vous quand elle n’aura plus d’ennemis extérieurs à désigner.
Mais quand ce sera votre tour, quand vous serez désignés comme des traîtres de l’intérieur, il sera trop tard pour vous demander où vous étiez.
L’Histoire est formelle : l’inaction est une trahison, et le silence n’est jamais neutre. Il est toujours du côté du pouvoir, du côté des dominants, du côté de ceux qui frappent.
Il ne protège pas les faibles — il conforte les forts.
Ceux que vous laissez frapper aujourd’hui — parce qu’ils sont différents, parce qu’ils sont « autres », étrangers ou simplement pas comme vous — ce sont vos garde-fous. Car quand ils tomberont, vous tomberez aussi.
Demain, ce sera votre tour.
Demain, ce sera l’artiste trop libre, le journaliste trop curieux, l’écrivain trop insolent, le professeur trop engagé, le cinéaste trop critique.
Ce sera vous.
L’inaction, dans ce contexte, n’est plus une option — c’est une reddition.
Il ne s’agit pas de faire de grandes déclarations abstraites sur les « valeurs de la République » ou les « Lumières ».
Il s’agit de dire non. Ici. Maintenant.
Votre parole a encore du poids.
Votre voix compte.
Mais elle ne comptera bientôt plus si vous continuez à l’économiser.
Abbas Fahdel, 18 avril 2025 - mise en ligne mai 2025
Sculptures et dessins de Pierre Meneval

