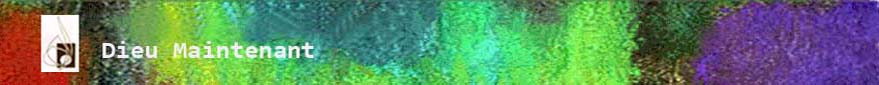

"En un instant mon coeur fut touché et je crus !"
Paul Claudel
La sécularisation allait déjà bon train en ce Noël 1886. On croyait que la raison allait tout éclairer. Et pourtant la lumière a jailli d’ailleurs, comme un éclair, dans la vie de Paul Claudel: "En un instant mon cœur fut touché et je crus!"
Je suis né le 6 août 1868. Ma conversion s’est produite le 25 décembre 1886. J’avais donc dix-huit ans. Mais le développement de mon caractère était déjà, à ce moment, très avancé. Bien que rattachée des deux côtés à des lignées de croyants qui ont donné plusieurs prêtres à l’Eglise, ma famille était indifférente et, après notre arrivée à Paris, devint nettement étrangère aux choses de la foi.
Auparavant j’avais fait une bonne première communion qui, comme pour la plupart des jeunes garçons, fut à la fois le couronnement et le terme de mes pratiques religieuses. J’ai été élevé, ou plutôt instruit, d’abord par un professeur libre, dans des collèges (laïcs) de province, puis enfin au lycée Louis-le-Grand. Dès mon entrée dans cet établissement, j’avais perdu la foi, qui me semblait inconciliable avec la pluralité des mondes. La lecture de la Vie de Jésus de Renan fournit de nouveaux prétextes à ce changement de convictions que tout, d’ailleurs, autour de moi, facilitait ou encourageait.
Que l’on se rappelle ces tristes années quatre-vingts, l’époque du plein épanouissement de la littérature naturaliste. Jamais le joug de la matière ne parut mieux affermi. Tout ce qui avait un nom dans l’art, dans la science et dans la littérature, était irréligieux. Tous les soi-disant grands hommes de ce siècle finissant s’étaient distingués par leur hostilité à l’Eglise. Renan régnait. Il présidait la dernière distribution de prix du lycée Louis-le-Grand à laquelle j’assistai et il me semble que je fus couronné de ses mains. Victor Hugo venait de disparaître dans une apothéose.
A dix-huit ans, je croyais donc ce que croyaient la plupart des gens dits cultivés de ce temps. La forte idée de l’individuel et du concret était obscurcie en moi. J’acceptais l’hypothèse moniste et mécaniste dans toute sa rigueur; je croyais que tout était soumis aux «lois», et que ce monde était un enchaînement dur d’effets et de causes que la science allait arriver après-demain à débrouiller parfaitement. Tout cela me semblait d’ailleurs fort triste et fort ennuyeux. Quant à l’idée du devoir kantien que nous présentait mon professeur de philosophie, M. Burdeau, jamais il ne me fut possible de la digérer.
Je vivais d’ailleurs dans l’immoralité et, peu à peu, je tombai dans un état de désespoir. La mort de mon grand-père, que j’avais vu de longs mois rongé par un cancer à l’estomac, m’avait inspiré une profonde terreur et la pensée de la mort ne me quittait pas. J'avais complètement oublié la religion et j'étais à son égard d'une ignorance sauvage. La première lueur de vérité me fut donnée par la rencontre des livres d'un grand poète, à qui je dois une éternelle reconnaissance, et qui a eu dans la formation de ma pensée une part prépondérante, Arthur Rimbaud. La lecture des Illuminations, puis, quelques mois après, d'Une Saison en enfer, fut pour moi un événement capital. Pour la première fois, ces livres ouvraient une fissure dans mon bagne matérialiste et me donnaient l'impression vivante et presque physique du surnaturel. Mais mon état habituel d'asphyxie et de désespoir restait le même.
Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. Je commençais alors à écrire et il me semblait que dans les cérémonies catholiques, considérées avec un dilettantisme supérieur, je trouverais un excitant approprié et la matière de quelques exercices décadents. C'est dans ces dispositions que, coudoyé et bousculé par la foule, j'assistai, avec un plaisir médiocre, à la grand'messe. Puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins aux vêpres. Les enfants de la maîtrise en robes blanches et les élèves du petit séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet qui les assistaient, étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier à l'entrée du chœur à droite du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie.
En un instant mon cœur fut touché et je crus. Je crus, d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que, depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée, n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, de l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable.
En essayant, comme je l’ai fait souvent, de reconstituer les minutes qui suivirent cet instant extraordinaire, je retrouve les éléments suivants qui, cependant, ne formaient qu’un seul éclair, une seule arme, dont la Providence divine se servait pour atteindre et s’ouvrir enfin le cœur d’un pauvre enfant désespéré: «Que les gens qui croient sont heureux! Si c’était vrai, pourtant! C’est vrai! Dieu existe, Il est là. C’est quelqu’un, c’est un être aussi personnel que moi! Il m’aime, Il m’appelle.» Les larmes et les sanglots étaient venus et le chant si tendre de l’Adeste ajoutait encore à mon émotion.
Emotion bien douce où se mêlait cependant un sentiment d’épouvante et presque d’horreur ! Car mes convictions philosophiques étaient entières. Dieu les avait laissées dédaigneusement où elles étaient, je ne voyais rien à y changer, la religion catholique me semblait toujours le même trésor d’anecdotes absurdes, ses prêtres et les fidèles m’inspiraient la même aversion qui allait jusqu’à la haine et jusqu’au dégoût. L’édifice de mes opinions et de mes connaissances restait debout et je n’y voyais aucun défaut. Il était seulement arrivé que j’en étais sorti.
Un Etre nouveau et formidable, avec de terribles exigences, pour le jeune homme et l’artiste que j’étais, s’était révélé que je ne savais concilier avec rien de ce qui m’entourait. L’état d’un homme qu’on arracherait d’un seul coup de sa peau pour le planter dans un corps étranger au milieu d’un monde inconnu est la seule comparaison que je puisse trouver pour exprimer cet état de désarroi complet. Ce qui était le plus répugnant, à mes opinions et à mes goûts, c’est cela pourtant qui était vrai, c’est cela dont il fallait bon gré, mal gré, que je m’accommodasse. Ah! Ce ne serait pas, du moins, sans avoir essayé tout ce qu’il m’était possible pour résister.
Cette résistance a duré quatre ans. J’ose dire que je fis une belle défense et que la lutte fut loyale et complète. Rien ne fut omis. J’usai de tous les moyens de résistance et je dus abandonner l’une après l’autre des armes qui ne me servaient à rien. Ce fut la grande crise de mon existence, cette agonie de la pensée dont Arthur Rimbaud a écrit: «Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes. Dur ennemi! le sang séché fume sur ma face!» Les jeunes gens qui abandonnent si facilement la foi ne savent pas ce qu’il en coûte pour la recouvrer et de quelles tortures elle devient le prix. La pensée de l’enfer, la pensée aussi de toutes les beautés et de toutes les joies, dont, à ce qu’il me paraissait, mon retour à la vérité, devait m’imposer le sacrifice, étaient surtout ce qui me retirait en arrière.
Mais enfin, dès le soir même de ce mémorable jour à Notre-Dame, après que je fus rentré chez moi par les rues pluvieuses qui me semblaient maintenant si étranges, j’avais pris une bible protestante qu’une amie allemande avait donnée autrefois à ma sœur Camille et, pour la première fois, j’avais entendu l’accent de cette voix si douce et si inflexible qui n’a cessé de retentir dans mon cœur.
Je ne connaissais que par Renan l’histoire de Jésus et, sur la foi de cet imposteur, j’ignorais même qu’il se fût jamais dit le Fils de Dieu. Chaque mot, chaque ligne démentait, avec une simplicité majestueuse, les impudentes affirmations de l’apostat et me dessillait les yeux. C’est vrai, je l’avouais avec le centurion, oui, Jésus était le Fils de Dieu. C’est à moi, Paul, entre tous, qu’Il s’adressait et Il me promettait son amour. Mais, en même temps, si je ne Le suivais, Il ne me laissait d’autre alternative que la damnation. Ah! Je n’avais pas besoin qu’on m’expliquât ce qu’était l’enfer et j’y avais fait ma « Saison ». Ces quelques heures m’avaient suffi pour me montrer que l’enfer est partout où n’est pas Jésus-Christ. Et que m’importait le reste du monde auprès de cet Etre nouveau et prodigieux qui venait de m’être révélé?
C’était l’homme nouveau en moi qui parlait ainsi, mais l’ancien résistait de toutes ses forces et ne voulait rien abandonner de cette vie qui s’ouvrait à lui. L’avouerai-je ? Au fond, le sentiment le plus fort qui m’empêchait de déclarer mes convictions était le respect humain. La pensée d’annoncer à tous ma conversion, de dire à mes parents que je voulais faire maigre le vendredi, de me proclamer moi-même un de ces catholiques tant raillés, me donnait des sueurs froides et, par moments, la violence qui m’était faite me causait une véritable indignation. Mais je sentais sur moi une main ferme. Je ne connaissais pas un prêtre. Je n’avais pas un ami catholique.
L’étude de la religion était devenue mon intérêt dominant. Chose curieuse ! l’éveil de l’âme et celui des facultés poétiques se faisaient chez moi en même temps, démentant mes préjugés et mes terreurs enfantines. C’est à ce moment que j’écrivis les premières versions de mes drames: Tête d’Or et La Ville. Quoiqu’étranger encore aux sacrements, déjà je participais à la vie de l’Eglise, je respirais enfin et la vie pénétrait en moi par tous les pores. Les livres qui m’ont le plus aidé à cette époque sont d’abord les Pensées de Pascal, ouvrage inestimable pour ceux qui cherchent la foi, bien que son influence ait souvent été funeste; les Elévations sur les Mystères et les Méditations sur les Evangiles de Bossuet, et ses autres traités philosophiques; le Poème de Dante, et les admirables récits de la Sœur Emmerich. La Métaphysique d’Aristote m’avait nettoyé l’esprit et m’introduisait dans les domaines de la véritable raison. L’Imitation appartenait à une sphère trop élevée pour moi et ses deux premiers livres m’avaient paru d’une dureté terrible.
Mais le grand livre qui m’était ouvert et où je fis mes classes, c’était l’Eglise. Louée soit à jamais cette grande mère majestueuse aux genoux de qui j’ai tout appris! Je passais tous mes dimanches à Notre-Dame et j’y allais le plus souvent possible en semaine. J’étais alors aussi ignorant de ma religion qu’on peut l’être du bouddhisme, et voilà que le drame sacré se déployait devant moi avec une magnificence qui surpassait toutes mes imaginations. Ah ! ce n’était plus le pauvre langage des livres de dévotion! C’était la plus profonde et la plus grandiose poésie, les gestes les plus augustes qui aient jamais été confiés à des êtres humains.
Je ne pouvais me rassasier du spectacle de la messe et chaque mouvement du prêtre s’inscrivait profondément dans mon esprit et dans mon cœur. La lecture de l’office des Morts, de celui de Noël, le spectacle des jours de la Semaine Sainte, le sublime chant de l’Exultet auprès duquel les accents les plus enivrés de Sophocle et de Pindare me paraissaient fades, tout cela m’écrasait de respect et de joie, de reconnaissance, de repentir et d’adoration! Peu à peu, lentement et péniblement, se faisait jour dans mon cœur cette idée que l’art et la poésie aussi sont des choses divines, et que les plaisirs de la chair, loin de leur être indispensables, leur sont au contraire un détriment. Combien j’enviais les heureux chrétiens que je voyais communier! Quant à moi, j’osais à peine me glisser parmi ceux qui, à chaque vendredi de Carême, venaient baiser la couronne d’épines.
Cependant les années passaient et ma situation devenait intolérable. Je priais Dieu avec larmes en secret et cependant je n’osais ouvrir la bouche. Pourtant, chaque jour, mes objections devenaient plus faibles et l’exigence de Dieu plus dure. Ah! que je Le connaissais bien à ce moment, et que Ses touches sur mon âme étaient fortes! Comment ai-je trouvé le courage d’y résister?
La troisième année, je lus les Ecritures posthumes de Baudelaire et je vis qu’un poète que je préférais à tous les Français avait trouvé la foi dans les dernières années de sa vie et s’était débattu dans les mêmes angoisses et dans les mêmes remords que moi. Je réunis mon courage et j’entrai un après-midi dans un confessionnal de Saint-Médard, ma paroisse. Les minutes où j’attendis le prêtre sont les plus amères de ma vie. Je trouvai un vieil homme qui me parut fort peu ému d’une histoire qui, à moi, semblait si intéressante; il me parla des «souvenirs de ma première communion» (à ma profonde vexation) et m’ordonna avant toute absolution de déclarer ma conversion à ma famille: en quoi aujourd’hui je ne puis lui donner tort. Je sortis de la boîte humilié et courroucé, et n’y revins que l’année suivante, lorsque je fus décidément forcé, réduit et poussé à bout. Là dans cette même église Saint-Médard, je trouvai un jeune prêtre miséricordieux et fraternel, M. l’abbé Ménard, qui me réconcilia, et plus tard, le saint et vénérable ecclésiastique, l’abbé Villaume, qui fut mon directeur et mon père bien-aimé, et dont, du ciel où il est maintenant je ne cesse de sentir sur moi la protection. Je fis ma seconde communion en ce même jour de Noël, le 25 décembre 1890 à Notre-Dame.
Paul Claudel, texte écrit en 1913
Peintures de Soeur Boniface
