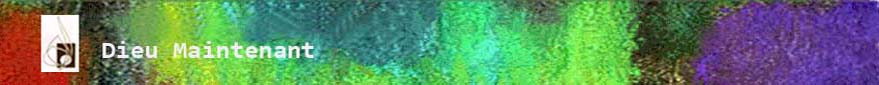

De l'obscur jaillira l'avenir
Lorsqu’un jubilé vient à l’idée
Jean-Claude Caillaux
Le pape François a convoqué un « Jubilé » (ou année sainte) pour 2025. Selon Jean-Claude Caillaux, un « jubilé » est comme une grande fête à laquelle tous sont conviés. Mais, précise-t-il, « si nous pensons la fête à partir de nos propres idées ou habitudes, et donc sans la contribution des plus pauvres, ces derniers seront maintenus dans les marges. (…) Exclus, non pas que nous les aurions chassés, mais parce que nous n’aurons pas conçu la fête avec et à partir d’eux… »

« Pour être sûr que personne ne soit oublié, nos invitations se doivent de commencer par le plus oublié…
Un jubilé ? À quoi pourrait-on le comparer ?
Un jubilé est comparable à une fête où serait convié tout le monde. Comme un repas, un très grand repas, où il n’y aurait pas un seul oublié.
Pour tout le monde, c’est-à-dire tous sans aucune exception. Parce que s’il en manque un seul, eh bien ce n’est pas pour tout le monde !
Si le jubilé est vraiment pour tous, il convient de s’asseoir pour réfléchir aux moyens à mettre en œuvre (voir Lc 14,28). Car nous n’avons pas l’habitude de rassembler tout le monde. Nos rencontres s’organisent plutôt par ressemblances et affinités… Alors comment s’y prendre ? Si je prends mon carnet d’adresses, il y a fort à parier que ne seront dans la salle du banquet que des gens que je connais, certes pas tous des amis, mais tous des gens plus ou moins comme moi… Et les autres ? Et c’est là toute la difficulté ?
Réfléchissons… Pour être sûr que personne ne soit oublié, nos invitations se doivent de commencer par le plus oublié, par celui que personne ne voit parce qu’il a peur de se montrer. Et pour l’appeler à la fête, ne faut-il pas le rencontrer, car dans la vie toute situation nouvelle commence par une rencontre. Car la rencontre engendre ce qui ne semblait pas possible.
Mais pas n’importe quelle rencontre. Une rencontre où, consentant à ne pas savoir à l’avance, nous nous exercerons à écouter. C’est un paradoxe : celui qui invite et qui donc doit parler pour expliquer, se retrouvera devoir se mettre à l’écoute. Parce que ce sera à l’invité de dire le sens et le centre de l’événement. Écouter pour entendre et pour apprendre ce que nous ignorons, non pour augmenter nos savoirs, mais pour nous laisser transformer. Pour enfin renoncer à nos manières de penser, catégoriser ou trier, et nous laisser transformer en laissant la priorité aux plus pauvres. Ce serait alors à partir de leur expérience et pensée, et avec eux, que nous penserons la fête, le repas, le jubilé pour tous, sans aucune exclusive.
Le plus oublié, le toujours absenté de nos rencontres, si nous l’inscrivons en premier sur la liste des invités, ne sera-t-il pas le garant que nous n’aurons oublié personne, ou du moins que nous aurons voulu n’oublier personne, et mis en œuvre notre volonté.
« Exclus, non pas que nous les aurions chassés, mais parce que nous ne les aurons pas mis au commencement de tout. »
Mais il ne suffit pas d’inviter ceux qui sont en dehors ou exclus de nos cercles habituels…, il nous faut les accompagner, rester proche et présent. Et continuer d’apprendre de leur expérience (Benoît XVI, Verbum Domini, 107), car « ils ont beaucoup à nous enseigner » (François, La joie de l’Évangile, 198). Il y faut du temps, sans doute une vie, tant notre surdité à l’Évangile est tenace, lui qui nous rappelle la jubilation de Jésus : « Je te bénis, Père, ce que tu as caché à des sages et à des instruits, tu l’as révélé à des tout petits », en notant que le mot grec utilisé signifie ceux qui sont exclus de la communauté parce que mal considérés (Lc 10, 21).
Le risque c’est que, dans l’organisation d’une fête, on en vienne à oublier l’essentiel, ou qu’il ait laissé sa place à l’accessoire, certes nécessaire mais second : la beauté des chants, la rutilance de la vaisselle et la fraîcheur des fleurs, et tout le reste… Quant aux invités…, ils sont assez grands pour se débrouiller tout seuls. Mais alors les plus timides et enfermés resteront à la porte. Tout est si bien huilé qu’ils n’oseront pas franchir le seuil. Exclus, non pas que nous les aurions chassés, mais parce que nous n’aurons pas conçu la fête avec et à partir d’eux, parce que nous ne les aurons pas mis au commencement de tout. Si nous pensons la fête à partir de nos propres idées ou habitudes, et donc sans la contribution des plus pauvres, ces derniers seront maintenus dans les marges.
La question ne manquera pas de venir à l’idée du lecteur : apprendre des plus pauvres, oui bien, mais qui sont-ils et apprendre quoi ?
Les plus pauvres, ce sont ceux que personne n’écoute ni ne regarde, parce qu’ils sont « de trop en ce monde, … sans raison de croire, ni d’exister…, happés par les chemins, … fuyant de lieux en lieux, méprisés et honnis » (père Joseph Wresinski, 17 octobre 1987). Ils sont absents, absentés, voire rejetés, de tous les groupes que nous organisons pour nous-mêmes. « Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? » (Jn 1, 46) Le plus pauvre, c’est la pierre rejetée (voir Ac 4, 11).
Quant à la seconde question (qu’apprendre ?), y répondre serait imaginer une forme de catalogue à consulter, alors qu’il convient de rencontrer les plus pauvres, et de les laisser nous enseigner, sans retenue ni préjugés : ce qu’ils nous apprendront dépassera ce qui est imaginable. Car c’est de Dieu et de l’humain qu’il s’agit « et d’un agrandissement de l’œil aux plus hautes mers intérieures » (Saint-John Perse).
Jean-Claude Caillaux, septembre 2025


