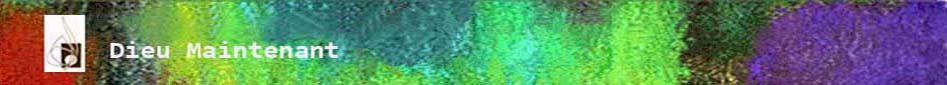

Dieu est dé-coïncidence
François Jullien (1)
Dire que « Dieu est dé-coïncidence s’oppose à une vision de Dieu comme celle d’un Être immuable. Pour François Jullien, Dieu n’est pas ailleurs que dans cette force qui pousse chacun à s’ouvrir à l’Autre et aux autres. Il fissure ce qui est enclos, ce qui « coïncide ». Il écrit : « De fait, si l’Évangile est dé-coïncidant, l’Église, quant à elle a re-coïncidé. Elle a même sur-coïncidé. (…) Pourra-t-elle rouvrir de l’écart vis-à-vis d’elle-même pour décoller – se décaler – de ce qui la fige, fissurer la chape d’adéquation idéologique dans laquelle elle s’est bloquée et se remettre elle-même en chantier ? »
François Jullien, né en 1951 à Embrun (Hautes-Alpes), est un philosophe, helléniste et sinologue, professeur à l'université Paris-Diderot et titulaire de la Chaire sur l'altérité au Collège d'Études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme.

« Saura-t-on ou non entendre l’inouïe de la Nouvelle en dé-coïncidant de tout l’entendu ? »
Le propre de la dé-coïncidence est, en fissurant la coïncidence, de rouvrir des possibles, et d’abord dans la vie. Dans Jean, ce sont des possibles non encore envisagés ou proprement in-ouïs. S’y entend un radicalement nouveau : « Jamais personne n’a parlé comme cela » (Jn 7,46). (…) La ressource du christianisme, pour la résumer d’un mot, est de croire qu’un radicalement nouveau, jamais encore entendu soit possible. (…)
« L’inouï, de l’ordinaire, émergeant dans le quotidien… »
Or, si ce thème du nouveau est commun aux quatre évangiles, Jean lui confère une force particulière : car il n’y a de radicalement nouveau que par dé-coïncidence, écart ouvert d’avec le passé et séparant, de fait, du passé. C’est seulement à cette condition qu’un nouveau est effectif et n’est pas seulement fantasmé : il y faut se travail de la dé-coïncidence décalant de ce qui s’est installé dans son adéquation, s’en satisfait et s’y sclérose.
Sinon, ce nouveau invoquant à grands cris la rupture n’est « nouveau » que par un renversement qui ne changera rien aux conceptions et conditions inversées. (…) De là la seule question qui tienne : saura-t-on ou non entendre l’inouïe de la Nouvelle en dé-coïncidant de tout l’entendu ? Sinon cet inouï, ne pouvant être entendu et reçu, ne peut être jugé que folie : « Beaucoup d’entre eux disaient : un démon le possède et il est fou : pourquoi l’écoutez-vous ? » (Jn 10,20). Tel est, en effet, le sort logiquement réservé à l’inouï. Or en même temps s’entend bien quelque chose à travers ce qu’on n’entend pas, s’y entrevoit un possible, mais qui échappe à la conception : « D’autres disaient : ces choses ne sont pas d’un possédé du démon. » De là que l’écoute de l’inouï ne peut que diviser, entre les auditeurs, et s’exerce d’abord comme une violence, la pire violence ou la plus intime : « Jusqu’à quand vas-tu nous arracher l’âme ? »De fait, la notion d’inouï en elle-même n’est pas simple, ou plutôt elle est double : il y a deux inouïs. Il y a l’inouï au sens ordinaire du terme qui est précisément l’extraordinaire, l’exceptionnel ou l’insolite et perçu, par conséquent, comme l’étrange ou le prodigieux. Cet inouï est couramment, dans l’Évangile, celui du miracle. Dans Matthieu, dans Marc, surtout dans Luc, Jésus fait des miracles en séries. (…) Or, Jean est plus économe de cet inouï et de sa mise en scène. (…) S’il n’a pas plus besoin de ces « prodiges » (terata) qui sont alors des signes (semata, 4,48), c’est qu’il est bien un autre inouï, inverse, qui l’intéresse sans doute davantage : c’est l’inouï, non de l’extraordinaire, mais au contraire apparu au sein du plus proche et du plus ordinaire. C’est l’inouï de ce qui arrive au plus près, qu’on a sous les yeux, mais qu’on ne voit pas ; de ce qui est dit devant nous, et même qui s’adresse à nous, mais qu’on n’entend pas. Et cela parce qu’on n’est pas en capacité de l’entendre – de là qu’il demeure « in-ouï ». (…)
Jean, quant à lui, après avoir pensé Dieu dé-coïncidant de Dieu en son Fils devenu « chair » sur la Terre, radicalise cette entrée : « Au milieu de vous se tient un homme que vous, vous ne connaissez pas. » Il est devant vous, parmi vous, et vous ne reconnaissez pas cet inouï qu’il est. Tel est cet autre inouï, de l’ordinaire, émergeant dans le quotidien, mais auquel on n’accède pas.Ou plutôt, parce qu’il se présente d’emblée à nous dans le quotidien, qu’il n’y a pas de distance mythique pour le rehausser, on le méconnaît et passe à côté. Or il n’est pas pourtant d’inouï plus grand que Dieu fait homme parmi les hommes : vivant dans l’ordinaire de la vie et de la condition humaines. Dieu présent en homme parmi les hommes et s’adressant à nous est, dit Jean, cet inouï dans l’ordinaire – ou ce miracle au quotidien – dont nous ne savons pas nous « étonner », que nous ne savons pas rencontrer. (…)
Cet inouï véritable ne se situe pas tout au bout, à l’extrême de mon expérience, par sa rareté, mais le plus au cœur de mon expérience dans sa quotidienneté, et c’est pourquoi il est si difficile d’y accéder. C’est pourquoi aussi, pour commencer d’entendre cet inouï de la Nouvelle, il faut commencer par ouvrir un écart, en soi-même, d’avec tout ce qui a été dit, par-dé-coïncider de tout ce qu’on a entendu : autrement dit déborder, pour l’aborder, les cadres déjà constitués – coïncidants – de mon expérience comme de ma pensée (2).« Si l’Évangile est dé-coïncidant, l’Église, quant à elle a re-coïncidé... »
(…) On objectera que c’est bien néanmoins sur la coïncidence de son dogme que l’Église a dû de se bâtir, de demeurer inébranlable et de traverser les siècles. De fait, si l’Évangile est dé-coïncidant, l’Église, quant à elle a re-coïncidé. Elle a même sur-coïncidé. Plus l’Évangile a ouvert d’écart d’avec la pensée installée, plus son message est scandaleux (la « folie » de la Croix), plus l’Église a bétonné, en revanche, à coups d’exclusions et de condamnations, au cours des siècles, son catéchisme. Déjà le monument de sa théologie a abouti si souvent, par son appareil théorique, à instaurer une adéquation intellectuelle faisant coïncider l’esprit avec une « vérité » qui par conséquent le satisfait, mais recouvre par là l’expérience : la théologie n’a-t-elle pas si souvent servi à déminer et trahir la dé-coïncidence que dit « Dieu » en inquiétant l’existence ? Que reste-t-il du vif de l’existence, en effet, sous tant de catégories devenant coïncidantes – de la « christologie », de la « pneumatologie » ou de l’« eschatologie », etc. – se figeant en savoir constitué et par suite se muant en autorité ? Car le propre de la Coïncidence est bien sûr que son savoir tend à se sceller en pouvoir : à la fois elle le consacre et s’en trouve étayée.
Ce sont de ce fait les dissidences doctrinales et les « hérésies », tout au long de l’histoire de l’Église, qui par leur dé-coïncidence courageuse et même si souvent héroïque, ont rappelé le christianisme à son exigence : autant d’écarts (les vaudois, la Réforme, Port-Royal…) qui l’ont ravivé. Car, en devenant l’objet d’une adhérence qui se généralise et même se prétend universelle, et donc ne se questionne plus, il est fatal que le message de l’Église ne soit plus, du coup, qu’idéologique. Car qu’est-ce que l’« idéologie », en effet, si ce n’est qu’une idée – parce qu’elle est collectivement assimilée, n’est donc plus interrogée – sécrète d’elle-même son obédience et s’en trouve confortée ? Au point que l’Église a pu imposer son oppression sans pitié et de façon systématique, sans même en être inquiétée. La coïncidence idéologique imposée en France après la Révocation de l’Edit de Nantes – « une foi, une loi, un roi » : peut-on imaginer en effet formule plus coïncidante ? – s’est scellée politiquement dans la monarchie absolue. L’Alliance « du trône et de l’autel » marque le paroxysme de cette Coïncidence intronisée qui a soutenu l’Église, mais l’a perdue.
C’est d’ailleurs parce qu’elle a si fortement coïncidé avec elle-même que l’Église a pu, au cours des siècles, se dépraver sans plus s’en troubler et même en maintenant comme allant de soi la loi du silence : aujourd’hui encore, dans ce qu’on découvre d’abus sexuels tenus si longtemps à couvert et couramment acceptés, sans qu’on songe à s’en révolter, tant l’effet de coïncidence, en effet, se cimente de lui-même, s’auto-conforme et s’auto-confirme, devient compact et bien scellé. On a vu alors combien l’abus, par opacité, due elle-même à la compacité de la coïncidence, sait se protéger. Jusqu’à faire croire à l’irresponsabilité, par suite à l’impunité. De là la question cruciale qui se pose aujourd’hui à l’Église, me semble-t-il, comme « assemblée » : peut-on concevoir un commun effectif (participatif) qui ne se croit pas le collectif (idéologique) de la Coïncidence ? Pourra-t-elle rouvrir de l’écart vis-à-vis d’elle-même pour décoller – se décaler – de ce qui la fige, fissurer la chape d’adéquation idéologique dans laquelle elle s’est bloquée et se remettre elle-même en chantier ?
« Si peu qu’on dé-coïncide, on est d’emblée dans l’effectif et donc à l’œuvre… »
Car il ne s’agirait pas seulement alors pour l’Église de se « laver » (de ce qui l’a souillée) ou même, comme on dit, de faire peau neuve. Un aggiornamento serait-il lui-même suffisant ? On n’aura pas encore touché aux raisons internes qui font son blocage actuel dans l’Histoire. Il ne peut s’agir seulement de « s’adapter », comme il est si facile de le dire, pour s’accorder aux évolutions des mœurs et de la société. S’adapter reste conformiste, n’engage pas une initiative et ne change rien ou si peu à l’ensemble des adéquations installées qui figent et paralysent. Ou bien on réclamera que, plus intérieurement, l’Église puisse se « réformer ». Mais une Réforme n’est possible qu’à certains moments de l’Histoire catalysant des forces : il y faut une inspiration. Or je ne suis pas sûr que celle-ci ne fasse pas défaut à notre époque. En revanche, si peu qu’on dé-coïncide, on est d’emblée dans l’effectif et donc à l’œuvre. Et se rouvrent du même coup des possibles qui, loin d’être des fins projetées, ne sont peut-être pas même encore imaginés.
Car le christianisme pourrait alors, selon la capacité de dé-coïncidence qui l’a originairement porté, travailler à fissurer l’état saturé et satisfait de ce monde, ce qui est encore plus nécessaire aujourd’hui en régime de marché mondialisé, de souveraineté technologique et d’obédience médiatique scellant le monde en une Coïncidence généralisée qui n’est plus inquiétée. Et, dans les fissures apparaissent alors au sein de ce qui se bloque en « monde », appeler à faire circuler « de l’esprit ». Le propre du monde étant de s’enclore dans sa commune mesure qui fait « monde », « Dieu » dé-coïncidant figure un hiatus d’incommensurabilité au sein du monde et même en tout recoin du monde. Car la dé-coïncidence est de terrain et c’est ce qui, partout où elle s’investit, la justifie.
« Dieu » déjà est dé-coïncidence dans le terrain de l’humain : fissurant ce qui bloque l’humain dans son adéquation trop humaine et rouvrant des possibles à l’humain et dans l’humain. Pourrait-il en aller de même dans l’Église ? Au risque, sinon que son message de déborder l’humain dans l’humain soit perdu ; que l’inouï qu’a fait entendre un jour sa « Bonne Nouvelle » dans le monde ne soit pas entendu. Car ce n’est pas que le monde soit devenu laïque ou ne croit plus à « Dieu » qui fait problème, mais qu’on ne sache plus, en dé-coïncidant du monde, mais sans rejeter pour autant le monde, y percevoir de l’inouï (3).
François Jullien, mise en ligne janvier 2025
Peintures de Dominique Penloup1- Cet article est extrait du livre de François Jullien Dieu est dé-coïncidence, LABOR ET FIDES 2024 / Retour au texte
2- Ces deux premières parties sont composées d’extraits des pages 61 à 67 (Opus cité) / Retour au texte
3- Ces deux dernières parties sont extraites des pages 98 à 103 (Opus cité). / Retour au texte

