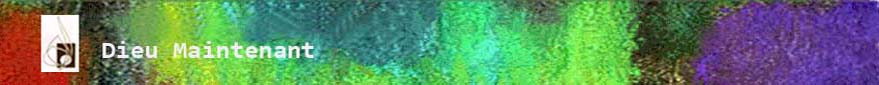

Et pourtant elle parle, l'humanité... malgré la mort
Jean-Claude Caillaux
Jean-Claude Caillaux est permanent du mouvement ATD Quart Monde. Il rencontre des personnes qui vivent - et souvent meurent - dans la rue.
"Ils m’ont « requis », écrit-il. C’est pourquoi j’y suis allé. Comme « une impossibilité de se dérober ». J’espère leur amitié. C’est sans doute ma seule activité."
Les sous-titres sont de la rédaction.
« Vies écrasées, dans la détresse, le mépris,
la solitude, l’errance, le manque, l’hébétude
– et la violence.
Terrible tableau d’humanité,
largement dissimulé par la surface de discours
et d’images ! »
Maurice Bellet, La Quatrième hypothèse.
« J’habite une douleur. »
René Char, Fureur et mystère.
" Encore vifs mais disparus "Il en est qui meurent dans la rue. Accident de la circulation, arrêt cardiaque, agression, violences diverses... C’est la vie, j’allais dire. Celle d’aujourd’hui. Avec ses aléas. Les circonstances, la malchance. Sans que ce soit écrit. Rejoints par le terme, dans la rue. Toujours à l’improviste bien sûr. C’est la mort.
Il en est d’autres. Quelques-uns. Qui meurent de la rue. De la rue. Parfois à l’hôpital, ou même sur la voie publique.
Ils étaient dans la rue. Depuis un ou deux ans, dix, quinze, vingt, plus encore. Tombés dans le dédale. À la suite de ruptures. Graves. Profondes. Sans remèdes peut-on penser... Surtout, souvent, sans continuité avec ce qui avait précédé. Un jour la rue les broie davantage que la veille. C’est leur vie. Et leur mort. D’une petite minorité. (Qui pourrait bien être signe pour les autres: « Montrez moi la mort du plus faible... Et je vous dirai où vous en êtes dans votre quête...»).
Je ne suis guère habilité pour écrire sur les personnes qui meurent de la rue. De cette mort, brutale, violente, muette, loin, je n’en ai jamais été le témoin, qui pourrait parler, raconter, pour mettre des mots, tenir à distance, tirer les leçons, tenter d’expliquer pour comprendre. Et je n’habite aucune des chaires qui me prêteraient l’autorité pour décrypter, décoder, interpréter, lire puis dire la vérité, celle des symptômes et des signes, ce grand empire.
Simplement, je rencontre des hommes, quelques femmes, qui vivent dans la rue. Dans la marge du si large texte qu’est la vie des autres. Marge rognée par le massicot pour que la page soit nette, propre. Une coupure-démarcation. Ségrégation. Cassure. Liquidation. Ils sont « en dehors de tous les mondes que se sont forgés les autres »(1). Avalés par eux, engloutis. Disparus. Encore vifs, mais disparus. Absents parce qu’absous et absentés de la vie commune.
J’essaie d’entrer dans cet en-dehors. Mais ne sais pas plus que quiconque. Chaque jour, j’ai même le sentiment d’en savoir moins, parce que l’explication ou ce qui déshabitue de l’essentiel (2) ne cessent de me rejoindre, ou la volonté de comprendre et donc inconsciemment de prendre, de saisir, de griffer, pour oublier, ne plus voir, ne plus savoir.
Permanent du Mouvement ATD Quart Monde, c’est à ce titre que je rencontre des personnes qui vivent dans la rue. Je reste avec elles quelques minutes ou quelques heures. Laissant s’établir ce qui peut se nouer. Me laissant atteindre. (Jusqu’où? J’entends la question.) Ils m’ont « requis », me semble-t-il. C’est pourquoi j’y suis allé. Comme « une impossibilité de se dérober »(3). J’espère leur amitié. C’est sans doute ma seule activité.
J’espère. Lorsque ce sera avec eux, le chemin pour qu’ils s’en sortent se sera entr’ouvert.
Les lignes qui suivent sont des traces. D’une façon de sentir, de réagir, de voir et de regarder, d’entendre. Sans doute peu de rapport avec ce qui est, tant il est vrai que «les paroles déforment, diminuent la grandeur des sentiments, les meurtrissent presque toujours»(4).
Et pourtant.
Une question lancinante comme une blessure
C’est un « choix d’humanité,[...] préférence que l’homme soit plutôt que non; et pas en abstrait : en cet humain qui est mon proche ».(5)
Ils disparaissent. Bien avant de mourir! Mais dites-moi: d’où vient donc leur habit, tissé de cendre ? Et qu’est-ce qui s’absente lorsqu’ils disparaissent? Eux, ces absents..., qui respirent dans la nuit «à laquelle l’obscurité manque, sans que la lumière l’éclaire»(6), l’autre côté de la nuit...
Ce long peuple qui ne vit qu’exposé..., « regard[ant sa] vie d’une autre rive(7)»: j’entends son cri qui excède même le cri et ce « pleurement sans larmes » dont parle Blanchot(8).
Faudrait-il atteindre en lui ce lieu, secret, saturé, enfoui, obscurci, tel un fragment de nuit, que personne jamais n’a aimé ?
Comme un sourire qui jamais ne parvient jusqu’aux yeux...
« Là où nous avons à la fois l’obscurité et la lumière, nous avons aussi l’inexplicable »(9).
C’est sûrement vrai de tout être humain. Mais je perçois, presque de manière tangible, que cette phrase décrit, désigne, révèle, celui qui est rejeté de tout et de tous.
Un regard d’ombre et de lumière qui ne conduit qu’à l’inexplicable. Et donc sans doute à la peur du « spectateur », et à sa volonté de comprendre, de saisir dans les rets (qui dit piège) du concept.
Inexplicable. Inexprimable.
Théologie négative ? Apophatisme ? Il faudrait convenir que les ombres que je rencontre, qui ont visages et sourires, langage et pensée, sont de quelque façon signes d’un Dieu. En creux. Pourquoi pas ? Ce n’est pas impossible... Et pourtant ! Arrière les baptiseurs de l’horreur, qui autorisent ainsi le déni du malheur ! L’être humain est plus sérieux que Dieu... Oui, précisément, et c’est en y prenant garde qu’il arrive qu’on le découvre, le Dieu, le faible plus faible que les faibles, – à l’improviste. Non pas dans le tonnerre. Ni dans la terre qui tremble. Il n’est qu’une « voix de fin silence », comme traduit Levinas la qol demamah daqqah du Premier livre des Rois...(10)
Ce que dit Charles Juliet sur Beckett me semble tellement proche de ce qui m’impressionne chez les personnes que je vais rencontrer dans la rue:
«(...) Un silence qu’on ne peut atteindre qu’à l’extrême de la plus extrême solitude, quand l’être a tout quitté, tout oublié, qu’il n’est plus que cette écoute captant la voix qui murmure alors que tout s’est tu. Un étrange silence, oui, et que prolonge la nudité de la parole »(11).
Je ne suis qu’un passant.
Un hôte.
Un étranger.
Je peux fort bien l’oublier mais ne le dois pas.
Au nom de quoi m’approcher d’un monde que tout manifeste comme étrange ?
Simplement au nom de l’humain de l’humain. Cela suffit-il de répondre ainsi ? Ne serait-ce pas la route empruntée pour supprimer la question, lancinante comme la blessure qui résiste ?
La question demeure pourtant : au nom de quoi, au nom de qui ?
La tentation d’y répondre existe : elle est une épreuve pour tenter d’avoir maîtrise, volonté d’efficacité: ce qui serait instrumentaliser ma présence, la réifier. Peut-être la profaner pour la faire paraître utile. Et donc m’interdire la communion au silence trop bruyant de ceux que je rencontre dans les interstices de l’ordinaire.
La question demeure.
Tous ces hommes, rejetés par les eaux, se construisent-ils un monde, des mondes ? Attendent-ils une parole ? Une issue ?
Et si leur condition de vie était insensée, dénuée de tout sens ?
Et si se faire présent à leur malheur n’était que la route subtile, ouverte à force de désespérance, qui permette de résister à l’insondable agression qu’ils sont ?
Et si chaque vie n’était qu’une île ?
Et si la présence n’était qu’un mot, – dissimulant du mieux qu’il peut sa réelle signification : absence.
Et si, et si...
Autant de questions que toutes les réponses ne font qu’aviver... et questionner encore...
Il y a toujours, ici ou là, sur les places et du haut des chaires, dans les ornières de la militance ordinaire, des gens pour répondre, des chantres de l’assurance, du savoir et de l’expérience... Parfois en entendant les doctes commentaires j’ai seulement envie de dire, malgré le brouhaha : Et si la question essentielle ne cessait de jaillir de ces regards obturés : « Dites-moi, suis-je encore un homme ? »
À cette question, insupportable, y aurait-il une réponse qui ne soit pas faux-fuyant ? Et faut-il d’ailleurs répondre par des mots, – qui comme toujours détournent du scandale ?
Ni réponses, ni questions...
Alors quoi ? Un lent silence, et le désespoir..., encore une fois baptisés du doux mot de présence ?
Et si cette dernière question n’était qu’une question de trop, – cherchant encore et encore à saisir la sécurité du comprendre ?Témoin de l'abîme
« La grande énigme de la vie humaine, ce n’est pas la souffrance, c’est le malheur », écrivait la philosophe(12). Un malheur qui ne peut se dire... Et pour cause, puisqu’il colle à la peau. Ou plutôt colle au coeur, au coeur du coeur, comme semble le suggérer Itzhak Zuckermann, survivant de la Shoah, lorsque interviewé par Claude Lanzmann, il affirme : « Si vous pouviez lécher mon coeur, il vous empoisonnerait »(13).
Osman, rencontré sur le quai du métro, de quelles détresses est-il le paradigme?
Le malheur qui l’assaille. L’accable et le cercle en lui-même. Le rend muet. Beaucoup trop volubile parfois.
Englouti par le malheur...
Les joues, le front, le nez, le menton rongés. Abîmés. Même le sourire qu’il m’adresse est cassé. Et les yeux perdus. Oubliés.
Le passage chez cet homme, inattendu, du silence à la colère ne serait-il pas le passage du désespoir à la colère?
« Je manquais de moi dans un deuil abyssal », semble-t-il dire, reprenant Jean Bastaire au seuil de ses Psaumes de la nuit et de l’aurore.
Comment (pourrait-il) faire face ? Et comment (pourrait-il) affronter cette souffrance du malheur? Cette douleur, (n’est-elle que douleur?), sans ouverture d’avenir. Comme une nuit qui essaime une autre nuit, plus nocturne encore...
Être le témoin de cet abîme est insupportable...
Ils sont signes, dites-vous ? Bien plus que symptômes.
Comment donc un signe peut-il être perceptible, porté par l’obscurité ?
Que reste-t-il lorsque semble advenue déjà la destruction de soi ?
De quoi est-il témoin? De quelle vérité, abîme peut-être, routes ou impasses ? De quelle souffrance, de quelle douleur ou fureur ? De quelle espoir, de quelle nuit ? Quelle est pour lui la couleur du soleil ? Et le sens de la lumière ?
Et qui peut témoigner pour lui ? Attester la vérité de ce qu’il vit ?
Serait-il un témoin pour lequel il n’est pas de témoin ?
Pourquoi refuser de l’admettre ?
N’est-ce pas précisément de cela qu’il faut témoigner ?
Résonne en moi ces mots de Paul Celan, que j’ai gardés longtemps devant moi : « Nul ne témoigne pour le témoin. »
Et pourtant...
Il y a quinze jours, son sourire m’avait frappé... Son visage illuminé, sans apparente raison...
Mais aujourd’hui son silence m’effraie...Tant il m’ouvre sur le vide. Qu’est-ce qui s’échappe dans ce mutisme ? Et dans son regard qui nulle part ne s’arrête ?
Quel sens à ce qui ne porte apparemment pas sens ? Apparemment.
Il y a chez cet homme comme une saturation, un vide saturé de vide...
Où est-il en lui l’humain de l’humain ?
Qu’y a-t-il derrière ce visage ?
Quel signe est-il, dans sa dureté, sa stridence ?
« C’est terrible un homme qui appelle ! Ça ne vous laisse plus de repos »(14).
Je repense à tant d’hommes qui ressemblent aux descriptions que leurs proches et amis ont fait de BramvanVelde ou de Samuel Beckett : enfermement dans le mutisme, des heures dans l’immobilité, le regard fixé devant eux.
Qu’est-ce qui les distingue ?
Est-ce la même expérience ?
Frôlent-ils le même abîme ?
D’où vient que Bram van Velde ou Beckett y aient puisé force et audace pour peindre et écrire ?
Se trouver, « au milieu du chemin de (la) vie », « dans une forêt obscure (...) féroce et âpre et forte (...) si amère que mort l’est à peine plus».
Serait-ce que « la voie droite était perdue »(15)?
Ainsi sombrent-ils sans cesse dans les rets de la morale reçue comme entre les mains du contrôle et de la répression.
C’est d’autre chose qu’il s’agit. De navires en perdition. De l’angoisse et du désespoir de ne plus trouver le port.
Qu'est-ce donc qui implore ?
À nouveau rencontré Osman. Vêtu de guenilles, par couches superposées. Je ne vois pas ses yeux, ils sont mi-clos, les paupières suppurant. Il mange une pomme, qu’il découpe en tout petits morceaux. Les deux tiers de ses dents, en haut, sont absentes. Il ouvre grand la bouche, et rit. Un visage qui n’est que paradoxe : une forme de gaieté, peut-être de joie, sur une peau recouverte de pourriture.
Qu’est-ce donc qui implore en lui ?
« Être là, regarder, se taire, en croire ses yeux. Comme un peu disparaître ». Mais « ce n’est pas facile de voir. Il faut même un certain courage. On ne l’a pas tout le temps », et puis « que veut dire voir alors qu’on ne voit jamais(16) ?»
À cette question, Egon Schieleme semble répondre : « Le peintre sait regarder mais voir est quelque chose de plus(17) ».
Il faut conclure. Sans prétendre résumer.
J’emprunte volontiers la voix de Louis-René des Forêts.
Vingt trois ans après la perte de sa fille il écrit les Poèmes de Samuel Wood, où je lis :
« Irréparable cassure. Prenons-en acte. Nous voilà désolés la vie durant, Notre mémoire ouverte comme une blessure »(18). Et à la toute dernière page de son autobiographie, il pensait pouvoir confier qu’« il n’y a que le coeur qui se souvienne »(19).
Jean-Claude Caillaux
Pastel de Pierre Meneval, "La cour des grands".
(1) Joseph Wresinski, «Les plus pauvres, révélateurs de l’indivisibilité des Droits de l’Homme », dans 1989. Les Droits de l’Homme en questions, p. 222./ retour au texte
(2) Martin Heidegger désigne ainsi l’habituel qui « possède en propre cet effrayant pouvoir de nous déshabituer d’habiter dans l’essentiel et souvent de façon si décisive qu’il ne nous laisse plus jamais parvenir à y habiter » (Qu’appelle-t-on penser ? p. 141)./ retour au texte
(3) Cf. ce que dit Emmanuel Levinas de l’autre qui « requiert ». Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 73./ retour au texte
(4) Joseph Wresinski, Paroles pour demain, p. 63. / retour au texte
(5) Maurice Bellet, La quatrième hypothèse. Sur l’avenir du christianisme, p. 57. / retour au texte
(6) Maurice Blanchot, L’écriture du désastre, p. 8. / retour au texte
(7) Jean Sulivan, Quelques temps de la vie de Jude et Cie, p. 142. / retour au texte
(8) Maurice Blanchot, op. cit., p. 38. / retour au texte
(9) Samuel Beckett, cité en exergue du livre d’entretien de Charles Juliet, Rencontre avec Samuel Beckett, p.9. / retour au texte
(10) Ainsi que le raconte Roger Laporte, Études, p. 236. / retour au texte
(11) Charles Juliet, op. cit., pp. 12-13. / retour au texte
(12) Simone Weil, Attente de Dieu, p. 101. / retour au texte
(13) Claude Lanzmann, Shoah, p. 242. / retour au texte
(14) Andrée Chedid, Derrière les visages, p. 112. / retour au texte
(15) Dante, La divine comédie. L’Enfer, I, 1-7, p. 27. / retour au texte
(16) Gil Jouanard, «Le jour et l’heure », La Nouvelle Revue Française, 540 (janvier 1998), p. 33 ; Bram van Velde, dans Charles Juliet, Rencontres avec Bram van Velde, pp. 49, 93. / retour au texte
(17) Cité par J.-B. Pontalis, En marge des jours, p. 41. / retour au texte
(18) Louis-René des Forêts, Poèmes de Samuel Wood, p. 14. / retour au texte
(19) Louis-René des Forêts, Ostinato, p. 233. / retour au texte


