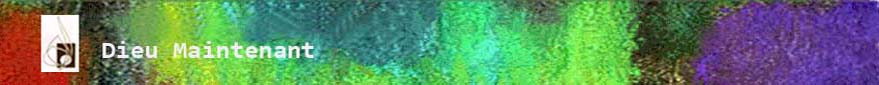

La vocation de théologien
Joseph Moingt
Pendant douze ans, Joseph Moingt a partagé la réflexion des responsables de la paroisse Ste Bathilde, dans la banlieue parisienne, dont Michel Jondot était curé. En répondant, à partir de cette expérience, aux questions que lui a posées Christine Fontaine, il nous livre quelques convictions sur l’Eglise et son avenir. Ce texte est extrait du livre : "L'Eglise se fait conversation" Michel Jondot et ses amis, p. 225 à 241.
Les sous-titres sont de la rédaction.

Théologien : un métier ou une vocation ?
En me demandant de contribuer à ce volume d’hommages offerts à Michel Jondot, – ce que j’ai accepté comme un « devoir de mémoire » autant que d’amitié fraternelle –, Christine Fontaine m’avait suggéré pour titre : « Théologien, quel métier ! » Le point d’exclamation laissait entendre – et elle en sait quelque chose – que c’est un métier passionnant mais aussi source de lourdes préoccupations, de fatigues, de tracas, de dangers, – ce qui est bien vrai et je ne manquerai pas de le montrer à l’occasion. Si j’ai cependant préféré le mot « vocation » à celui de « métier » ou de « profession », ce n’est pas avant tout pour éviter de reprendre des mots déjà mis en valeur par d’autres théologiens, alors que des linguistes pourraient me faire remarquer qu’un même vocable en allemand (beruf) signifie à la fois « vocation » et « métier » ou « profession ». Je n’ai pas fait ce choix non plus dans l’intention secrète de donner au terme « profane » de « métier » un caractère « sacré », au sens où l’on parlait (jadis dans certains milieux !) de la « vocation » d’officier ou de médecin ou (surtout !) de prêtre.
Mais plutôt pour souligner la signification d’ «appel» incluse dans le mot « vocation » et pour me demander d’où, de qui vient cet appel auquel répond le théologien ; et, en parlant de la vocation « du » plutôt que « de » théologien, je voudrais faire entendre que cet appel vient du dehors autant sinon plus que du dedans.
C’est dans cet esprit que je traiterai des quatre sujets sur lesquels Christine m’interroge : la fonction du théologien dans l’Église de demain,– le prêtre, homme de la parole avant d’être celui des sacrements,– l’intérêt du théologien pour les paroisses,– l’avenir de l’Église à partir de petits groupes de croyants.
En m’arrêtant à ces questions qui me sont posées, et à elles seules, je prouverai, pour ma part, que le théologien répond bien à un appel qui lui vient du dehors. Si je les prends, à vrai dire, dans l’ordre inverse où elles m’ont été posées, ce sera seulement pour y mettre ma petite touche d’indépendance personnelle, et peut-être par jeu !Le théologien et les questions de demain
A ton avis, quelle devra être la fonction du théologien dans l’Église demain ?
Il eût sûrement été plus logique de répondre à cette question sur l’avenir du métier de théologien à la place où elle m’était posée, la dernière. Je l’ai sans doute fait passer à la première place parce que c’est la question qui me préoccupe le plus aujourd’hui, au risque de démontrer, à l’encontre de ce que je voudrais prouver, que le théologien répond par priorité aux questions qu’il se pose en son for intérieur. Et pourtant, en cette fin de vie où j’aborde ce sujet, mon avenir de théologien n’a pas vraiment de quoi m’angoisser ! C’est bien de la fonction du théologien, dans un temps qui ne sera plus le mien, qu’il s’agit : d’où, de qui lui viendra l’appel à parler, un appel capable de susciter des théologiens et de les mettre au travail ?
Mais, pour éclairer la question du futur, je remonterai au commencement, au début de ma carrière de théologien. Si fort que la théologie m’intéressât au temps où je l’étudiais (à supposer que j’aie cessé de le faire), je n’envisageais pas d’y faire carrière, je ne me suis pas proposé pour l’exercer. Un jour, tout à la fin de ce qu’on n’appelait pas encore le “second cycle” des études ecclésiastiques, mon supérieur provincial jésuite me convoqua pour m’annoncer qu’il me destinait à être professeur dans notre faculté (on disait alors “scolasticat”) de théologie, et il le fit à peu près en ces termes : “Il n’y a pas là de quoi vous affoler ni vous flatter : tout ce qu’on vous demandera, c’est de répéter l’enseignement de l’Église.” Comme les presbytres des premiers siècles, qui n’étaient pas tournés vers l’autel mais vers le peuple, le théologien était censé se tenir entre le Magistère de l’Église et ses futurs ministres, qui répéteraient plus tard aux fidèles ce qu’ils auraient appris, pour leur transmettre les vérités de l’Écriture et de la Tradition telles qu’elles avaient été interprétées, énoncées et fixées par le Magistère au cours des siècles. Ce que je fis (à ma manière !) durant de longues années où je n’avais pas l’audace de me considérer comme un théologien qui expose sa propre pensée, mais comme celui qui enseigne ce qu’il tient d’une source autorisée.
Mais un temps vint où le théologien changea de place et de posture, c’était à peu près à l’époque où Michel me fit venir à Sainte-Bathilde : il ne restait plus cantonné dans un séminaire à enseigner à des clercs, il allait en paroisse, pas seulement parler, mais aussi écouter les fidèles, les interroger, et il se retournait vers la hiérarchie de l’Église, non bien sûr pour l’enseigner, mais pour lui faire connaître la pensée du peuple chrétien, ses sentiments, ses interrogations, ses souhaits, et même ses doléances sur des questions relevant de la vie de l’Église, des pratiques liturgiques, des règles de morale et aussi du dogme, – il se faisait le porte-parole du peuple chrétien, il prêtait sa voix (ou sa plume) à ce qui commençait à devenir une “opinion publique” de catholiques français. Oserai-je dire que les (des) théologiens commençaient à se “séculariser”, à se “laïciser” ? Ils quittaient l’enceinte sacrée, ils n’enseignaient plus exclusivement la “doctrine sacrée” à un auditoire présélectionné, ils n’enseignaient même plus vraiment là où ils allaient en mission, mais ils se prêtaient aux questions d’un public laïc, majoritairement croyant mais pourtant rétif aux arguments d’autorité, parfois agressif, et ces théologiens acceptaient de se remettre en question,– eux-mêmes et la façon d’exercer leur charge, et la source et l’étendue de leur autorité, et même la doctrine qu’ils colportaient - ils entraient en dialogue et en recherche sur bien d’autres sujets, étrangers à leur “profession”, qui émanaient de la vie dans le “siècle” et de la marche du siècle.Les questions qui me hantent
Le temps a passé et j’en viens vite à la situation présente. Les églises se sont vidées, les séminaires aussi : y aura-t-il encore des théologiens demain, seront-ils disponibles pour s’adresser à tout venant, et d’où leur viendra l’appel à prendre la parole ? Du rare public resté fidèle, sans doute, mais qui s’occupera d’adresser au monde incroyant la parole de Dieu ? Le Magistère de l’Église, sans doute encore, mais qui en appellera à lui dans un monde qui ne lui accorde plus de crédit ? Telles sont les questions qui me hantent, et je dois avouer qu’elles m’inquiètent autant pour le monde auquel j’appartiens d’esprit et de coeur que pour l’Église qui se veut, à tout le moins depuis Vatican II, à son service.
Car il y a eu des théologiens dans le monde d’aussi loin qu’on trouve des traces d’une écriture humaine. Pour m’en tenir à la sphère linguistique occidentale, des “mythologues”, appelés aussi “théologiens”, ont existé dans la Grèce archaïque, auxquels Platon et Aristote ont attribué la naissance de la philosophie, parce qu’ils avaient initié le travail de rationalisation, d’abord sur l’idée de Dieu, que les philosophes devaient poursuivre. La théologie chrétienne, bien plus tard, n’a pas manqué d’imprégner la culture européenne, directement ou à travers la pensée grecque qu’elle lui transmettait, bien ou mal, et d’y entretenir le sens de la transcendance, de l’absolu, de l’infini. Notre culture gardera-t-elle ce sens, sur lequel elle a bâti ses “valeurs” humanistes, si elle ne se tient plus en dialogue, même conflictuel, avec la théologie ?
Voilà pourquoi je vois la théologie, demain, plus occupée du cours du monde que de la prospérité de l’Église, non en s’immergeant dans les affaires séculières comme elle l’a trop fait aux époques de “chrétienté”, mais en essayant de porter remède aux égoïsmes qui engendrent tant de maux et de souffrances, en dénonçant les discriminations qui divisent la société, en éteignant les haines qui menacent les peuples, en se mêlant aux débats éthiques que provoquent les avancées des sciences, bref en s’intéressant aux grandes questions culturelles de notre époque plus qu’aux débats dogmatiques du passé et en s’efforçant de répandre l’esprit et la lumière de l’Évangile dans tous les domaines de l’existence et sur tous ces problèmes plus que d’accroître la domination de l’Église et le nombre de ses fidèles.
Ce disant, je situe le travail du théologien de demain davantage dans le monde qu’au-dedans de l’Église, du moins à la jointure de l’une et de l’autre, tourné vers le dehors plus qu’immergé dans des fonctions ecclésiastiques, donnant la préférence à l’évangélique sur le religieux. Je pense donc que le théologien recevra sa vocation du dehors, des appels du monde sécularisé, qui monteront de ce monde vers lui sans lui être personnellement adressés, des appels qui lui parviendront à la condition qu’il les écoute attentivement, qu’il ne s’en détourne pas sous prétexte qu’ils ne viennent pas de la foi, qu’il sache les interpréter alors qu’ils s’expriment en termes sécularisés, et qu’il comprenne que le Royaume de Dieu vient par là, qu’il est à chercher au grand large, à accueillir au coeur du monde, et non dans les seuls refuges du sacré.
Mais cette vision du futur, ce choix de l’extériorité, implique le sentiment que l’état de l’Église va continuer à se détériorer, et le monde à s’éloigner d’elle. Ne serait-ce pas une raison, au contraire, pour que ses théologiens,– des prêtres qui sont d’abord ses ministres, ses serviteurs ? –, lui réservent leurs soins et leurs forces, et, d’ailleurs, d’où viendront-ils si elle s’appauvrit à ce point de ses forces vives ? Des évêques ont fait de la situation présente de l’Église une analyse très différente, imputant ses malheurs au fait que trop de pasteurs et de fidèles, déjà au temps de l’Action Catholique d’avant Vatican II, avaient développé la théorie et la pratique de “l’enfouissement” de la parole évangélique dans le monde, ce qui les avait conduits en réalité à se laisser absorber par lui : va-t-on répéter cette funeste expérience ? Examinons si ces interrogations peuvent être éclairées par la réponse aux autres questions qui m’ont été posées.Les questions du Magistère
“Je t’ai entendu dire que le prêtre n’était pas d’abord l’homme des sacrements mais celui de la parole. Ta théologie du prêtre a-t-elle changé ?”
Nullement, et ce sentiment très ancien explique la position que je viens de prendre sur le rôle futur du théologien. Elle est basée sur l’événement fondateur de l’Église, le fait que le Christ l’a “instituée” en envoyant ses apôtres annoncer son Évangile à travers le monde. L’annonce relève de la parole, et il s’agit d’une parole à adresser au dehors, au monde pris collectivement, à des personnes non croyantes ; c’est pourquoi, dans une situation où le monde a massivement déserté les églises, j’ai pensé que le rôle du théologien, qui est spécifiquement affecté à des tâches de parole (ou d’écriture), est de se tenir de préférence sur le seuil de l’Église sinon en plein monde pour lui faire entendre l’Évangile, sous peine que la mission essentielle de l’Église ne soit plus remplie. Je sais bien que cette annonce est d’habitude comprise en tant que prédication, enseignement et exhortation à la conversion. Mais quand ces modes ne sont plus praticables comme tels, parce qu’une parole empreinte de prosélytisme ne serait pas écoutée dans un monde qui a massivement cessé d’être religieux, il ne reste plus qu’à user des autres moyens de communication des hommes de notre temps, – et c’est une obligation à laquelle l’Église ne pourra pas se dérober.
Je visais jusqu’ici le cas du théologien qui est prêtre, cas normatif en régime de catholicisme. Mais je ne modifie pas mon avis en ce qui concerne le prêtre non affecté au “métier” de théologien, car il n’en est pas moins ministre de la parole de Dieu. À vrai dire, l’idée que le prêtre, en tant que tel, est l’homme de la parole avant d’être celui des sacrements m’était venue très tôt, en étudiant la théologie du sacerdoce (qu’on n’appelait pas encore “presbytérat”), et en ne trouvant pas d’autre preuve de son institution par le Christ que l’envoi des apôtres en mission, seul lieu scripturaire (je ne pense pas être démenti sur ce point par l’exégèse savante, n’en déplaise au concile de Trente !) qui permette de lui rattacher l’apparition tardive, dans la lignée de la “succession apostolique”, du sacerdoce de l’évêque (et du “presbytre” plus tard).
Cette idée ne traduit donc aucune mésestime des fonctions rituelles et cultuelles. La pratique et la théorie sacramentaires des anciens temps faisaient d’ailleurs une large part à l’usage de la parole, heureusement redécouverte depuis Vatican II. En conséquence, dire que le prêtre est l’homme de la parole avant d’être celui du sacrement, c’est faire entendre, en plus de la référence à l’origine que je viens de signaler, que le sacrement n’est pas seulement constitué d’un rite sensible (choses, paroles et gestes), mais avant tout d’une relation de parole qui s’origine en amont et se déploie en aval du rite en mêlant la parole évangélique à l’entretien du célébrant avec le sujet du sacrement et ses participants et, à travers eux, à la voix du monde en attente de Dieu. La place faite à la parole dans le sacrement et son débordement hors du rituel dans la vie quotidienne de tous les gens, voilà ce qui fait l’originalité de la religion chrétienne entre toutes les autres, ce qui l’accordait d’avance à la rationalité et à l’humanisme de la modernité occidentale.
Je fis à Sainte-Bathilde, bien que je n’y fûs pas appelé pour les besoins du culte, l’expérience heureuse de célébrations sacramentelles dont le sens pour la foi et pour l’expérience humaine s’exprimait d’autant mieux qu’elles faisaient une large part à la parole et facilitaient la circulation de l’Évangile, lu et expliqué par le célébrant, dans la communication croyante et fraternelle qui s’établissait entre les participants, à quelque degré qu’ils fussent impliqués dans la cérémonie.Une expérience innovante et insolite
J’y fis une autre expérience, innovante et insolite, rafraîchissante, celle d’une jeune femme, dûment mandatée par son évêque pour cela, d’ailleurs théologienne diplômée, qui, en alternance avec le prêtre, lisait les textes des messes dominicales et prononçait l’homélie. Que quelqu’un, homme ou femme, soit habilité, sans être prêtre, à prendre la parole dans l’assemblée chrétienne, cela n’infirme pas la thèse que je viens de soutenir, à savoir que le prêtre est essentiellement l’homme de la parole, cela prouve seulement, mais c’est capital, qu’il n’en a pas le monopole.
On aurait pu le savoir depuis longtemps, étant donné que les communautés des temps apostoliques, qui avaient des présidents mais pas de prêtres, abondaient en ministres de la parole, par exemple d’une parole inspirée par l’Esprit (on les appelait “prophètes”) ou mandatée par la communauté (on les appelait “docteurs”). La parole fut retirée aux laïcs quand fut instituée la distinction des clercs ordonnés et des laïcs ; longtemps ils ne parurent pas en souffrir, car la plupart étaient illettrés, ce qui permettait de les traiter en personnes “mineures” ; il n’en va plus de même aujourd’hui où presque tous les fidèles sont instruits en quelque domaine et à quelque degré, voire à très haut degré, où beaucoup aspirent à être traités en chrétiens “majeurs”, responsables de leur foi et de leur vivre en Église, où plusieurs sont familiers des Écritures et très capables de discuter de sujets de foi, où quelques-uns et quelques-unes ont même fait des études théologiques certifiées par des grades “canoniques” : rien n’empêcherait donc que l’exercice de la parole au sein de la communauté soit rendu aux laïcs, sans que le ministère du prêtre en soit diminué ni dévalorisé, et rien ne serait plus profitable à la vie de l’Église, car la foi est d’autant plus vivante et dynamique qu’elle est “confessée” par le partage et la communication de la parole.
Admettons cependant que la reconnaissance aux fidèles du droit à une parole responsable modifierait profondément l’exercice du ministère presbytéral et le paysage de l’Église. En vertu du principe, posé plus haut, que le prêtre est avant tout l’homme de la parole, un partage de celle-ci entraînerait un partage, non une amputation, mais une répartition de ses préogatives et responsabilités entre plusieurs autres personnes, et ce qui était considéré naguère comme sa propriété exclusive pourrait être délégué ou exercé de façon collégiale ? : ainsi pour l’organisation de la catéchèse des enfants. On pouvait aussi confier à des laïcs certaines fonctions liturgiques, par exemple la proclamation de la parole de Dieu à la messe, ou la distribution de la communion. Dans le cas de ministères sacramentels complexes ou accordant la plus large part à la relation de parole, par exemple quand il s’agit de la préparation d’un adulte au baptême ou d’un malade à la réconciliation avec Dieu, il était envisageable de conférer au laïc chargé de cette préparation une participation, sous une forme appropriée, à l’acte sacramentel qui en est la conclusion.
Oui, bien des choses étaient envisageables dès lors que le droit à la parole dans l’Église serait reconnu aux laïcs. L’une ou l’autre de celles que je viens d’évoquer a pu se pratiquer, à l’époque où j’évoluais à Sainte-Bathilde, là-même et en d’autres lieux, mais cela provoquait des remous, et de hauts-responsables s’en inquiétaient : l’image du prêtre était brouillée aux yeux du public, le prêtre perdait la conscience de son identité, puisque des laïcs se mettaient à faire ce qui était censé relever du seul pouvoir sacerdotal,– où tout cela conduirait-il ? On voyait se profiler, au terme, la prise du pouvoir par les laïcs, la revendication de l’ordination par des hommes mariés, et même par des femmes, quelle horreur ! La hiérarchie de l’Église ne tarda pas à y mettre bon “ordre” : on revenait de loin.L'expérience paroissiale d'un théologien
Je m’aperçois que mes réflexions empiètent sur la question suivante, relative à mon expérience paroissiale. Je m’attarderai cependant un peu à ce sujet dans le but de le relier à mon point de départ : quel rapport entre le partage de parole qui se fait à l’intérieur de la communauté chrétienne et la mission dans le monde ? Ce rapport tient au changement que ce partage opère dans l’atmosphère de la vie en Église et dans son visage public. Les fidèles qui venaient à la messe se saluaient et se parlaient, pareillement en sortant ; souvent l’entretien commencé au-dehors se poursuivait quelque temps au-dedans, et ce qu’on avait entendu ou dit à l’intérieur se prolongeait à l’extérieur ; il n’y avait pas de coupure entre la vie qu’on avait menée et qu’on allait reprendre et ce qui se passait et se disait dans le lieu et le temps de la célébration, où la “prière universelle”, d’ordinaire composée par des laïcs, mêlait à l’action eucharistique les soucis des uns et des autres, les intentions de la communauté, la vie de la cité, les grandes affaires du monde. Le rendez-vous dominical était un temps heureux de ressourcement individuel et de fraternité, temps d’humanisation où chacun partageait la vie des autres. L’Église offrait au monde un visage humain, et la rumeur d’Évangile qui prenait naissance en elle allait se répandant dans le monde environnant. Ainsi lit-on dans les Actes des Apôtres que la parole de Dieu, l’Évangile de Jésus, indépendamment même des discours et des missions des apôtres, croissait et se répandait tout à l’entour des communautés et de ville en ville, comme se propage une bonne nouvelle : le royaume de Dieu s’approchait sous le visage d’une humanité réconciliée.
Et maintenant, abordons le problème de la paroisse en tant que tel.
“Bien avant de venir à Sainte-Bathilde, tu pensais que l’avenir de l’Église n’était pas dans les paroisses. Pourquoi y as-tu mis les pieds ?”
Mais je n’ai pas changé d’avis, ni quand j’y suis venu ni après, et j’en dirai les raisons, qui ne sont pas de parti-pris. Auparavant je dirai pourquoi j’ai mis les pieds en paroisse et quelles leçons et quel profit j’en ai tirés.
Pourquoi ? Indépendamment de la forte et amicale pression de Michel et de Christine, sous l’impulsion de Vatican II et sans doute aussi de l’air du temps, pour la même raison que l’ont fait, au même moment, de nombreux collègues théologiens qui ont éprouvé le besoin, comme je l’ai dit, de changer de place et de posture. Les théologiens, pour la plupart, menaient alors une vie recluse, vouée principalement à l’étude, entre enseignants et séminaristes, et c’était surtout vrai pour les religieux qui n’avaient pas d’attaches diocésaines. Il y avait encore, mais pas pour longtemps, assez de prêtres pour que les théologiens ne soient pas surchargés de tâches pastorales, comme c’est le cas depuis de nombreuses années, et les religieux n’étaient guère appelés en paroisse que pour des besoins spécifiques (prédications, retraites, confessions), des temps brefs et sans revenir au même lieu de façon habituelle. Si donc je voulais me rendre compte de ce qui se passait dans l’Église, de l’attitude des fidèles, des pratiques pastorales, des mutations en cours, de l’évolution des mentalités religieuses, il n’y avait pas de meilleur observatoire qu’un séjour habituel et de longue durée en paroisse. À plus forte raison, si je voulais quitter ma chaire doctorale, de temps à autre, pour regarder, écouter, sentir le nouveau cours des choses, des opinions, des sentiments et comportements, dans les milieux chrétiens et dans la société civile, pour me changer moi-même, mes idées, ma manière de penser et d’enseigner, peut-être même de croire, mon regard sur l’Église et sur le monde, bref, pour me situer autrement, j’avais besoin de changer de lieu et d’entourage. Voilà pourquoi j’ai acquiescé à la demande de Michel Jondot et de Christine Fontaine, à l’appel de Sainte-Bathilde, d’un lieu qui promettait d’être lieu d’expérimentations.
Je n’ai pas l’intention de m’étendre sur ce que j’y ai fait. En toute sincérité, ma mémoire infidèle ne me rappelle rien de saillant en ce qui concerne mes activités, et je n’ai pas souvenir d’y avoir fait grand’chose, hormis être là, mais y être intensément, tout à l’écoute de ce qui se disait et se faisait, surtout de ce qui s’y cherchait, non en observateur inerte, mais en partenaire de ce qui se disait, se faisait et se cherchait. Je n’étais pas requis pour le culte, mais j’ai assisté, plus ou moins activement, à maintes célébrations, belles et stimulantes, et j’y ai prêché à l’occasion. Ni requis à des fins d’enseignement, mais je donnais chaque année des conférences, suivies de débats, parfois une série de plusieurs interventions sur un même sujet, généralement à la jonction de la théologie et de la pastorale. J’ai assisté à maintes réunions de petits ou de grands groupes adonnés à des activités spécifiques, sur la paroisse ou sur la ville, et j’y prenais la parole, mais pas plus que d’autres et plutôt moins puisque je ne participais pas à ces activités sur le terrain. Ma principale mission était de coopérer au “groupe de concertation” qui rassemblait chaque mois une quinzaine de personnes, moitié hommes moitié femmes, pour autant que je m’en souvienne ; sa fonction consistait à réfléchir aux orientations à donner aux divers organismes qui fonctionnaient sur la paroisse et aux activités à programmer pour l’ensemble de la vie paroissiale, puis à suivre la mise en oeuvre des décisions prises, finalement à évaluer les résultats. C’était donc là où se préparaient les évolutions et les expérimentations qu’on voulait faire, et le fonctionnement de ce groupe était à lui seul l’innovation majeure de Sainte-Bathilde, puisqu’il associait des laïcs et des femmes à la gestion de la paroisse et au pouvoir décisionnaire de son curé. Mon rôle propre était celui d’un “expert” en théologie, il ne me donnait aucun privilège de conseiller ni de décideur, il m’intégrait simplement à la paroisse en tant que solidaire de ceux qui travaillaient à son service. C’était donc une place idéale pour observer et apprécier les évolutions des mentalités des fidèles sous la mouvance du récent Concile et les mutations en cours dans le positionnement d’une communauté chrétienne vis-à-vis de la hiérarchie catholique et de la société civile.
Je ne chercherai pas – je n’y parviendrai d’ailleurs pas – à décrire le travail qui se fit sur la paroisse durant la douzaine d’années – la durée de la charge curiale de Michel – où je la fréquentais régulièrement. Je dirai seulement les leçons majeures que j’en ai tirées quant à la vie de l’Église en France.
La première, c’est que les chrétiens du XXe siècle, du moins la plupart d’entre eux, avaient la même mentalité de fond que leurs contemporains non croyants, celle qu’on accolle couramment au terme de “modernité” : il se considéraient comme des personnes majeures, ils osaient penser par eux-mêmes, y compris leur foi, ils se voulaient responsables de leur vie, y compris de leur vie chrétienne, et de leur vie en Église, ils entendaient être traités en tant que tels, et non plus comme des brebis conduites par leurs pasteurs selon l’imagerie tant aimée de nos évêques.
Une modification dans l'exercice du pouvoir
Il s’ensuivait que le rapport clercs-laïcs ne pouvait plus être ce qu’il était depuis tant de siècles, c’est-à-dire essentiellement inégalitaire. Ce changement d’état d’esprit ne mettait pas directement en cause la constitution hiérarchique que l’Église croit tenir de droit divin, mais tendait à modifier en profondeur son exercice, sous peine que les fidèles d’aujourd’hui ne fassent ce qu’avaient fait tant de chrétiens depuis le temps des Lumières, et de plus belle dans les temps présents : qu’ils quittent l’Église. Les évêques devaient en prendre acte.
La volonté des chrétiens de prendre en charge leur vie chrétienne et ecclésiale impliquait le droit à prendre la parole dans l’Église, et une parole responsable, c’est-à-dire habilitée à discuter et à décider de leur manière de confesser leur foi et de vivre et agir en Église, non à eux seuls, mais en accord fraternel avec l’autorité épiscopale. Ce n’était là ni prise de pouvoir ni insurrection, mais demande de reconnaissance de la liberté du peuple chrétien, si bien attestée par le Nouveau Testament, et revendication d’une dose minimale de démocratie, sans laquelle le témoignage de la foi manquait totalement de crédibilité dans le monde moderne. L’avenir de l’Église et de sa place dans le monde était en jeu dans cette prise de conscience des fidèles laïcs.
Ces fidèles n’entendaient pas confiner leur foi dans la vie spirituelle et ecclésiale, ni se constituer en communautés fermées, ils se voulaient pleinement citoyens de la société civile et du monde, ils considéraient de leur devoir de chrétiens de s’occuper des tâches de la cité séculière, de prendre en charge l’environnement social, de prendre des décisions politiques, de prendre parti dans les débats de société sur des questions éthiques, et ils entendaient le faire sous leur propre responsabilité et non sous l’injonction, le mandat et le contrôle de l’autorité ecclésiastique. Mais cela brouillait les frontières du spirituel et du temporel, les évêques sentaient les fidèles échapper à leur tutelle dans le domaine séculier et diminuer d’autant leur pouvoir d’intervention dans les affaires de l’État et de la société.
La nouvelle ecclésialité qui s’élaborait à Sainte-Bathilde ne passait pas inaperçue, on s’en doute, et causait des remous, on s’en doute également. Des chrétiens de la paroisse n’étaient pas d’accord avec ces innovations et la quittaient pour chercher refuge ailleurs, plus ou moins bruyamment ; inversement, des fidèles d’autres lieux accouraient chez nous, ce qui tendait les rapports entre paroisses voisines. L’évêque, bien sûr, était au courant ; il avait lui-même, dès le début, autorisé sinon encouragé plusieurs choses, il en tolérait d’autres avec une bienveillance qui ne se démentit pas. Mais il mourut. Son successeur ne partageait pas ses vues : quand la charge de curé de Michel vint à terme, ce qui entraînait son départ, il ne voulut pas reconduire le “groupe de concertation” dans ses fonctions ni prolonger certaines expérimentations que nous avions faites, notamment dans le domaine catéchétique et liturgique. Il nous en donna deux raisons : d’une part, le petit nombre de prêtres et leur nécessaire déplacement d’un lieu dans un autre ne permettaient plus de laisser s’instaurer des pratiques pastorales trop différentes ici et là ; d’autre part, le prêtre n’avait pas d’autre pouvoir que celui du Christ et ne pouvait donc pas en disposer à son gré ni le partager avec des laïcs, le pouvoir décisionnaire devait lui être réservé.
Ce fut la fin de l’expérience de Sainte-Bathilde et la fin de mon unique insertion de longue durée en paroisse.L'avenir des paroisses
Je peux dire maintenant pourquoi je pensais, avant d’y aller, que “l’avenir de l’Église n’était pas dans les paroisses”, et pourquoi j’ai persisté dans cette opinion après mon séjour à Sainte-Bathilde et diverses autres expériences paroissiales beaucoup plus épisodiques et de bien moindre engagement personnel. J’avais, au départ, deux motifs, qui ont trait à l’histoire, à la sociologie et à l’anthropologie, et ils n’ont fait, depuis, que se renforcer l’un et l’autre.
Le premier motif est le phénomène bien connu du “retrait de la religion”, qui remonte au XVIIIe siècle, puis s’est accéléré et étendu, et qui s’observe de notre temps de bien des façons : baisse des pratiques religieuses, de la fréquentation habituelle des églises, des vocations sacerdotales et religieuses, mise en doute de la foi, rejet de nombreux points du dogme, contestation du pouvoir spirituel, etc. Les chefs de l’Église n’ont voulu y voir qu’oeuvre de l’Esprit du mal, assaut des ennemis de la foi, infiltration d’une philosophie athée, complot d’appareils d’État rebelles à l’autorité divine, etc., et n’ont pas su comprendre que tant de chrétiens perdaient la foi ou quittaient l’Église parce que n’y étaient pas reconnues les nouvelles revendications de la conscience en ce qu’elles avaient de légitime, ni la liberté de penser, de parler et d’agir dans le domaine de la foi et des moeurs, ni même dans celui des sciences et du temporel, autrement que les pontifes ne l’avaient décidé, ni le droit d’interpeller l’autorité qu’ils exerçaient sur eux et moins encore d’y participer, en sorte que la dignité de la personne humaine n’était pas honorée au regard de la foi comme elle l’était dans la société civile et politique. L’expérience de Sainte-Bathilde m’a confirmé que tel était bien le sentiment de nombreux fidèles de nos paroisses et que la hiérarchie catholique n’était pas prête à changer d’attitude, par peur de perdre quoi que ce soit du “dépôt” de la tradition et du pouvoir qu’elle lui conférait, en sorte que l’hémorragie de l’Église allait continuer comme par le passé.
Le second motif tient au lien de la religion à la société rurale. Le fait a été souvent analysé que la “déchristianisation” des pays d’Europe était due pour une bonne part à l’exode des campagnes vers les villes suite à l’industrialisation : l’arrachement à la terre, aux coutumes des métiers ruraux, à la vie du village et la rupture des liens de parenté et des traditions familiales et villageoises entraînaient la perte des traditions religieuses qui y étaient immergées depuis des temps immémoriaux. S’ensuivaient une dévitalisation des communautés chrétiennes rurales et une perte du recrutement de futurs prêtres. Rien ne permet de penser que ce mouvement va s’arrêter, quelque bruit qu’on fasse autour des phénomènes de reviviscence du religieux. L’anthropologie montre que la religion est née à l’époque du passage de l’humanité de l’âge de la cueillette à celui de la culture, pour se concilier les esprits de la terre et les dieux de la fertilité ; et la sociologie nous avertit que la population du globe est en voie, sous l’effet de la mondialisation et de la technologie, de s’amasser dans les métropoles et de perdre bientôt le contact avec la nature et jusqu’à la mémoire de ce que l’homme a reçu de la terre. Pour se préparer à cet avenir menaçant, il faudrait desserrer le lien de la foi à la tradition et au culte pour le restructurer dans la communication des chrétiens entre eux et le refonder dans la mémoire du Christ. L’Église s’en inquiète-t-elle ? Elle s’est efforcée de faire face à sa perte de substance et de moyens par une “restructuration des paroisses”, dans le but d’assurer une relative permanence et mobilité du culte dominical, mais au détriment de la vitalité et du rayonnement des anciennes communautés locales ; elle s’efforce vaillamment d’année en année de reprendre des forces et de la visibilité par le resserrement de la “communion verticale”, hiérarchique, la rénovation des dévotions populaires et la restauration de ses traditions liturgiques. Rien en tout cela n’indique qu’elle ait vu d’où vient le mal, qu’elle s’obstine à considérer du seul point de vue de la “déchristianisation” ; elle s’active à faire du neuf avec du vieux, elle ne voit de salut que dans le retour du passé qui la fuit.
Dans cette situation, où les paroisses s’agrandissent en s’amenuisant, où est l’avenir de l’Église ? De toutes façons, dans un petit nombre de fidèles. Alors, pourquoi pas dans la création et la créativité de “petits groupes” ?
Où est l'avenir de l'Eglise?
“Depuis de très nombreuses années, ta réflexion théologique t’a conduit à penser que les petites communautés de croyants sont l’avenir de l’Église. Sur quoi t’appuies-tu pour dire cela ?”
Me voici donc enfin parvenu à la première question qui m’était posée. Je pourrai répondre que j’avais besoin de tout le cheminement qui précède pour en arriver à cette conclusion. Mais Christine me rappelle que je pensais cela depuis très longtemps, et elle m’objecte méchamment (!) ce jugement d’un théologien très orthodoxe, Louis Bouyer, qui écrivait en 1977, dans un livre intitulé « Le métier de théologien » : « Une des premières hérésies concernant l’Église est celle qui la voit naître de petits groupes qui se reconnaissent pour des raisons purement humaines, parce qu’ils ont en commun certaines idées (...) et qui excluent ceux qui ne (les) partagent pas (...) Or il y a des “théologiens” pour systématiser pareille conception de l’Église... » Bien que je ne me souvienne pas avoir écrit à l’époque sur le sujet, il n’est pas impossible que je fusse visé par cette phrase, car je fréquentais alors, épisodiquement, en plus de Sainte-Bathilde (qui n’était pas mieux famée !), de “petits groupes” qu’on appelait “communautés de base”. Je n’approuvais pas tout ce que j’y entendais, je m’y sentais néanmoins très à l’aise, et je témoigne tout de suite que les chrétiens (jeunes, pour la plupart) que j’y rencontrais n’étaient pas mus par “des raisons purement humaines” mais par une authentique recherche de foi, un vrai désir d’ouvrir à l’Église des chemins nouveaux, et qu’ils n’“excluaient” personne, sauf qu’ils ne trouvaient plus leur place dans des paroisses restées traditionnelles, qui n’auraient pas supporté leurs incartades, alors que l’esprit du temps remettait tant de choses en question. Ils ne cherchaient pas à faire Église à part, mais “autrement” ; je leur disais bien qu’ils la changeraient plus sûrement du dedans que du dehors, ils n’en étaient pas persuadés, moi non plus d’ailleurs.
Aujourd’hui l’urgence est d’aider l’Église à aborder des temps radicalement nouveaux, ce qu’elle ne fera pas sans accepter pour elle-même des changements radicaux, sous peine de perdre encore davantage de fidèles et de renoncer à annoncer l’Évangile à ce monde nouveau. Nous savons que de toute façon, si unie qu’elle se veuille dans l’unité de la foi et de la charité, elle sera considérablement diminuée et dispersée : c’est sous cet angle qu’elle doit envisager son avenir, comme un retour , non au passé, mais à l’origine, seule capable de lui redonner vie, “autrement”, mais dans la petitesse et l’audace qu’elle reçut en dot.
De fait, cette intuition s’est présentée assez tôt à moi, – en réfléchissant aux évolutions de l’Église depuis le temps des Apôtres, en étudiant le mouvement des idées, de la culture, de l’histoire et de la société depuis le XVIIe siècle, en observant ce qui se passait dans le monde depuis la seconde guerre mondiale, en me laissant questionner par la volonté de Vatican II de se réconcilier avec le monde qui s’était séparé d’elle, en conversant avec des amis, tels que Michel de Certeau et d’autres, sur l’actualité et le destin du christianisme, influencé aussi par de rares contacts avec Marcel Légaut, – je me persuadais que l’Église allait sur son déclin, s’il ne s’agissait que de sa puissance dans le monde et sur lui, et qu’elle ne sauverait sa raison d’être, qu’en se refondant sur l’Évangile qui l’a portée et qu’elle doit porter au monde.
L’Église est née, autour de Jésus, de petits groupes de disciples qui écoutaient et méditaient ses enseignements ; il n’y était pas question de loi ni de temple ni de dogme ni de nouvelle religion, mais d’Évangile : les Béatitudes du Royaume, le service des pauvres et des malades, l’amour du prochain et des ennemis, l’humilité, mais cela impliquait une lucide et courageuse rupture avec les “traditions des anciens”. Plus tard, au temps des apôtres, elle se forme autour de “la table du Seigneur”, sans structures hiérarchiques ni cléricales, sans autre dogme que le souvenir de sa mort et l’attente de sa venue, sans autre loi que la réconciliation entre juifs et païens d’origine et l’égalité entre riches et pauvres, hommes et femmes, mais elle ne pouvait s’ouvrir au monde sans rompre ses attaches à la religion qui lui avait servi de matrice.
L'Eglise dans la mondialisation qui l'enserre
Aujourd’hui encore, l’Église ne fraiera pas sa voie dans la mondialisation qui l’enserre en traînant son passé derrière elle, elle devra faire des choix et des renoncements. Elle s’était habituée à interpréter ses Écritures fondatrices sur la base de ses institutions et de ses traditions, elle devra apprendre à faire l’inverse.
Elle va se trouver sous peu, si ce n’est déjà le cas, réduite ici à des poignées de fidèles, divisée ailleurs entre partis rivaux : la voici ramenée à sa situation native. L’origine ne fournit pas de modèle, mais elle est inspirante. Elle suggère de regrouper entre eux les fidèles dont la préoccupation majeure est d’aller au monde lui annoncer l’Évangile et de les mettre à son école, en leur laissant la liberté de choisir leur route, pourvu qu’ils gardent le lien historique à Jésus, celui de la tradition apostolique. La vérité vous rendra libres, a-t-il dit : elle se reconnaît à cela qu’elle libère les énergies innovantes de la charité, qui est faite de compréhension et de bonne entente, de discernement du passé et d’interprétation du présent, d’intelligence de qui s’est révélé de Dieu dans la mort de Jésus et du mystère de l’homme dans la faiblesse et la folie de la Croix, et la charité est source de vie.
Ainsi l’Église renaîtra de ces petits groupes, où elle craignait de trouver sa mort, si elle se résigne à l’affronter. Qui entendra les appels du monde à travers les fidèles qui lui parlent d’Évangile, y trouvera sa vocation de théologien et le groupe tout entier deviendra communauté théologisante pour le salut du monde. Telle fut l’expérience de Sainte-Bathilde. Merci à Michel, merci à Christine, merci aux amies et amis de Sainte-Bathilde pour tout ce que j’ai reçu de leur appel à les rejoindre.
Joseph Moingt
Dessins de Pierre Meneval

