

Octogénaire dans l’Église romaine
Michel Poirier
Au nom de Dieu maintenant, Christine Fontaine m’a demandé : « Pourrais-tu écrire un article sur l'évolution de l'Église depuis tes "origines", en tant que chrétien de gauche en particulier, et ce que tu penses de la situation actuelle ? »
Je comprends qu’il s’agit de tenter de retracer l’histoire de la manière dont j’ai vécu, et pensé, et dont peut-être je juge, ce long compagnonnage toujours en cours avec et dans la communion et l’institution que constitue l’Église catholique romaine.
Préambule
Me définirai-je comme « chrétien de gauche » ? Certes, sauf une seule année, j’ai constamment voté de ce côté-là. J’ai jadis milité au PSU, et quelques années au PS encore conquérant. Mais la politique et les organisations politiques ne me sont qu’un instrument à mettre, lorsqu’on le juge efficace, au service d’un engagement vital d’autre nature, que la politique ne saurait constituer elle-même.
Je me verrais plutôt comme un chrétien hors chrétienté, refusant ou incapable, je ne sais, de vivre en milieu protégé, entre chrétiens. Élève puis étudiant, je ne l’ai été que dans l’enseignement public et laïque, et le passage vers 16 ans d’un christianisme d’héritage et d’habitude à une foi assumée, je le dois à diverses rencontres dans cet environnement prétendument sans Dieu (c’était encore l’époque où des évêques faisaient aux parents catholiques une obligation de mettre leurs enfants dans l’école « libre ») et aux perspectives que m’ouvrait un mouvement de l’Action catholique spécialisée, la Jeunesse Étudiante Chrétienne, prônant la participation au milieu de vie comme « levain dans la pâte ». Puis, devenant professeur, il aurait été inconcevable pour moi d’aller faire ce métier ailleurs que dans l’enseignement de tous et pour tous.
Ajoutons diverses expériences et rencontres, que je ne vais pas détailler, qui m’ont alors fait connaître que tout le monde n’avait pas les facilités de vie dont je bénéficiais dans ma famille, plus l’évidence que la colonisation était la domination d’une nation sur d’autres (1), et voilà l’origine de cette position à gauche que Christine met en avant.
Sur un plan très personnel, je tiens pour fondateur que ce soit un camarade de lycée (ami fidèle jusqu’à sa mort) de famille ouvrière et personnellement communiste qui m’ait signalé au début de 1945, me sachant engagé comme chrétien, l’existence de la revue Esprit du chrétien Emmanuel Mounier, à qui par la suite mes orientations personnelles devront des choses essentielles.
Chrétien hors chrétienté ne veut pas dire hors Église. Car vivre la foi dans un compagnonnage humain sans préférences et en fonction de lui implique qu’on trouve en Église des lieux où l’on se ressource et on se forme, pour mieux repartir.Au sortir de la guerre, les deux orientations des institutions catholiques
Je crois que je sentais les choses ainsi : il y avait ce sur quoi vivait l’Église depuis longtemps, et qui encadrait les troupes catholiques en leur donnant un milieu de vie : les paroisses, les dévotions, l’école catholique, le scoutisme catholique, les patronages, la soutane des prêtres et la pourpre des cardinaux, la « démocratie chrétienne » (un peu, bien moins qu’en Italie), le syndicalisme chrétien, la méfiance envers les autres, la défense des positions héritées contre les empiètements de la sécularisation en marche – et il y avait l’Action catholique des milieux, avec ses mouvements de jeunes (JOC d’abord, puis JEC, JAC, etc.) puis d’adultes, comme en milieu ouvrier le Mouvement populaire des Familles ; il y avait en même temps, du côté des prêtres, les prêtres ouvriers de la Mission de Paris, soutenus par le cardinal Suhard, que la lecture du livre « France pays de mission ? » avait converti, et l’essor du séminaire de la Mission de France. Dans cette deuxième orientation, on ne cherchait pas à préserver de l’acquis, on avait pris conscience, par exemple, que notre Église avait « perdu la classe ouvrière » à partir du 19e siècle, et on repartait en avant sur nouveaux frais. Certes, rétrospectivement, on peut se rendre compte qu’on n’avait pas encore renoncé à toute appréciation comptable des succès espérés (nous chantions : « Nous referons chrétiens nos frères, par Jésus Christ nous le jurons »). Mais le souci et le goût d’inventer, de prendre à bras le corps le monde moderne et de prendre en compte ses requêtes, étaient bien là. Cet effort s’exerçait sur le terrain de la vie des gens et de la société, mais aussi sur le terrain intellectuel et théologique, avec les de Lubac, Congar, Chenu, etc., et plus humblement mais avec une efficience certaine nos aumôniers, qui nous stimulaient pour que nous osions penser.
La caractéristique de cette période de la vie de l’Église en France, c’est que la hiérarchie ne voyait pas de contradiction entre ces deux orientations, et les soutenait toutes deux. Elle consacrait beaucoup d’énergie à la défense de l’école libre, et en même temps donnait un mandat officiel aux organisations d’Action catholique pour représenter l’Église dans chaque milieu. Nos évêques, pour la plupart, voyaient probablement dans cette seconde orientation un instrument de reconquête susceptible au terme et après succès de renforcer ce que la première tentait de maintenir. Quelques-uns seulement parmi eux voyaient et acceptaient le bouleversement de l’Église que cela préparait.
Les années de glaciation
En 1953, Rome restreint les possibilités de travail des prêtres ouvriers, imposant en principe le mi-temps. En 1954, l’expérience est arrêtée. Le même printemps, les grands théologiens jésuites et dominicains français sont interdits d’enseignement, exilés loin de leurs disciples. Le provincial de Paris des dominicains est démis de la fonction à laquelle ses frères l’ont élu. J’ai vécu cette époque en intimité avec deux dominicains que leur couvent corse de Corbara avait délégués à Bastia (où j’étais jeune professeur de lycée) pour s’occuper du petit milieu intellectuel de la ville, peu atteint par le clergé local. Leur ordre les tenait au courant presque au jour le jour des développements de ce matraquage. Ce fut moralement très éprouvant, jusqu’aux pleurs.
D’où venait ce retournement ?
L’immersion de la plupart des prêtres ouvriers était totale – et ce mot d’immersion est lui-même maladroit, il dénonce qu’on est venu d’ailleurs, or cette immersion s’était transformée en participation plénière, ils vivaient comme les autres ouvriers, avec les mêmes problèmes quotidiens et dans les mêmes combats solidaires pour les salaires et la dignité, y compris l’engagement syndical, certains ne voulurent pas se dérober aux responsabilités que leurs camarades leur demandèrent de prendre, ils y côtoyaient les communistes. N’allaient-ils pas devenir marxistes, compromettre l’Église sur des chemins dangereux ? Cela suscita des oppositions. On prit peur. À Rome, on voulut mettre le holà.
À mesure que s’approfondissait le travail des théologiens novateurs, il apparaissait qu’il mettait en débat bien des habitudes, des modes de gouvernance, des traditions théologiques. Jusqu’où ne risquaient pas d’aller la promotion du laïcat ? la remise en question d’un thomisme officiel devenu plus scolastique que fidèle aux audaces de saint Thomas ? la recherche d’un dialogue avec les autres chrétiens sur la base des premiers Pères, au risque de négliger les acquis « définitifs » du concile de Trente et les définitions et déclarations pontificales plus récentes ? On voulut mettre le holà.
Les laïcs des mouvements d’Action catholique prenaient à bras le corps, au nom même de leur engagement en service de leurs frères, tous les problèmes de leur milieu. Tout naturellement, les prises de position des mouvements débordèrent sur le domaine syndical et politique, en rupture avec le conservatisme traditionnel du monde catholique de notre pays. On voulut mettre le holà. Au lieu de les réfréner, leurs aumôniers, en particulier des jésuites, les avaient accompagnés, avaient même développé le fondement spirituel et théologique de cet engagement. On retira ces aumôniers, et l’Association Catholique de la Jeunesse Française (ACJF) qui fédérait les JOC, JAC, JEC etc., fut dissoute en 1956. Certains mouvements perdurèrent en se cantonnant à la seule activité religieuse, d’autres devinrent confidentiels, ou encore se scindèrent en donnant naissance à un mouvement politique et à une organisation chrétienne.
An niveau des personnes, il est difficile d’évaluer ce que ces laïcs engagés sont devenus après ce temps de crise. Plus tard, on s’apercevra que tel d’entre eux a plongé dans la politique en rompant tout lien d’Église, et tel autre en maintenant ce lien au plan personnel. On en retrouve d’autres dans des engagements strictement d’Église, d’autres repliés sur la vie professionnelle, sur l’approfondissement intellectuel. La distance prise par chacun à l’égard de l’Église comme institution est le fait de chacun, et au fond je ne peux rien dire, sauf à propos d’amis proches, et l’ampleur de l’hémorragie - elle est certaine - m’échappe.
Du côté du clergé, les choses sont plus faciles à cerner. Certains prêtres ouvriers se soumirent et quittèrent le travail. D’autres estimèrent qu’ils ne pouvaient en conscience lâcher ceux dont ils partageaient la vie et les combats, ils demeurèrent au travail, et en général les évêques français ce contentèrent de leur retirer toute mission d’Église, ce qui permit après le Concile une reprise. Mais j’ignore combien cette crise provoqua parmi eux de départs définitifs. Quant aux théologiens dominicains et jésuites, la plupart se sont soumis strictement aux interdictions et aux déplacements imposés, sans renier leurs travaux. Sur le moment, certains laïcs ont pu penser qu’en se soumettant ils les abandonnaient. La suite, c’est-à-dire la part que ces mêmes théologiens ont prise aux avancées du Concile, a montré qu’ils avaient eu raison de rester dedans au prix d’un renoncement provisoire à l’expression publique. Les quelques-uns qui ont quitté alors l’institution ecclésiale ont pu développer des travaux intéressants en sciences humaines, mais leur impact religieux et spirituel s’est évanoui.
Quoi qu’il en soit, après cette crise qui s’en prenait à tout ce sur quoi comme chrétien j’avais misé à partir de mon adolescence, aucune désillusion, aucun revers subi dans l’Église ne pouvait plus avoir prise sur ma vie avec la même intensité.
L’élan du Concile
Quand en octobre 1958 Angelo Roncalli fut élu pape sous le nom de Jean XXIII après le décès de Pie XII, mes amis et moi n’attendions pas grand-chose de lui. Il donnait l’impression d’être un prélat traditionnel bien classique et obéissant. Nonce à Paris jusqu'en 1953, lors des premières mises en garde romaines et des premières mesures mettant en question les prêtres ouvriers et la nouvelle théologie, il n'avait rien fait pour défendre les audaces françaises et avait transmis sans état d'âme les rappels à l'ordre du Vatican. Ce que nous n’avons compris que plus tard, c’est que ce fils sans histoire de l’Église, bien soumis à ses supérieurs non pas servilement mais par conviction de conscience que dans l’Église voulue par Dieu c’est comme ça, s’est retrouvé du fait de son élection avec pour seul supérieur l’Esprit Saint. En convoquant un concile, il lui a donné toute sa chance de se manifester.
Vatican II fait maintenant partie de l’histoire, la documentation est abondante. Je dirai seulement qu’après les incertitudes des premiers jours (la Curie avait tenté de verrouiller les débats avec des textes tout prêts, il fallut la pugnacité du cardinal Liénart, évêque de Lille, et de quelques autres, pour que la parole de tous les participants soit libérée), ce fut un vrai temps d’espérance. Chaque évêque pouvait amener avec lui un théologien pour le conseiller, on vit ainsi réémerger et devenir de plus en plus influents les victimes de la glaciation précédente. L’invitation lancée à des observateurs des autres confessions chrétiennes allait également enrichir profondément le déroulement de l’assemblée.
Une liturgie enfin accessible à la compréhension de ses paroles, une manière de voir l’Église qui part de l’existence d’un Peuple de Dieu, les ouvertures en matière d’œcuménisme et de dialogue interreligieux, la réévaluation positive du judaïsme et la conversion à la liberté de conscience, comment ne nous serions-nous pas réjouis de tout cela ? Certains il est vrai, dans leur impatience, auraient voulu voir leur Église aller plus loin (je vous laisse deviner sur quels points), j’étais de ceux pour qui l’essentiel était que nous nous soyons collectivement, hiérarchie et peuple, mis en marche pour « mettre à jour » (cela se dit aggiornamento en italien, ce terme fut beaucoup utilisé) le rapport de l’Église catholique au monde dans lequel elle vit.La mise en œuvre des décisions du Concile
J’ai vécu, beaucoup de mes amis ont vécu de manière très positive cette période. Plus tard, en nous retournant sur ces années, nous avons dû admettre qu’il y avait eu une importante part d’illusion.
Car tout le monde parmi les catholiques ne voyait pas ce Concile d’un même œil. Laissons de côté ceux qui n’avaient pas du tout accepté les conversions effectuées, et qui sont bientôt partis, derrière Mgr Lefebvre. Ils n’ont jamais représenté grand-chose. Plus dangereux furent, et demeurent, ceux qui, d’accord sur le fond avec les schismatiques, sont cependant restés dans notre Église par peur de l’aventure, par tactique, ou bien, il ne faut pas hésiter à le reconnaître, par conviction de conscience pour demeurer dans l’obéissance au pape. Ils sont toujours là, prêts à pousser l’Église à repartir en arrière.
Dans le gros du peuple fidèle et des responsables, il y eut, me semble-t-il, deux attitudes de fond différentes. Pour les uns, l’Église s’était remise en marche, avait ouvert les portes et il n’y avait pas à les refermer. On s’était engagé sur un chemin dont les premières étapes venaient d’être balisées, il s’agissait d’une dynamique à développer, dont il ne fallait pas exclure que le cours ultérieur en surprenne plus d’un, comme venaient de surprendre certains épisodes des sessions du Concile. Pour les autres, le Concile avait répondu à une situation où l’Église avait pris conscience qu’elle était un peu perdue dans un monde qui avait changé en profondeur, elle venait d’opérer la mise à jour nécessaire, et puisque l’Esprit saint avait fait son travail, il s’agissait simplement d’appliquer, point final.
Bien sûr, opposer de manière abrupte une attitude dynamique et une attitude de consolidation est schématique. Parmi les « dynamiques », certains, dont j’étais, pensaient qu’on ne pouvait réaliser tout tout-de-suite, qu’il fallait aller d’étape en étape, et d’abord appliquer les textes votés, tout en veillant à ne pas verrouiller l’avenir par des positions déclarées définitives (2) . D’autres, plus impatients, n’ont pas hésité à bousculer la hiérarchie, à devancer les décrets d’application, à choquer en estimant aider ainsi à faire avancer les choses (ce qui a quelquefois provoqué l’inverse). Ce dernier courant fut renforcé par l’évolution de la société dans son ensemble, qui aboutit, trois ans après la clôture du Concile, à la crise et aux enthousiasmes de mai 68.
En face, parmi ceux qui voulaient avant tout consolider, certains voyaient dans les mesures de mise à jour qui avaient été adoptées un maximum déjà quelque peu inquiétant sur certains points (par exemple toucher de sa main l’eucharistie, n’était-ce pas compromettre le sens du sacré ?), d’autres au contraire n’excluaient pas qu’au fur et à mesure de la mise en œuvre il apparaisse des situations appelant de nouveaux ajustements. Aucun camp n’était tout-à-fait homogène.Pour les « dynamiques », en tout cas, tout n’était pas gagné, contrairement à ce qu’on avait pu s’imaginer un peu vite. D’autant plus que beaucoup dans l’Église et dans sa hiérarchie attendaient, un peu naïvement peut-être, que l’aggiornamento opéré, mettant les fidèles plus à l’aise et plus en phase avec leur temps, enraie la diminution déjà bien amorcée du nombre des pratiquants. Ces espoirs furent déçus, et cette déception entraînait chez bon nombre de « consolidateurs » des interrogations : avait-on eu raison d’ouvrir les fenêtres, de renoncer à codifier aussi strictement qu’avant des pratiques comme le jeûne, la confession annuelle dans l’oreille d’un prêtre ou l’obligation de la messe dominicale, d’inviter les croyants à des initiatives qui en fait risquaient de les faire échapper à la houlette des pasteurs ? De plus, ce n’étaient pas seulement des laïcs qui s’en allaient, mais des prêtres, pour des raisons diverses. Tout cela préparait pour plus tard la tentation d’une reprise en main.
Ici, je m’interromps pour une remarque : la manière dont je raconte tout cela donne l’impression d’un récit historique. En fait, je ne prétends pas qu’un historien exposerait les choses ainsi. Je n’en sais rien. Je dis seulement comment j’ai senti les événements et les attitudes soit sur le moment, soit en me retournant au bout de quelques années, ou plus encore, sur ce que nous avions vécu.
Concrètement, nous avons eu la chance, mon épouse et moi, de nous trouver alors, jusqu’en 1970, dans une paroisse dijonnaise dont le clergé, 4 prêtres, était tout entier acquis à la dynamique du Concile, et ne lambina pas pour le mettre en pratique au maximum. À la Paroisse universitaire (le lieu de fraternité des catholiques de l’Enseignement public) il en était de même. Quand, arrivés en banlieue parisienne, nous avons dû subir jusqu’en 1974 un curé certes saintement dévoué à son ministère mais resté très largement préconciliaire, et hostile à l’enseignement public, cela nous désola pour l’immédiat, mais me parut sans conséquence : son attitude n’était qu’un reliquat du passé voué à l’extinction. Lorsqu’il eut pris sa retraite, la nomination de Michel Jondot comme curé et de Christine Fontaine comme théologienne prédicatrice confirma que la dynamique du Concile était à l’œuvre. Le temps des désillusions n’était pas encore arrivé.Rétropédalages et continuités
L’évidence d’une reprise de contrôle par une hiérarchie inquiète du foisonnement qui s’était produit et appuyée par des fidèles conservateurs qui s’étaient sentis péniblement bousculés, s’imposa à nous lors de la crise violente qui a affecté notre paroisse lorsque, à la fin du mandat de curé de Michel, l’évêque du moment a voulu « normaliser » cette communauté. Cependant, la situation locale se stabilisa un an plus tard lorsque fut nommé un nouveau curé, Daniel Vinson, dont les antécédents assez traditionnels donnaient toutes garanties à l’évêque, mais d’esprit très tolérant, si bien que l’équipe Tiers-Monde maintint sa pugnacité, que l’œcuménisme put se développer, et que dans les célébrations pénitentielles avec absolution l’absence de confessions individuelles perdura. Daniel n’a pas hésité à me dire un jour très franchement : « l’œcuménisme n’est pas mon truc », mais nous avons pu faire ce que nous voulions.
Depuis lors jusqu’à maintenant, je ne ressens plus, comme dans ce que j’ai raconté jusqu’ici, la succession de périodes caractérisées. C’est constamment qu’entrent en concurrence des événements marquant que la dynamique libérée par Jean XXIII est toujours à l’œuvre en divers lieux de l’Église, et d’autres qui manifestent la peur du grand large, une fermeture sur soi et sur la répétition commode de positions anciennes non réexaminées, jusqu’à des retours en arrière. Quand j’écris cela, il ne s’agit pas seulement des papes successifs et des évêques, mais tout aussi bien du peuple catholique : l’exode massif de migrants à travers le monde voit à la fois les militants du Secours Catholique se mobiliser pour eux et leurs dirigeants interpeller notre gouvernement, et d’autres catholiques en nombre céder à la peur d’une invasion musulmane et rallier des positions d’extrême droite. Quant aux papes, si je prends le cas de Benoît XVI, il a donné l’impression de réfréner toute audace doctrinale, mais quand il était encore à la tête de la Congrégation pour la Doctrine il a approuvé l’accord avec les luthériens sur la justification, qui reconnaît la valeur de ce qui fut l’intuition fondamentale de Martin Luther quand il était encore dans l’Église romaine et ne fut pas compris. Rien n’est simple.
Ou encore : quand fut fondée il y a une quarantaine d’années à Paris la Fraternité monastique de Jérusalem (moines et moniales en pleine civilisation urbaine) ils circulaient en effets civils dans les rues pour aller gagner leur vie au travail, et ne mettaient l’habit monastique que pour les offices, ils étaient vraiment présents dans la pâte urbaine ; puis ils se sont mis à garder le plus possible partout cet habit, au moment où dans la hiérarchie beaucoup récusaient l’enfouissement du levain dans la pâte et prônaient une nouvelle visibilité (avec par exemple le col romain pour les prêtres), et une plus grande partie d’entre eux a travaillé à des tâches internes à l’Église ; pourtant ils ont un jour repéré sur Dieu maintenant une réflexion sur le saint et le sacré (petitereflexionsurlesacreetlesaint.html) qui met en accusation le sacré de séparation, et ils ont demandé l’autorisation de la reprendre dans leur revue, dans un numéro traitant de « consacrer la vie » ! Oui, rien n’est simple.Je me réjouis lorsqu’il se vit une tolérance mutuelle, que dans une communauté des dévotions très traditionnelles de certains coexistent sans conflit avec des audaces d’autres. Mais il y a là un danger : que notre Église paraisse sans boussole, quand par exemple la position tenue par un évêque contredit celle d’un autre, ou même hypocrite quand quelques audaces servent de caution à des rigidités peu humaines et à des décisions réactionnaires. Cette tolérance pourtant vaut mieux qu’un unilatéralisme qui broierait toute dynamique positive. Je suis décidé à continuer sur la ligne de mes premiers engagements dans une Église devenue peu prévisible.
Dans ma vie il y a en tout cas un souvenir vivant qui constitue un socle solide sur lequel s’appuyer pour tenir et avancer : lorsqu’un Pie XII en fin de pontificat et la Curie qui l’entourait ont matraqué de manière injustifiée les Congar et les De Lubac et tout ce qui préparait en fait l’avenir de la foi dans notre monde, oui bien sûr ce fut à pleurer, mais la plupart ont su tenir bon dans la foi et dans l’Église, et nous leur devons la fécondité de ce qui a fleuri sous Jean XXIII et au Concile. Après que cette fécondité fut avérée, j’ai su dès lors que je ne partirais jamais de moi-même. Et que telle ou telle position inacceptable d’un responsable officiel ne saurait jamais annuler pour moi ni la nécessité de ce lieu de la grâce qu’est l’Église, ni la pertinence toujours valable de ce que, à une autre époque, j’ai entendu d’un autre évêque ou théologien ou militant reconnu, même si dans la hiérarchie et les catholiques d’aujourd’hui beaucoup semblent avoir récusé ces positions.
Il est vrai que j’ai eu une grande chance. Dans ma vie, l’Église ce n’est pas seulement la paroisse dans laquelle j’habite ou plus généralement l’Église catholique romaine d’aujourd’hui. C’est aussi, à cause de travaux un peu érudits que j’ai été amené à faire, l’Église de Cyprien de Carthage au 3e siècle et plus généralement les 4 ou 5 premiers siècles du christianisme, avec des évêques comme Basile et Chrysostome ou Ambroise et Augustin. Non que je les suive plus aveuglément que ceux d’aujourd’hui, mais la diversité des expériences et des réponses aux défis de l’époque permet à la fois de relativiser les déceptions du présent et de trouver des sources d’inspiration. Lorsque les évêques français tardaient à s’élever contre la torture pratiquée et ordonnée par des officiers de notre pays en Algérie, le professeur André Mandouze, dont j’ai la joie d’avoir été un disciple et un ami, a pu ainsi rappeler, en publiant dans un quotidien un article intitulé « Des évêques jadis … », qu’après le massacre de Thessalonique saint Ambroise avait imposé à l’empereur Théodose, qui en avait donné l’ordre, une lourde pénitence publique de plusieurs mois avant de le réadmettre à l’eucharistie. Quand un prélat incompétent confond le sacré païen de tabou et la sainteté mise en avant dans le Nouveau Testament, et prétend que recevoir le Christ eucharistique dans la main est un manque de respect, j’ai la possibilité de lui rappeler que l’Église de martyrs que fut l’Église des trois premiers siècles communiait ainsi, et que pour le moins il devrait éviter de la diffamer.
Cette chance a été affermie quand, bien avant que le texte en ait été publié sur Dieu maintenant, Michel et Christine m’ont demandé de rédiger pour une petite communauté une réflexion sur « Vingt siècles de christianisme », sous la forme d’un résumé le mieux informé possible. C’était désormais toute l’histoire de notre foi, et des avatars de son incarnation dans une institution faite d’humains, qui intervenait dans cette relativisation des déceptions et des indignations dont j’ai parlé, et dans l’espérance que fortifient les résiliences de cette histoire et les saintetés qui s’y manifestent.
Je ne méconnais pas une grave difficulté, à l’œuvre depuis plusieurs décennies. Dans l’institution ecclésiastique catholique romaine actuelle, où se voit souvent la prévalence d’une reprise en main méfiante envers les audaces postconciliaires, préférant une visibilité identitaire à l’enfouissement du levain dans la pâte et l’encadrement par des lois intangibles aux risques de l’invention morale et humaine, les vocations à la prêtrise n’aboutissent guère que chez les jeunes gens qui sont à l’aise avec cela. D’autant plus que l’absence de la vocation au célibat pour Dieu, vocation connexe dans l’Église latine de la vocation de prêtre tout en étant distincte, écarte certains des « dynamiques », alors que cette alliance des deux va de soi pour de plus traditionnels (quitte à ce qu’ils affrontent plus tard des problèmes, comme naguère ceux qui ont quitté le ministère pour se marier dans les années qui ont suivi le Concile et 1968). Un signe extérieur, qui n’est qu’un signe extérieur mais qui est bien là, est que le col romain, marque identitaire, est bien plus présent dans la jeune génération du clergé que chez les plus anciens. Et les retards et les ratés de la réforme de la Curie voulue par le pape François ne sont pas là pour arranger les choses. Il apparaît aussi que les nominations d’évêques par Rome sont allées depuis bon nombre d’années dans le même sens. Alors, sommes-nous condamnés à l’impuissance ?
Je n’en crois rien. Le cardinal Suhard, archevêque de Reims puis de Paris dans l’entre-deux-guerres et la guerre de 1939-45, n’avait rien d’un moderniste, et son indulgence pour Pétain et le pétainisme a fait que lors de la libération de Paris le général de Gaulle a refusé qu’il préside le Te Deum d’action de grâces célébré à la cathédrale Notre-Dame. Mais, mis par sa fonction et son écoute en face de la réalité du diocèse de Paris (à l’époque il débordait sur la proche banlieue), devenu conscient de la déchristianisation, du fossé qui s’était creusé entre le peuple et l’Église, il a lancé la mission de Paris et les prêtres ouvriers, a voulu mettre son Église en état de mission, et de 1947 à 1949 il a donné trois lettres pastorales de carême remarquables qui font figure aujourd’hui d’avant-goût du Concile, si bien qu’à sa mort en 1949 Témoignage Chrétien, l’hebdomadaire des catholiques de gauche issu de la Résistance, titrait sur toute la largeur de sa une : « Le cardinal Suhard notre père est mort ». Rien n’est perdu quand un prêtre affronte en pasteur la réalité des problèmes que vit son peuple, quand il accepte d’ouvrir les yeux, et pourquoi nos jeunes prêtres en col romain en seraient-ils incapables ?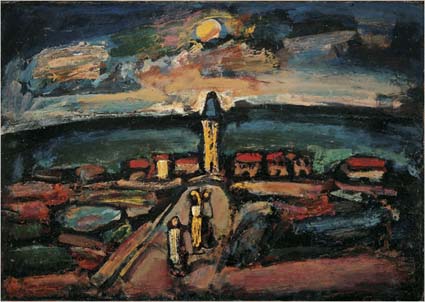
Dans cette situation ambiguë, Dieu maintenant tente de maintenir coûte que coûte le lien d’amitié et de recherche commune avec ceux qui ne veulent plus être dans l’institution catholique romaine d’aujourd’hui, non pour les y ramener (qui sommes-nous pour juger à leur place de ce qui est bon pour eux ?), mais afin de préparer l’avenir et de faire vivre la fraternité.Pour finir,
quelques moments personnels significatifs1947. J’étudie en classe préparatoire dans un lycée parisien. Mais au dehors cela gronde. De nombreuses usines sont en grève, des augmentations de salaire sont revendiquées, il y a des manifestations. Dans un monde où les anciens vainqueurs d’hier ont commencé à entrer en guerre froide les grévistes sont accusés de travailler pour Moscou, et c’est un ministre socialiste de l’Intérieur, Jules Moch, qui orchestre la répression. Que penser ? Je suis déjà allé une fois à Montreuil, banlieue alors très ouvrière, voir et interroger sur son engagement André Depierre, l’un des premiers prêtres ouvriers, qui est un ami proche de l’un des professeurs que j’ai eu trois ans auparavant en seconde (en seconde et en première au lycée Faidherbe à Lille, j’ai eu comme cela quelques profs cathos et résistants, vivant avec leurs familles en semi-communauté, qui m’ont ouvert à bien des choses). Je décide d’aller à Montreuil. Ce jour-là, Depierre, trop accaparé par les uns et par les autres pour répondre à mes questions, me dit de m’asseoir dans un coin de sa salle à manger et d’écouter. Dans ce va-et-vient d’ouvriers et de militants en lutte qui parlent de la grève mais aussi des derniers sous dont on fait le compte car il devient difficile de manger, j’ai vite fait de percevoir que les revendications sont vraiment vitales ici. Y a-t-il des communistes parmi eux ? Je n’en sais rien, mais la géopolitique est bien loin, et c’est des angoisses et des combats de la vie quotidienne qu’il est question. Le père Depierre ne m’a rien dit, mais j’ai compris.
1948. J’entre à l’École Normale Supérieure. L’aumônier des catholiques de l’École est André Brien, prêtre du diocèse de Paris. Je le connais déjà, il s’occupait aussi des classes de préparation à l’ENS des lycées du Quartier latin. À l’École, la vie syndicale est active (nous sommes fonctionnaires stagiaires), et beaucoup d’élèves participent à des groupes divers, dont les deux plus fournis sont alors le groupe tala (ceux qui vont t’à la messe) et la cellule communiste. Bon nombre de talas sont actifs dans la vie syndicale et dans la vie politique, la plupart à gauche et dans la solidarité avec les luttes anticolonialistes, mais il y a aussi quelques gaullistes (De Gaulle est alors retiré à Colombey et dans l’opposition de droite aux gouvernements de la 4e République), et d’autres s’impliquent plutôt dans le culturel. Face à cette diversité, face aux risques de certains de ces engagements, aux discordes possibles, le père Brien n’a pas un seul instant mis en garde et cherché à ramener vers je ne sais quel christianisme sage. Il a parlé de Dieu et du Christ, en nous offrant non pas un catéchisme détaillé et des consignes morales, mais un approfondissement du mystère, de l’économie du salut, de l’Église au-delà des vicissitudes de l’histoire, avec une attention aussi à ce qu’il y a de plus essentiel dans la liturgie (je me souviens d’une vraie célébration pascale bien avant les réformes conciliaires, et alors que la vigile officielle se célébrait encore absurdement le samedi matin, pratiquement sans peuple). À vrai dire, je serais bien incapable d’énoncer de manière précise des enseignements théologiques reçus de lui, mais je sais être sorti de là muni, plutôt que de thèses déterminées, d’une structure intérieure de la foi. Parmi les normaliens talas de l’époque, il en existe certainement qui, comme ailleurs, ont ensuite abandonné l’Église. Pourtant si je me retourne pour voir ce que sont devenus ceux avec qui je formais une petite équipe solidaire dans les mêmes engagements, et qui sont demeurés des amis, aucun n’a lâché, même après des désillusions.Printemps 1954. On vient d’apprendre les sanctions fulminées contre les dominicains et les jésuites les plus audacieux. À Bastia, loin de Paris, j’apprends cependant par mes amis dominicains quelques détails. Rome a décidé non seulement de condamner au silence et d’éloigner ces théologiens, mais de démettre d’autorité le provincial dominicain qui les a soutenus (alors que dans cet ordre les prieurs des couvents et les prieurs provinciaux sont librement élus). Alors que le Maître Général des dominicains est dépêché en France pour l’exécution de ces ordres, le Vatican lui propose de lui conférer de la part du pape des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de sa mission. Il refuse : « Je suis sûr de l’obéissance de mes religieux ». Au niveau du mystère, la réussite du futur Concile a peut-être reçu là une impulsion décisive.
Automne 1963. Le premier texte voté au Concile est la Constitution sur la liturgie. Assez vite, la traduction en français de l’ordinaire de la messe est entreprise, chaque évêque est consulté, et à Dijon l’avis de deux ou trois latinistes, dont je suis, est demandé. Plus tard, l’évêque établira plusieurs commissions pour l’aider à piloter l’application des décisions conciliaires. Chaque commission comprend, issus de la douzaine de doyennés entre lesquels ont été réparties les paroisses de la Côte-d’Or, un prêtre par doyenné, plus quelques supposés compétents ; le responsable de la commission de liturgie est un professeur au séminaire, qui est aussi aumônier de la Paroisse Universitaire, et qui propose à l’évêque ma participation à la commission, où je me retrouve seul laïc en compagnie d’une religieuse et de prêtres. Une bonne part des prêtres sont là parce que dans leur doyenné leurs confrères plus précisément branchés sur le catéchisme, ou le monde ouvrier, ou la famille, etc., ont été envoyés dans les commissions compétentes, et qu’il restait à pourvoir la liturgie. Jusque-là leur compétence liturgique s’est manifestée essentiellement par une fidélité scrupuleuse aux rubriques dans la célébration de la messe, et ce qu’ils demandent, un peu inquiets mais pleins de bonne volonté, c’est qu’on leur communique avec précision les nouvelles rubriques qu’il leur faudra respecter. Je me souviens les avoir un peu étonnés en expliquant un jour dans un exposé qui m’avait été demandé qu’avec la nouvelle liturgie il se passait à peu près ce qui était intervenu dans l’évolution des espèces avec le passage des invertébrés aux vertébrés : chez les insectes ou les crustacés la fermeté des corps est assurée par une carapace extérieure à laquelle il ne faut pas porter atteinte, alors que chez les vertébrés la solidité est assurée par l’armature intérieure du squelette, permettant plus de souplesse pour ce qui est à la surface. L’essentiel n’est plus de suivre à la lettre les consignes des rubriques, mais d’avoir bien compris la structure et les enchaînements de la célébration pour ne pas les altérer quand on prend l’initiative de modifier une prière, d’ajouter une allusion à un souci actuel de la communauté, de substituer un texte biblique à un autre. Il y a de la liberté, mais il ne s’agit pas de faire n’importe quoi, et une formation est nécessaire pour s’y reconnaître. En me retournant sur ce passé, il me semble que les besoins manifestés par ces prêtres m’ont aidé à voir quelque chose d’essentiel pour ma propre participation à l’Église : ne pas m’attarder à tout ce qui en elle fait office de cuirasse (et qui souvent me gêne aux entournures), mais s’accrocher aux structures profondes de la foi, se fier à l’armature intérieure plutôt qu’à l’armure extérieure, et là je retrouve l’apport du père Brien.
Printemps 1996. Avant l’enlèvement des 7 moines par un commando apparemment islamiste et antigouvernemental, je crois que je n’avais pas entendu parler de Tibhirine, cet îlot de prière monastique en terre algérienne et musulmane, en symbiose de charité et de fraternité avec le village adjacent. Les jours suivants, on en apprend plus sur eux, on comprend qu’ils se savaient menacés mais n’ont pas voulu partir se mettre à l’abri en laissant seuls les villageois pris en tenaille entre l’armée et les maquisards. Le 21 mai arrive la nouvelle de l’assassinat des 7. Ce jour-là ou le lendemain, je ne sais plus, on annonce pour la fin de l’après-midi qu’une messe sera célébrée en leur mémoire à Paris, à Saint-Philippe du Roule. Je m’y rends. Église pleine. Les nombreux prêtres concélébrants n’ont pas revêtu le violet de la prière pour les morts, mais le rouge de la Croix, de l’Esprit saint et du martyre. Je suis sûr qu’il y avait une tristesse immense chez les proches des moines, et d’abord chez Madame de Chergé, la mère de Christian, mais le sens de cette messe, ce fut d’abord l’action de grâces pour le témoignage rendu par leur vie et dans leur mort. Je suis reparti de là convaincu que les semaines que nous venions de vivre et le sacrifice des moines (j’ajouterai désormais : et des autres martyrs, tel l’évêque d’Oran, Pierre Claverie) étaient dans notre Église un événement spirituel majeur du 20e siècle. La rencontre, plus tard, du frère Jean-Pierre, qui a eu la chance d’échapper aux ravisseurs alors qu’il avait fait la même offrande de sa vie, n’a pas démenti cette conviction, au contraire.
Ce ne sont là que quelques moments. Il y en eut certainement d’autres, qui pourraient revenir à la surface au gré de conversations et de questions. En tout cas l’essentiel et le plus profond, dans mon expérience personnelle de l’Église, de l’Église romaine en laquelle je suis, ne réside pas, ne réside plus dans ce qui quotidiennement provoque de l’espoir ou de l’agacement, de l’enthousiasme ou du scandale (même si tout cela se produit en effet).
Michel Poirier, mars 2018
Peintures de Georges Rouault 1- Élève en école primaire avant 1939, j’y ai appris que la France avait deux sortes de colonies : des colonies « de peuplement » (Algérie, Antilles, Réunion), et des colonies « d’exploitation ». Nos instituteurs enseignaient cela naïvement. / Retour au texte
2-Ma connaissance des premiers siècles et de ce qui se passe dans les Églises orientales m’avait dès longtemps persuadé qu’il faudrait bien un jour que l’Église romaine latine ordonne des prêtres vivant dans le mariage, l’encyclique Sacerdotalis coelibatus de Paul VI m’a donc déçu, mais j’ai pris positivement la distinction qu’elle opère entre vocation à la fonction presbytérale dans l’Église et vocation au célibat pour Dieu (l’Église latine se réservant actuellement selon le pape le droit de n’appeler que ceux qui ont les deux vocations) et le respect affirmé pour la tradition orientale ; cela laisse ouvert un avenir, même si je le trouve bien lointain. J’ai pris plus mal la volonté de Jean-Paul II de déclarer définitive l’exclusion des femmes de ce ministère. / Retour au texte


