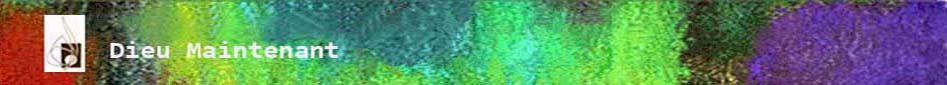

Paul de Tarse est-il misogyne ?
Daniel Marguerat
En ouverture d’une conférence à propos de son livre sur Paul de Tarse (1), Daniel Marguerat déclare : « En écrivant ce livre j’ai cherché à rendre justice à Paul. En effet, celui que nous lisons est un Paul de seconde main : deux mille ans de lecture chrétienne ont accumulé des images, des clichés, des caricatures qui vont jusqu’à comprendre à rebours ce qu’il a fait et ce qu’il a dit. Comme ces vieilles armoires que les générations précédentes ont couvertes de couches de peinture parce que c’était à la mode, il faut décaper la lecture que nous faisons de Paul pour retrouver la chaleur du bois. » Nous retenons de cette conférence le décapage que Daniel Marguerat fait de Paul souvent présenté comme misogyne.
Cette conférence a été donnée à l’Église protestante du Temple-Neuf de Strasbourg. Nous en conservons le style parlé. On trouve la version intégrale en cliquant sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=f9TxSPt1v30
Avant-propos
Je vais m’attacher à déconstruire le Paul misogyne.
Sept lettres peuvent être assurément attribuées à Paul : dans l’ordre chronologique, la première lettre aux Thessaloniciens, les deux lettres aux Corinthiens, la lettre aux Galates, l’épitre aux Romains, la lettre aux Philippiens et le billet à Philémon (2). Dans ces sept lettres, Paul cite 43 collaborateurs et parmi eux 21 femmes, la moitié. Ce sont les hommes et les femmes qu’il a formés et qui vont le suivre dans ses voyages, à qui il va confier les Églises qu’il a créé. Des hommes et des femmes à qui Paul va confier l’avenir de la chrétienté. (…)
Quand on lit aujourd’hui les lettres de Paul, elles sont un peu indigestes. Mais elles l’étaient déjà au premier siècle. Une personne - qui, dans le meilleur des cas, avait participé à la composition de la lettre – expliquait, comprenait, interprétait. Savez-vous à qui Paul a confié sa lettre la plus magistrale, la plus longue, la plus fondamentale ? : l’épitre aux Romains. À une femme : la diaconnesse Phoebé. Il en parle dans le chapitre 16 de l’épitre aux Romains. Une femme explique à l’Église de Rome ce que Paul a voulu dire. Ça c’est le Paul de Paul, pas le Paul caricatural de la tradition chrétienne.
« Il n’y a plus l’homme et la femme ; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus Christ » (Gal 3,28).
Paul était-il antiféministe dans ses écrits ?
Une exégète québécoise, Olivette Genest, a écrit avec férocité : « Faut-il que Paul se taise dans la discussion sur la situation des femmes en christianisme ? » Une autre a été encore plus sévère : « Saul, Saul, pourquoi nous as-tu persécutées ? » Il se trouve que ces deux exégètes se trompent. Elles n’ont pas lu le Paul de Paul mais celui de seconde main. Je vais tenter de vous le montrer.
Je vous propose de lire ce texte : « Pendant l’instruction la femme doit garder le silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d’enseigner ni de dominer l’homme. Qu’elle se tienne donc en silence. C’est Adam, en effet, qui fut formé le premier, Eve ensuite. Et ce n’est pas Adam qui fut séduit, mais c’est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Cependant elle sera sauvée par sa maternité, à condition de persévérer dans la foi, l’amour et la sainteté, avec modestie. » Ce texte reprend un poncif de la théologie juive au premier siècle : Adam a été créé en premier (Genèse 2), donc la femme vient ensuite. Genèse 3 : dans l’histoire de la chute, c’est Eve qui, la première goutte du fruit de l’arbre de la connaissance. Conclusion du texte : elle sera sauvée par sa maternité à condition de persévérer dans la foi, l’amour et la sainteté, avec modestie. Vous pourrez me dire que si je veux démontrer que Paul n’est pas un antiféministe, je suis mal parti.
Il se trouve que ce texte n’est pas de Paul. C’est un extrait de la première épitre à Timothée (1Tim 2,9-15), écrite par des disciples de Paul 20 ans après sa mort, c’est-à-dire dans les années 80. Paul n’aurait jamais pu écrire « La femme sera sauvée par la maternité. » Ce qui voudrait dire que les hommes se trouveraient quand même un peu en difficulté… Mais surtout, chez Paul, on est sauvé par la foi et non par la maternité. Et jamais Paul, dans les sept lettres qui lui sont attribuées, ne reprend le poncif de la femme par laquelle le péché est entré dans l’humanité. Le péché est toujours attribué par Paul à Adam, (l’être humain et non pas l’homme de sexe masculin, Cf Rm 5).
Nous avons ici un texte qui émane des disciples de Paul, dans la première des lettres qu’on appelle les épitres pastorales. Il est vrai qu’elles se présentent sous le nom de Paul. Il était courant dans l’antiquité que des disciples d’un maître écrivent en son nom pour actualiser son enseignement, ou pour le compléter, ou le rendre plus concret. Aujourd’hui nous dirions qu’il s’agit d’un faux en écriture mais dans l’antiquité, on ne raisonne pas comme cela. Les disciples qui écrivent au nom du maître, le font pour servir l’autorité du maître.
Paul n’est pas du tout sur ce registre. Son slogan que l’on trouve dans l’épitre aux Galates (et qui revient en 1 Co 12) est : « Il n’y a plus ni juif, ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n’y a plus l’homme et la femme ; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus Christ » (Galates 3,28). Vous me direz que, dans la société, il y a bien entendu des juifs et des Grecs, des esclaves et des hommes libres, des hommes et des femmes. Oui. Mais Paul dit : « Vous n’êtes qu’un en Jésus Christ. »
J’ai participé à un congrès d’historiens où nous nous sommes demandé quelle est la place de la femme dans les mouvements religieux au premier siècle. La réponse est claire : la religion, dans l’antiquité est toujours genrée. C’est ou bien une religion d’hommes où les femmes sont tolérées, ou bien une religion féminine – par exemple le culte égyptien d’Isis – où les hommes sont tout juste admis. Et, comme vous le savez, dans le judaïsme encore aujourd’hui le statut religieux de la femme est secondaire par rapport à l’homme. Paul est le seul missionnaire d’envergure qui crée des communautés dans lesquelles hommes et femmes, juifs et Grecs, esclaves et hommes libres sont reconnus à égalité de droit, de dignité et de valeur.Paul déploie la seule offre religieuse de communautés égalitaires. Au premier siècle il vaut mieux être juif que païen, homme libre qu’esclave et du point de vue du droit homme que femme. Paul dit : « par votre adhésion au Christ, scellée par le baptême, vous devenez frères et sœurs. » Il instaure des communautés dans lesquelles tout ce qui sépare dans la société, tout ce qui hiérarchise est aboli. On le dit encore aujourd’hui mais c’est peut-être devenu une métaphore un peu vide. Paul a été un pionnier. C’est cela qu’il a voulu, qu’il a organisé.
« Que les femmes se taisent dans l’assemblée » (1Co,14).
Mais on m’objectera ce fameux slogan que les clercs ont formulé en latin : « Taceat mulier in ecclesia, que les femmes se taisent dans l’assemblée » (1 Co,14). Comment fait-on coïncider la création de communautés égalitaires avec cette parole de Paul ? Là encore, on lit Paul à rebours. Juste avant ce passage de la première épitre aux Corinthiens, au chapitre 11, Paul parle des femmes qui prient et prophétisent durant le culte de la communauté. Les femmes à Corinthe - égales en droit, en valeur et en dignité aux hommes – ont une fonction qu’aujourd’hui on dirait ministérielle. En effet, le prophète, dans le premier christianisme, a un rôle fondamental : il est le gardien de la tradition de Jésus. C’est lui qui transmet les messages de l’Esprit Saint à la communauté. Ce rôle était confié aux hommes comme aux femmes. Jamais Paul ne va dire que les femmes cessent de prier ou de prophétiser dans le culte de la communauté.
Il dit pourtant : « Comme cela se fait dans toutes les Églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées… Si elles désirent s’instruire sur quelque détail, qu’elles interrogent leur mari à la maison. Il est honteux en effet qu’une femme parle dans les assemblées » (1Co14,33b-35). Que se passait-il ? Pour comprendre, il faut s’immerger dans l’histoire de Paul. Le culte à Corinthe est un véritable charivari. Paul le raconte au chapitre 14 de la première lettre aux Corinthiens. Il est invoqué comme arbitre. « On n’arrive plus à gérer », dit-on à l’apôtre. Quel est ce charivari ? Il y a ceux et celles qui parlent en langue, ce langage extatique, courant dans les communautés pentecôtistes aujourd’hui. Ce langage produit par l’Esprit Saint mais qui est incompréhensible. Alors il y a un autre groupe - celui des prophètes – qui interprète. Et puis il y a un troisième groupe : celui des femmes, les femmes mariées ici. Par égalité de droit, de dignité et de valeur, elles accèdent à la parole théologique et elles tirent leur mari par la tunique en disant : « Il ou elle a voulu dire quoi ? Je ne comprends pas. Explique-moi. » Et c’est le brouhaha.
Paul est donc convoqué comme arbitre et il va poser une première règle de silence : « Pour le parler en langues, qu’il y ait au maximum trois interventions à la suite ; mais si personne n’est là pour interpréter, que celui ou celle qui parle en langues se taise dans l’assemblée » (1Co 14,27-28). Si personne n’est là pour interpréter, c’est du charabia donc il faut se taire. Paul ne dit pas que personne ne doit parler en langue. Il distribue la parole. Deuxième règle : « Trois interventions successives au plus (pour ceux qui interprètent le parler en langue). Et si un autre assistant reçoit une révélation, que le premier se taise » (1Co 14,29-33a). Il ne dit pas qu’il ne faut jamais interpréter. Il dit : « Respectez un ordre de parole. Je viens gérer la parole. » Et du coup, troisième règle, les femmes : « que les femmes se taisent dans les assemblées, car elles peuvent interroger leur mari à la maison » (1Co 14,33b-35). Il ne dit pas « que les femmes cessent de parler en langues ». Il ne dit pas « que les femmes cessent d’interpréter ce parler en langue ». Il ne dit pas « que les femmes cessent de prier ou de prophétiser ». Il dit « vous avez des maris à la maison et, au lieu de le tirer par la tunique – dans le culte – attendez après ». Paul déplace le lieu de la parole car pour lui, et c’est fondamental, « Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix » (1Co 14,33).
Donc vous voyez comment une règle de distribution de la parole a pris, dans la tradition chrétienne, le statut d’une règle fondamentale qui va interdire aux femmes de prendre la parole et d’accéder aux ministères. Le Paul de Paul ne dit pas cela. Il gère le brouhaha. On a perverti la parole de Paul pour lui donner un statut fondamental sur le droit de la femme à la parole en assemblée. La pression du patriarcalisme a été si forte qu’elle a dénaturé le propos de Paul. On a excisé ce fragment de verset pour en faire un axiome.
« Dans le Seigneur, il n’y a pas de femme sans homme, ni d’homme sans la femme » (1Co 11,11).
Mais il faut que j’en dise encore un peu plus. Là mon argumentation va être un peu plus serrée. Paul aborde la question des femmes – à propos du voile - au chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens. Paul dit ceci : « Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion, et de conserver les traditions telles que je vous les ai transmises » (1Co 11,2). Les traditions dans la mission paulinienne sont hommes et femmes à égalité de droit, de dignité et de valeur. Mais que s’est-il passé à Corinthe ? Les femmes chrétiennes – au moins un groupe d’entre elles – ont très bien entendu l’apôtre et, du coup elles se sont dit, au culte où elles prient et prophétisent : « ce voile qui est le symbole de notre sujétion sociale, nous n’en voulons plus. » Peut-être savez-vous que, dans l’antiquité, la femme mariée est toujours voilée en public qu’elle soit Grecque, Romaine ou Juive. Le culte à Corinthe est un événement public donc elle est voilée. Ce n’est pas une spécialité chrétienne. Le voile, imposé à la femme mariée par les conventions sociales, marque effectivement sa dépendance par rapport à l’homme mais en même temps la préserve du regard prédateur de l’homme. Mais ces femmes qui protestent contre le voile représentent une aile radicale. Elles disent « Allons jusqu’au bout. Si devant le Christ nous sommes égales, alors posons le voile. »
Paul, une fois de plus, est invoqué comme arbitre. Sa mission est délicate parce qu’il ne va pas dire aux femmes de se taire. Cette liberté qu’elles ont choisie, c’est Paul lui-même qui l’a initiée. Il faut reconnaître que Paul, dans ce chapitre 11, n’est pas le meilleur des débataires. Comment va-t-il s’y prendre ? Il va citer l’ordre « créationnel » : « Mais je veux que vous sachiez que la tête de tout homme, c’est le Christ ; la tête de la femme, c’est l’homme ; la tête du Christ, c’est Dieu » (1Co 11,3). Une hiérarchie : Dieu, Christ, homme, femme. C’est l’ordre « créationnel » – l’ordre de la création tel qu’on le trouve au livre de la Genèse – et qui est en même temps validé dans l’ordre social pour justifier la dépendance de la femme à l’égard de l’homme.
Voyons la suite du texte : « Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie ou prophétise la tête non couverte déshonore sa tête ; car c’est exactement comme si elle était rasée » (1Co 11,4-5). Paul utilise le mot tête et non celui de chef, comme le font certaines traductions de la Bible. C’est différent quand même parce que si la tête commande le corps en même temps le corps vit de la tête. Paul va dire qu’il y a un ordre créationnel et, dans cet ordre, la femme est dépendante de l’homme. Et il continue : « L’homme ne doit pas se couvrir la tête : il est l’image et la gloire de Dieu ; mais la femme est la gloire de l’homme (allusion à Genèse 2). Car ce n’est pas l’homme qui vient de la femme, mais la femme de l’homme ; et l’homme n’a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l’homme » (1Co 11,7-9). Jusqu’ici il semble que ce soit assez clair comme lecture patriarcale.
Mais dans les deux versets qui suivent Paul dit : « Pourtant, dans le Seigneur, il n’y a pas de femme sans homme, ni d’homme sans la femme. Car comme la femme vient de l’homme, ainsi l’homme vient de la femme, et tout vient de Dieu » (1Co 11,11-12). Paul a posé dans l’ordre créationnel la dépendance de la femme par rapport à l’homme mais il déclare dans les versets suivants que, dans le Seigneur, c’est différent. Traduisez : en Église, c’est différent. Ce qui est différent est que la dépendance est réciproque. Jamais l’ordre chrétien ne pourrait se justifier de l’ordre créationnel pour légitimer un pouvoir unique du mâle sur la femme. Le Paul de Paul est là. Mais, dans la lecture patriarcale qui a été faite de ce texte, les versets 11 et 12 ont été sautés.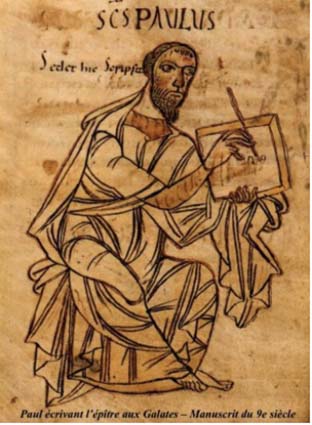
Conclusion
Attention, ne faisons pas de Paul le féministe du XXe ou du XXIe siècle. Non, Paul n’est pas un féministe : il rappelle l’ordre créationnel auquel il adhère. Mais Paul récuse l’idée que, en Église, cette dépendance soit à sens unique. Il est extraordinairement moderne en disant : « Parlons de dépendance oui, mais dans les deux sens. » Il lit le récit de la Genèse en homme de son temps. Mais cette conception ne remet jamais en cause, chez Paul, le fait que, dans le Seigneur, il n’y a pas de hiérarchie à sens unique et que la dépendance va dans les deux sens.
(…) La surprise ou la nouveauté de Paul est exprimée non seulement dans sa déclaration « il n’y a plus ni juif ni grec, ni hommes ni femmes, ni esclave ni homme libre » mais par sa pratique. Une déclaration qui est une provocation sociale absolue. Oui Paul, en tant que juif pharisien, en tant que citoyen romain, appartient à sa culture. Mais l’étonnante nouveauté est qu’il ait pu avoir cette pratique d’égalité sociale alors qu’il n’y en a pas d’autres exemples dans la société qui lui est contemporaine. (…) Sur la question du voile des femmes, on aurait pu imaginer que Paul dise : « Au fond, elles ont raison ces femmes qui veulent ôter le voile. » Si c’est, comme il le dit, « dans le Seigneur » que les hiérarchies sont abolies, pourquoi ne pas le manifester concrètement lors du culte où l’on est dans le Seigneur ? Il aurait pu aller jusque-là mais ce n’est pas le cas. Il reste homme de son temps. Néanmoins, si l’on suit son argumentation, on voit où s’en trouve la pointe.
(…) Nos sociétés deviennent aujourd’hui de plus en plus hiérarchisées et particularisées. (…) Paul est devant. C’est lui qu’il faut suivre. Ne disons pas qu’il est victime de sa culture de l’antiquité. Le jour où nous aurons réalisé, dans l’Église, ce que dit Paul d’une reconnaissance égale de la dignité de chacun – fondée sur le don de la grâce – on pourra éventuellement penser que Paul est un conservateur du passé. Mais nous n’y sommes pas encore. (…) Paul n’est pas un rétrograde, comme certaines lectures que l’on fait de ses écrits pousseraient à le croire. Paul est devant nous !
Daniel Marguerat, mise en ligne mai 2025
1- Daniel Marguerat Paul de Tarse, l’enfant terrible du christianisme, Ed. Seuil mars 2023. / Retour au texte
2- Les autres lettres de Paul qui font partie du Nouveau Testament ont été écrites après sa mort vers 64. Soit la deuxième lettre aux Thessaloniciens, l’épitre aux Éphésiens et celle aux Colossiens (appelées Épitres deutéropauliniennes, écrites dans les années 70-80) – Les deux lettres à Timothée et la lettre à Tite (appelées Épitres pastorales et écrites à partir des années 90 et jusqu’à 100 environ). / Retour au texte

