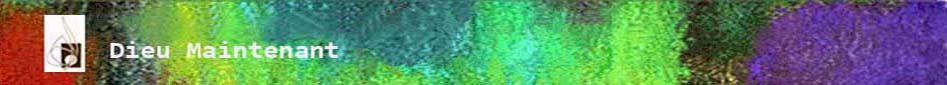

Pouvoirs institués et puissance prophétique
Gildas Labey
Gildas Labey analyse le conflit, inhérent selon lui au christianisme, entre puissance prophétique et pouvoir institué. Il écrit : « Jésus ne fut pas essentiellement du côté de l’institué, percevant trop bien combien les garants de l’établi pouvaient manquer l’inspiration, l’invention, en s’en tenant aux règles sans voir les êtres, leur singularité, leur inédit. Mais il fut « instituant », acteur d’une institution, en prenant ce terme comme un acte, une opération, un geste créateur. » Retrouver ce souffle créateur aujourd’hui passe par l’abolition de la distinction asymétrique entre clercs et laïcs.
Gildas Labey a enseigné la philosophie tant en lycée qu’en université (publics et privés) ainsi qu’au centre de détention pénitentiaire de Fresnes. Une fois à la retraite, il a animé dans son village un atelier de réflexion philosophique. Ami de Guy Lafon, il a fait paraître, à sa mort, un article (revue Études octobre 2020) ainsi qu’un dossier sur son œuvre, et son réseau de travail et de réflexion.

« Toute institution est tendue entre les forces qui la maintiennent en la refermant sur elle-même et celles qui la font changer. »
Les forces réactives ont eu en grande partie raison des avancées de Vatican II, et on redoute quelque chose de ce genre quant à celles, fragiles mais réelles, produites par un François en butte à une forte opposition et à ses propres ambiguïtés. On saisit alors quelque chose d'originaire dans le Christianisme - et, d'une certaine manière, Jésus en est mort : le conflit entre la puissance prophétique et le pouvoir institué. Ainsi va l'histoire de l'Eglise : la liberté prophétique vit d'une attention constante à l'autre, à l'événement, aux signes des temps, le pouvoir institué tient et maintient des forteresses dogmatiques, surveille et sanctionne ce qui s'en écarte et qui pourrait allumer des feux nouveaux.
Qu’entendre par puissance prophétique ? D’abord un certain style de parole. Il s’agit de parler au nom de Dieu, c’est-à-dire de rappeler les exigences éthiques radicales qui fondent l’appartenance à la communauté croyante, de rappeler l’impératif de la Loi, de montrer les écarts, les perversions, les trahisons dont ils font l’objet. Il y a, ensuite, une fois les fautes énoncées, puis surmontées, le souffle du salut et la promesse d’une alliance renouvelée, et ce point est essentiel : l’esprit prophétique comporte un refus de camper sur des rituels, des comportements, des traditions établies toujours en passe d’étouffer l’inspiration, l’engagement exemplaire au cœur des réalités humaines multiples et changeantes, et le désir de les vivifier, de les comprendre et de les accompagner au plus proche d’elles-mêmes.
En regard de cela, les pouvoirs institués gardent, conservent, préservent, avancent avec prudence, quand ils avancent. Et sans doute est-il constitutif d’une institution d’opérer en ce sens, de garantir un cadre, une organisation, des règles dans lesquels les individus peuvent évoluer, croître, vivre. Une institution est structurellement conservatrice. Il lui faut un certain poids, une certaine assise pour ne pas être fragilisée, menacée de dissolution avec le temps qui passe et ses représentants qui changent. Mais dès lors que les responsables ecclésiaux tiennent volontiers le langage de l’éternité, confondant (sciemment !) l’Eglise du Christ avec son organisation temporelle, ils entretiennent la croyance que la durée à l’identique, la stabilité du même symbolisent et concrétisent une éternelle volonté divine.
En vérité toute institution est tendue entre les forces qui la maintiennent en la refermant sur elle-même et celles qui la font changer. Cette évidence est simple, sommaire, mais claire. Un philosophe comme Bergson a composé tout un traité sur la morale et la religion construit sur cette tension duelle, opposant simplement le « clos » et « l’ouvert », « religion statique » et « religion dynamique ». La clôture statique comme défense contre le désordre, l’imprévisible, l’angoisse. La dynamique ouverte comme élan, déploiement, communication, création d’amour et de justice dans le concret mouvant de l’histoire. De sorte que l’autorité de l’institution peut jouer en deux sens : normer, contenir, inclure et exclure, exercer un pouvoir sur, ou bien autoriser, faire confiance à l’intuition audacieuse, la discerner et la reconnaître, et favoriser en chacun un juste pouvoir de.
Jésus ne fut pas essentiellement du côté de l’institué, percevant trop bien combien les garants de l’établi pouvaient manquer l’inspiration, l’invention, en s’en tenant aux règles sans voir les êtres, leur singularité, leur inédit. Mais il fut « instituant », acteur d’une institution, en prenant ce terme comme un acte, une opération, un geste créateur. Bien souvent, soit dit en passant,quand on entre en tension avec l’institution, on pense à l’institution « instituée ». On oublie l’autre versant, par lequel l’Eglise est instituée toutes les fois que des croyants se rassemblent au nom du Christ, pour prier, lire, agir. Alors personne n’est en dehors de l’institution, en ce sens. Tous concourent, quotidiennement, à instituer l’Eglise, reste à savoir dans quel sens, quelle orientation. Les conflits intra ecclésiaux n’ont en eux-mêmes rien de tragique mais ils surgissent nécessairement sur le chemin que trace l’Eglise en marchant. Dans quel sens s’orienter ? Selon quel critère ? Le prophète et le gardien peuvent-ils s’entendre ?
« De ce jeu, de cette lutte entre l’appel prophétique et l’ordre institutionnel l’histoire offre maints exemples. »
De ce jeu, de cette lutte entre l’appel prophétique et l’ordre institutionnel l’histoire offre maints exemples. L’un est spécialement marquant : celui de François d’Assise. On sait quel fut le propos constant de François à l’endroit de l’Eglise : d’abord se recentrer sur la pauvreté et le dénuement évangéliques. Ensuite renoncer à la scission clercs/laïcs, à l’asymétrie de leur relation, au profit d’une égalité instituée de façon explicite. On peut enfin adjoindre la fraternité avec la Nature, comme pour inviter les humains à renoncer à toute position supérieure, souveraine sur les êtres et les choses.
On sait aussi l’intelligence et le sens des rapports de force que déploya Innocent III dans son dialogue avec les courants évangéliques novateurs du temps, souvent laïques, et en particulier avec François. Car le Poverello pouvait passer au camp des « hérétiques ». Il suffit de reconsidérer l’histoire des Cathares, dont l’Inquisition eut la peau, des Albigeois, contre lesquels le même Innocent III, hélas, finalement mena croisade, et qu’il élimina. Les Cathares se disaient les « Pauvres de Dieu » et fondèrent pour un temps une société exemplaire d’égalité, de justice, et de foi. Ce qui mettait en question la hiérarchie romaine, le pouvoir catholique, la violence normative institutionnelle. A bien y réfléchir, François était-il si éloigné de ces militants de la pauvreté divine ?
François ne se sépara jamais de l’Eglise instituée, mais Rome, avec le temps, après avoir fini par « autoriser » François et son courant, se montra de plus en plus autoritaire et violente à l’égard du franciscanisme au point que, comme l’écrit André Vauchez (François d’Assise, 2009, pp 478-479) « Jean XXII (1316-1334)… promulgua en 1323 « la constitution Cum inter nonullos, qui provoqua une crise violente entre la papauté et la hiérarchie de l’ordre : le pape y déclarait en effet hérétique l’affirmation selon laquelle le Christ et les apôtres avaient vécu dans une pauvreté absolue » - l’argument : Judas était trésorier du groupe qui, de ce fait, disposait d’argent. « Ainsi, ajoute A. Vauchez, près d’un siècle après la mort de François (+1226), une de ses intuitions fondamentales était officiellement condamnée par l’Eglise romaine. » Certains frères polémiquèrent courageusement contre l’arbitraire pontifical (guillaume d’Ockham au nom de la liberté évangélique et de pensée), d’autres entrèrent en clandestinité, beaucoup finirent sur le bûcher.
Inversement, on peut montrer comment des intuitions protestantes ont pu irriguer le discernement de Vatican II. (Sur ce point d’ailleurs on pourrait faire valoir que les divisions violentes qui se sont produites au sein de l’Eglise chrétienne pouvaient (et peuvent encore) exprimer une logique et nécessaire différenciation historico-culturelle, interne et externe, de la pensée, des pratiques et des mœurs chrétiennes, qui n’impliquait nullement la brutalité des déchirements mais que la prétention romaine à la possession de l’unique vérité ne pouvait qu’entraver et qu’interdire.)
De même la crise moderniste a fini, dans le souffle de ce même concile, par ouvrir explicitement la pensée chrétienne et la théologie à la modernité intellectuelle, à l’historico-critique, aux sciences humaines, permettant ainsi une « conversation avec le monde », et faisant apparaître que les chrétiens ne sont pas étrangers au monde mais, bien davantage, qu’ils en sont, partageant comme leurs contemporains les questionnements du temps.
En revanche on ne peut oublier, au registre des oppositions internes à l’institution ecclésiale, l’opération indigne dont José Cardoso Sobrinho, succédant à Helder Camara, fut chargé par Jean-Paul II : étouffer les structures pastorales créées par don Helder, supprimer l’institut de Théologie de Recife, où les prêtres étaient formés autant à la théologie qu’à l’action sociale. C’était rejouer, mutatis mutandis, le coup de Jean-XXII en 1323 contre l’intuition fondatrice de François d’Assise relative à la pauvreté. En 1985, on s’arrogeait le droit de juger condamnable la manière dont la théologie de la libération fondait l’action aux côtés des plus pauvres, des victimes des pouvoirs établis, sur un continent auquel Jean-Paul II n’a rien pu, ou voulu, comprendre,optant là pour le modèle d’une Eglise au coude à coude avec les pouvoirs et les sanglantes dictatures. L’expérience de l’oppression communiste ne l’aura pas complètement instruit. Sans doute la résistance de l’Eglise polonaise au communisme soviétique, et la solution à laquelle elle contribua ne se faisaient-elles pas au nom d’une Eglise des pauvres mais d’une institution hiérarchique traditionnelle un temps empêchée d’arborer sa domination.
« Si l’on veut réduire la domination cléricale et toutes ses conséquences, jusque dans la violence des abus, alors c’est la distinction asymétrique clerc/laïc qu’il faut abolir. »
On voit bien que si et quand avancées il y a, elles sont constamment contrées par des forces réactives qui furent d’ailleurs à l’œuvre dès le Concile. Ces forces sont souvent habiles, parfois dotées de grands moyens : elles connaissent les codes et les outils de la modernité. Les moyens de communication, les éléments de langage, les signes d’empathie, les savoir-faire, tout cela, une bonne part de nouveaux prêtres ensoutanés, sympathiques, proches des gens, en usent avec aisance pour mieux circonvenir, anesthésier, enrôler les fidèles croyants, conserver une mainmise cléricale sur ce qui tombe sous leur juridiction, dans un esprit de tradition figé, et, chez certains, pour jouir de leur pouvoir.
Aujourd’hui, si l’on voulait se représenter selon quelle orientation un prophétisme pourrait jouer, on montrerait la nécessaire refonte à opérer dans l’organisation ecclésiale, par un rappel clair de ce que nous savons nommer, tant la réflexion s’y est attelée depuis un certain temps déjà. Refonder par les sources, contester ce qui a été institué naguère pour assurer l’autorité surplombante des clercs et la subordination des laïcs. On dira que les choses ont quand même bien bougé. Mais cela demeure pour une part illusoire tant que le sol, les fonds n’auront pas été salutairement retournés, aérés, comme on retourne et laboure un champ pour lui redonner le pouvoir de fructifier, de produire de nouveau et du nouveau. Parabole du semeur, en quelque manière !
En effet si l’on veut réduire la domination cléricale et toutes ses conséquences, jusque dans la violence des abus, alors c’est la distinction asymétrique clerc/laïc qu’il faut abolir, en revenant à l’unique et égale condition baptismale partagée par tous les croyants. A partir de là, et en se ressourçant au modèle de ce que l’on dit être celui des premières communautés chrétiennes, alors, ressaisissant les fonctions nécessaires à la vie de la communauté : prier et célébrer, enseigner, œuvrer caritativement, gérer l’intendance, que l’on forme des hommes et des femmes à l’exercice de ces fonctions ; qu’elles soient exercées à tour de rôle, à chaque fois pour un temps donné, dans une institution collectivement pilotée par des membres choisis par et dans les assemblées. Et si l’on peut redéfinir le rôle d’une instance centrale (romaine ou autre), qu’elle soit de coordination, de communication, d’accompagnement, de mise en lien des communautés les unes avec les autres. Paul de Tarse est un exemple précieux de ce que peut être un foyer nourricier dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Et que le recours à la tradition, ce qui est livré d’une génération à l’autre, soit comme une ressource pour l’aujourd’hui et non comme un bastion fermé sur l’hier.
Bref sur tous ces points, continuons de rêver (car le réel résiste et ne se laissera pas faire…), de penser, de croire qu’il y a une sagesse prophétique vivifiante, audacieuse, capable d’entendre la voix d’un Dieu inattendu, de contribuer, dans l’Esprit, aux libres et vivantes et salutaires solidarités qui se nouent entre les humains de bonne volonté.
Gildas Labey, mai 2025
Peintures de Nicolas de Staël

