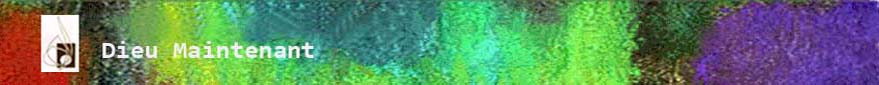

Saint Jean Damascène
7- L'amant de l'invisible

Au moins depuis que les empereurs étaient devenus chrétiens, l’usage était répandu de propager le christianisme à l’aide d’images du Christ, de la Vierge ou des saints. On leur attribuait parfois une valeur tutélaire. Ainsi se développait un art sacré dont les moines souvent étaient dépositaires. La technique de ces icônes remontait à l’antiquité préchrétienne (romaine, grecque ou égyptienne). A l’aide de matières minérales passées à la cire chaude, on trouvait des couleurs pour faire, de leur vivant, le portrait de personnages qu’on utiliserait au jour de leurs obsèques. Au moins depuis le Vème siècle, les chrétiens avaient repris cette technique pour faire l’icône des saints, du Christ ou de sa mère. Des légendes circulaient qui faisaient remonter cette coutume aux auteurs des Evangiles eux-mêmes. Luc aurait fait le portrait de Marie avant de le léguer à la postérité.
A l’époque de Jean Damascène, un riche patrimoine artistique, maintenant disparu, s’était constitué autour des monastères. On commençait à s’interroger. La représentation du Christ ou des saints ne risquait-elle pas de faire illusion ? Leur culte ne détournait-il pas de la réalité invisible ? La question était d’autant plus compliquée que certaines tendances hérétiques concernant Jésus étaient encore vivantes ; le Verbe de Dieu est inaccessible ; sa représentation dans la matière est impossible. Par ailleurs, le culte eucharistique n’est-il pas contradictoire avec tout autre signe visible des mystères ?
Pain et vin de l’Eucharistie manifestent le Christ en vérité et non en peinture. Vouer un culte à une image, n’est-ce pas confondre l’ombre et la présence ? On était divisé sur ces questions ! Est-ce pour apaiser les esprits ? L’empereur – Léon l’Isaurien – publie un édit mettant les « images » hors la loi. Les réactions de l’Eglise sont unanimes. Germain, le patriarche de Constantinople, se retire dans un monastère et le pape Grégoire II à Rome condamne la décision impériale. Quant à Jean Damascène, il réagit avec fougue. Lui-même compare sa parole au galop d’un cheval emporté à qui on lâche les rênes. Il refuse de s’incliner devant le pouvoir séculier : « Il n’appartient pas au roi de légiférer pour l’Eglise. »
Il se lance dans un travail monumental, affine sa pensée en trois discours successifs pour l’ajuster aux questions théologiques du moment, reprend les lectures de toute une vie pour établir un long catalogue de citations : il s’agit de justifier par la tradition que le culte rendu aux icônes est légitime. Son esprit logicien élimine les faux arguments et introduit les distinctions qui s’imposent. Autre est l’adoration portée au Créateur, autre est la vénération portée à l’icône construite de main d’homme dans la matière. De l’Ancien Testament qui interdit de faire des images au temps de l’Eglise qui suit l’incarnation, la rupture est totale ; désormais puisque le Verbe est venu dans notre chair, rien dans l’univers créé n’est indigne d’évoquer le mystère de Dieu. Et si Jésus a eu une existence individuelle comme chacun d’entre nous, pourquoi échapperait-il à la possibilité reconnue à chaque personne humaine d’être représentée ? Et comment interdire les images ? Tout n’est-il pas image, aussi bien en Dieu lui-même que dans sa création ? L’homme est image de Dieu et le Fils est l’empreinte du Père.
Jean Mansour était peut-être quasi centenaire lorsque se déclencha le conflit. Où trouva-t-il l’énergie pour résister au fanatisme du successeur de Léon l’Isaurien, Constantin V arrive au pouvoir en 741. Il ne se contente pas de légiférer mais prétend argumenter ; il se pique de théologie ! Jean prend son bâton de pèlerin ; il va jusqu’à Constantinople chez les moines de Stoudion. On l’invite de monastère en monastère. Il prêche, il argumente, il fourbit les armes intellectuelles dont l’Eglise se servira plus tard pour sortir de la crise. Il ne semble pas que Jean Mansour, de son vivant, ait eu à souffrir dans sa chair ou sa réputation de la folie de Constantin V. L’Eglise de Syrie-Palestine échappait à la juridiction de l’empereur et, de ce fait, jouissait d’une plus grande liberté de parole. Néanmoins, 4 ans après sa mort, un concile est convoqué par l’empereur. On y promulgue officiellement la condamnation des images et on anathématise ses partisans. C’est dans ce cadre que Jean Mansour est condamné à titre posthume. Il l’est d’une manière assez vulgaire. Son nom arabe (« Mansour » qui signifie « victorieux ») est proche, phonétiquement, du mot grec « Manzèr », c’est-à-dire « bâtard ».
« Anathème à Mansour qui a un nom de mauvais présage et qui professe des sentiments mahométans ! Anathème à Mansour qui a trahi le Christ ! Anathème à l’ennemi de l’empire, au docteur d’impiété, au vénérateur d’images. » C’est alors que la violence iconoclaste fait rage : l’armée casse toutes les icônes, les fresques, les planchettes de bois qui pourraient servir à la confection d’images nouvelles. Les moines résistent au sacrilège. Ils protègent l’Eglise de l’intrusion séculière. On les passe au fil de l’épée, donnant ainsi à l’Eglise une belle moisson de martyrs.
En fin de compte, les idées de Jean furent plus fortes que les armées de l’empereur et elles s’imposèrent en 787 au concile qui se tint à Nicée où l’on rétablit la légitimité des images. Mieux : désormais les images seront intégrées dans le cadre de la liturgie byzantine. Au début de la crise, Jean – l’amoureux de la beauté – pouvait-il espérer meilleure issue ?
Fin de la vie de Jean Damascène
Cliquer ici pour retourner à la table des chapitres

